11/02/2016
POTUS 2016
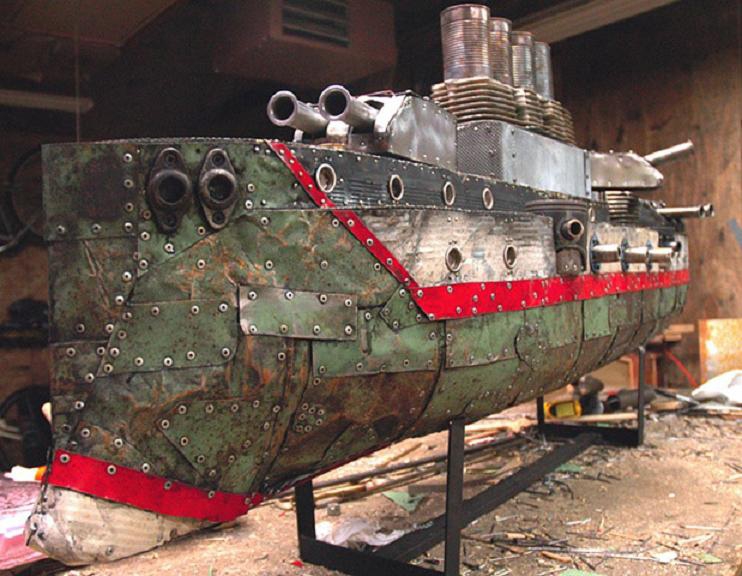
Potus 2016: un casting au potentiel dévastateur
Entrefilets.com – 1er février 2016

« They came, they saw, she died ? »
Après les huit ans bling bling du libidineux Clinton, les huit ans de sang du corporate-pantin Doobleyou, nous achevons donc les huit ans de vide absolu de Barak Hussein Obama, premier Président «noir» des Etats-Unis, mais uniquement cela. Huit ans durant, le bonhomme se sera en effet contenté de paraître, de cultiver dans un même élan son image, ses abdos et sa famille-potiche pour survendre la fiction hollywoodienne de son personnage. Huit ans durant, il aura ainsi été sublime et martial jusqu’au grotesque dans chacune de ses apparitions, parfaitement dressé par une armée de communicants-nounous à jouer comme personne du rythme, des intonations et des silences de ses récitations, à s’indigner ici, ou à pleurnicher là, pour émouvoir la ménagère et humidifier la groupie de rédaction avec sa «human touch» de papier glacé. Huit ans de communication pure donc, huit ans de simulacre, de vide, huit ans pour rien. Barak Hussein Obama n’aura même pas été un mauvais président. Il n’aura rien été du tout. Et c’est sur ce vide sidéral que s’engage désormais le casting pour le prochain Potus (President of the United States), avec un potentiel cette fois réellement dévastateur pour l'Empire.
Ciao pantin
Comme de coutume depuis Clinton, l’ère d’Obama se terminera donc par l’obligatoire petite farce filmée sensée nous prouver que l’homme était bel et bien un être humain «comme vous et moi», avec un cœur et de l’humour. La pantalonnade donnera ensuite le coup d’envoi à l’avalanche de bobo-analyses où les plumitifs de la presse-Système tenteront le «bilan» de huit ans de vide pourtant seulement rempli par une mesurette sociale, d’ailleurs promise au démontage républicain, et des discours, des postures et encore des discours.
Evidemment, il s’en trouvera qui mettront à l’actif de la speakerine US sortante la réintégration de l’Iran dans le grand concert des nations (rions un peu), alors même qu’elle répondait à une évidente nécessité stratégique de la machinerie de l’Empire dans sa guerre contre l’Asie pour le contrôle du « pipelineistan », et qui donc serait survenue même avec Pluto dans le bureau ovale.
En réalité, la sortie d’Obama des écrans cathodiques-Systèmes sera un non-évènement conforme à l’essence même de sa Présidence.
Ce qui nous intéresse en revanche, ce qui nous intéresse beaucoup, c’est la suite bien sûr.
Source : http://www.entrefilets.com/potus_2016_un_casting_au_poten...

Puisqu’on en parle…
Psychologie des masses
Ted Cruz PsyOp
par Thierry Meyssan
Pour la première fois dans l’Histoire, une équipe spécialisée dans les opérations psychologiques tente de fabriquer un candidat à l’élection présidentielle états-unienne et de le porter à la Maison-Blanche. Sa victoire, si elle y parvenait, attesterait de la possibilité de falsifier le processus électoral lui-même. En outre, elle poserait la question du pouvoir des militaires sur les institutions civiles.
Réseau Voltaire | Damas (Syrie) | 8 février 2016
English Español فارسى italiano Português русский Türkçe Deutsch ελληνικά

Ted Cruz
Les « opérations psychologiques » (Psy Ops) sont des « ruses de guerre » à l’image du Cheval de Troie. Sous l’influence du général Edward Lansdale, les États-Unis ont doté leurs armées et la CIA d’unités spécialisées, d’abord aux Philippines, au Vietnam et contre Cuba, puis de manière permanente [1].
Les opérations psychologiques sont beaucoup plus complexes que la propagande qui ne vise qu’à déformer la perception de la réalité. Par exemple, durant la guerre contre la Syrie en 2011, la propagande alliée consistait à convaincre la population que le président el-Assad allait fuir, comme le président Ben Ali l’avait fait avant lui en Tunisie. Les Syriens devaient donc se préparer à un nouveau régime. Tandis que, début 2012, une opération psychologique prévoyait de substituer aux chaînes de télévision nationale de faux programmes mettant en scène la chute de la République arabe syrienne de sorte que la population n’oppose plus aucune résistance [2].
De même qu’il existe aujourd’hui des armées de mercenaires, tel que Blackwater-Academi, DynCorp ou CACI, il existe pareillement des compagnies privées spécialisées dans les opérations psychologiques dont la britannique SCL (Strategic Communications Laboratories) et sa filiale états-unienne Cambridge Analytica. Dans le plus grand secret, elles aident la CIA à l’organisation de « révolutions colorées » et s’essaient désormais à la manipulation des électeurs. Depuis 2005, elles participent au salon britannique Defense Systems & Equipment International (DSEi) et vendent leurs services au plus offrant [3]. Dans l’exemple syrien, SCL a travaillé début 2011 au Liban où elle a étudié les possibilités de manipulation de la population communauté par communauté.
Source : http://www.voltairenet.org/article190139.html

Dieu te bénisse, Amérique
Israel Adam Shamir – Entre la plume et l’enclume – 10 février 2016
Excellente nouvelle du New Hampshire ! Après des années de frustration, nous entrevoyons l’Amérique que nous voulons voir bénie, celle qui rejette la machine à fric de Wall Street et sa machine à cadavres du Pentagone. Les deux candidats en tête pour la présidence sont bons, Sanders pour la gauche et Trump pour la droite, exactement ce qu’il faut, et laissons maintenant le meilleur gagner, pour nous étrangers ils feront l’affaire tous les deux. Ils sont non-interventionnistes, tous les deux veulent stabiliser l’Amérique, sans aller s’ingérer ailleurs. Le peuple a rejeté les candidats va-t’en guerre de l’establishment, et c’est ce qui compte.
Excellent, que droite et gauche rivalisent pour le bien du pays au lieu de former un centre informe et de s’y tenir. La société a besoin d’une gauche et d’une droite, on ne saurait tenir debout sans sa jambe gauche et sa jambe droite. La droite est la force conservatrice, de la nature et de la tradition. La gauche est celle qui fait avancer la société, la garantie de sa vitalité, de sa capacité de changement, de sa mobilité sociale. Une société sans sa gauche pourrirait sur pied, une société sans droite s’effondrerait. La gauche apporte le mouvement, la droite garantit la stabilité.
Dans le New Hampshire, le peuple américain a vaincu la pseudo gauche et la pseudo droite, elle donne sa chance au réel. Mme Clinton battue par le vieux socialiste, et Mr Bush par le tonitruant Trump : ils se sentaient puissants et tout en haut de la pyramide, comme des aristocrates nés pour commander, mais la République a des instincts démocratiques sains. Nos deux nouvelles figures de proue rejettent les diktats des banquiers, veulent tous les deux offrir aux Américains un bon système sécurité sociale, et sont mécontents de la tournure de l’Amérique ces dernières années.
Les Démocrates ont rejeté les politiques identitaires, les femmes ont dit non aux sorcières féministes qui voulaient enfourcher le cheval de bataille de la solidarité sororale. Et les Républicains n’ont pas été effrayés par la machine médiatique qui faisait déjà de Trump le « nouvel Hitler ». Parfait !
Source : http://plumenclume.org/blog/88-dieu-te-benisse-amerique-p...

Et si on commençait par se débarrasser des zélus et des magistrats infidèles, ne le sauverait-on pas plus sûrement ?
Il faut sauver le soldat Bourget
Étienne Pellot - Proche&Moyen-Orient.ch – 8 février 2016

Jacques-Marie Bourget
Le 21 octobre 2000, armé d’un fusil d’assaut M-16, un tireur israélien répond aux ordres de sa hiérarchie, loge une balle à haute vitesse dans la poitrine d’un journaliste français alors en reportage à Ramallah, en Palestine occupée. Jacques-Marie Bourget, à cet instant envoyé spécial de Paris-Match, échappe par miracle à la mort. Le projectile est passé près du cœur avant de s’écraser dans l’omoplate. Cohérents dans leur choix, celui de détruire cet « homme-cible », les autorités israéliennes refusent de relever le blessé, de le soigner. Ce sont les sauveteurs et chirurgiens palestiniens qui opèrent et gardent le journaliste à la vie.
Après quarante-huit heures passées à l’hôpital du Croissant rouge, l’évacuation du reporter vers Paris par avion spécial est refusée par Israël. Et c’est le président Jacques Chirac qui se met en colère et exige la liberté pour l’envoyé spécial blessé. Aujourd’hui, après toutes ces années où les mois de soins et les nouvelles opérations se sont additionnés, notre confrère reste victime d’un handicap évalué à 42%.
Le reporter a déposé une plainte contre X pour « tentative d’assassinat » devant le TGI de Paris. Après une longue paresse, la justice envoyait une Commission rogatoire internationale (CRI) en Israël et sollicitait l’application du traité bilatéral d’assistance judiciaire signé en 1959. Puis le silence a recouvert le dossier. Plus de trois années plus tard, le gouvernement de Tel-Aviv répond enfin. Une réplique très curieuse et contradictoire. « L’armée israélienne a fait une enquête sur le cas Bourget ». « Mais elle est frappée du secret ». Pis « elle a été perdue ». Pour conclure les autorités israéliennes précisent : « de toutes façons le journaliste a été atteint par un tir palestinien »… Voilà pour la coopération et la cohérence.
Abandonné par l’ensemble des pouvoirs publics français et tous autres, syndicats ou ONG du type Reporters Sans Frontières, notre confrère n’a d’autre choix que de se retourner devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI). Laquelle est accouplée à un Fonds de Garantie (FGTI) qui doit, le cas échéant, indemniser les victimes.
Dans un premier temps – écoutez bien ! – le TGI de Paris déclare que Jacques-Marie Bourget n’est pas une victime puisque son statut est celui d’un soldat… Et les magistrats ajoutent que « se prononcer sur l’origine de la blessure du journaliste serait s’immiscer dans la politique d’un état étranger et démocratique ». Autrement dit, si un agent israélien a tiré sur le reporter français, c’est qu’il avait de bonnes raisons ! Fermez le ban.
En appel les juges du TGI lisent les faits et le droit tout autrement. William Bourdon – l’avocat du reporter – glisse la Convention de Genève et celle d’Athènes sous le nez de la cour : un journaliste en zone de conflit reste un civil qu’il faut protéger, ou pour le moins épargner. Que d’efforts pour atteindre le pic du bon sens. L’envoyé de Paris-Match, (abandonné par sa rédaction), est donc une victime qu’il faut indemniser. Patatras, cette décision – qui par sa jurisprudence est une très bonne nouvelle pour tous les « reporters de guerre » – est frappée d’un recours devant la Cour de cassation !
Résumons. Un journaliste français est tiré comme un gibier par un soldat israélien. Personne ne bouge pour demander des comptes à Tel-Aviv, ni pour soutenir le rescapé. Puis, quinze années après le drame, un tribunal reconnait enfin que l’homme de plume est une « victime ». Très bien ! Et là, subitement un Fonds de Garantie, placé sous l’autorité du gouvernement français, conteste cette qualité, à la fois à Jacques-Marie Bourget et, au-delà, à tous les confrères tués ou blessés en « zone de conflit ». On atteint les sommets de l’indicible !
Voilà une histoire bien exemplaire à l’heure même où, selon la doxa, les journalistes doivent être protégés par l’increvable parapluie de « Je suis Charlie ». Finalement, quelle drôle d’idée pour notre confrère de s’être fait blesser par un tireur ami de la France et de la démocratie ?
Source : http://reseauinternational.net/il-faut-sauver-le-soldat-bourget/

Alors que l’édition française les boycotte honteusement (en achetant les droits de leurs livres pour pouvoir les mettre sous le boisseau), les deux romanciers italiens en exil à Vienne publient dans le monde entier et donnent des interviews… y compris au Vatican.

(La Cour des Gentils – Dialogue entre croyants et incroyants)
La religion fait de la politique. Et la politique fait-elle de la religion ? L’Islam politique dans l’histoire de l’Europe moderne.
Interview de Rita Monaldi et Francesco Sorti
par La Cour des Gentils

Rita Monaldi et Francesco Sorti, époux dans la vie, nés respectivement en 1966 et 1964, sont un célèbre couple d’historiens et de romanciers de niveau international. Ils vivent à Vienne. Ils ont à leur actif neuf livres, tous bestsellers internationaux, traduits en 26 langues, dans 60 pays, et ils ont suscité l’attention du monde universitaire par les découvertes historiques, étayées par une documentation inédite, qui caractérisent leurs œuvres. Les deux auteurs, absents du panorama littéraire italien depuis treize ans, par suite des démêlés politico-éditoriaux que leur a valu leur premier roman, sont désormais publiés par Baldini & Castoldi. Suite à leurs longues recherches dans les archives et les bibliothèques de l’Europe, Monaldi et Sorti ont exhumé les plus de cent volumes de la correspondance de l’abbé Atto Melani (Pistoia 1626-Paris 1714), agent secret du cardinal Mazarin et de Louis XIV et protagoniste de leurs propres romans. Ils ont en outre préparé pour la publication les Mémoires secrets sur les quatre derniers conclaves* écrits par Melani pour le Roi Soleil et, découverts par eux à la Bibliothèque du Sénat, à Paris. Rita Monaldi est diplômée en lettres anciennes de l’Université La Sapienza de Rome, et elle a publié sa thèse en littérature grecque sur les Parthénées d’Alcman, dans la Revue Studi e materiali di storia della religione (SMSR, 1991, n.s. XV. 2), se consacrant ensuite à l’étude de la personnification du Poros de Platon (SMSR, 1992, n.s. XVI, 2). Après une bourse d’études post-universitaires en Autriche, elle a fait un stage de journalisme à la rédaction romaine du quotidien L’Indipendente de Vittorio Feltri, où elle a connu Francesco Sorti, lui aussi entré en journalisme (Radio Vatican, Paese Sera, Il Mondo) après avoir obtenu son diplôme d’histoire de la musique à l’Université La Sapienza de Rome, avec une thèse sur les origines du mélodrame baroque et la famille Melani, suivie d’un master en journalisme à la LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali).

« L’Histoire doit nous instruire » : avec ce titre, l’hebdomadaire Famiglia Cristiana a relayé, dans une interview publiée en octobre 2015, l’appel lancé par vous, qui est en même temps tout un programme créatif : mettre à nu, sous les espèces d’un roman historique mais en réalité par un véritable Bildungsroman, la continuité cachée entre passé et présent dans les points nodaux de l’Histoire, pour chercher, en parcourant bras dessus bras dessous avec le lecteur un chemin commun de compréhension et de découverte, une voie de sortie. Quel est le point de rencontre entre ce manifeste littéraire et la dialectique entre la foi chrétienne et la foi musulmane ?
La confrontation dramatique entre la Chrétienté et l’Islam, entre l’Occident démocratique et ISIS est un whodunit tragique en train de se dérouler sur la scène politique mondiale. Pour en trouver la clé, l’auteur de fiction dispose d’un arsenal non moins sophistiqué que le politologue ou l’historien des religions. Pour citer Pasolini, le romancier peut découvrir intuitivement ou par déduction, tout ce qui n’est pas connu ou qui est tu, raccorder des faits même très anciens, réassembler les morceaux désorganisés d’un tableau politique cohérent et rétablir la logique là où semble régner l’arbitraire, la folie et le mystère. Avec les armes du narrateur, nous avons essayé de remettre en ordre les morceaux de ce puzzle millénaire.
Il est bien connu que la religion, au cours des siècles, s’est servie de la politique. Dans une interview accordée au Cortile dei Gentili, le théologien et critique littéraire Brunetto Salvarani a fait allusion à la proposition inverse, en affirmant : « La religion, dans l’Histoire, a été elle aussi un détonateur très fort pour des intérêts, des calculs, des conflits, des guerres et des violences ». On dirait la synthèse parfaite des recherches historiques sur l’Occident et l’Islam, du XVIe au XVIIIe siècles, dont vous avez alimenté vos trois romans Veritas, Mysterium et Dissimulatio, qui vont enfin sortir en Italie au mois d’avril prochain, chez Baldini et Castoldi. Je cite deux passages de Veritas : « Les Ottomans en eux-mêmes ne seraient rien. Au cours des siècles, ils ont toujours été le bras armé de l’Occident, brandi contre l’Occident. » Et encore : « La puissance destructrice de Mahomet en réalité n’existe pas. C’est une création de l’Occident dressée contre lui-même. » La politique a donc toujours instrumentalisé la religion ?
Assurément. Rien que pour vous donner quelques exemples pris dans les siècles dont nous nous occupons dans nos livres : l’assaut turc sur Vienne de 1683, dernière grande tentative musulmane d’envahir l’Europe, s’est fait avec l’appui du Roi Soleil ou Roi Très Chrétien comme on l’appelait alors. Comme on le sait, Louis XIV voulait affaiblir l’empire des Habsbourg pour imposer son hégémonie à l’Europe. Les Français fournirent donc aux Turcs leur savoir-faire militaire, en particulier l’usage des tranchées dans les sièges, et ils firent obstacle à la création d’une coalition anti-turque. Les situations de cette espèce sont innombrables, et il ne s’agit pas de simple Realpolitik, mais de réelles embuscades organisées par les règnes occidentaux aux dépens des peuples frères ou voisins. En 1536, le souverain français François Ier a signé avec le sultan Soliman le Magnifique un traité devenu célèbre sous le nom d’« alliance impie », qui resta en vigueur plus de 250 ans, presque jusqu’aux guerres napoléoniennes. Ce pacte eut beaucoup de très graves retombées : par exemple, l’appui aux soulèvements des protestants en Hollande et diverses agressions militaires contre l’Espagne catholique par d’autres royaumes musulmans tels que celui du Maroc. À l’« alliance impie » entre la France et la Turquie a correspondu une autre alliance christiano-musulmane, bien entendu anti-française : celle qui a lié les Habsbourg et la Perse des Safavides, cette dynastie qui a façonné ce qui allait devenir l’Iran chi’ite actuel. Les Perses étaient en âpre concurrence avec les Ottomans, en dépit du fait que les deux royaumes avaient en commun la religion musulmane et la langue turque. Les royaumes d’Espagne et de Portugal n’ont pas hésité de leur côté à signer une alliance avec les Perses, précisément pour affaiblir la Turquie sunnite. Et c’est grâce aux agents diplomatiques anglais que la Perse a pu moderniser son armée et la rendre compétitive.
On dirait que le jeu des grandes puissances aux XVIe-XVIIIe siècles a adopté des mécaniques semblables à celles d’aujourd’hui : puissances occidentales rivales alimentant le conflit entre factions musulmanes chi’ites et sunnites et les instrumentalisant contre l’adversaire de service.
C’est exact. L’Histoire enseigne que l’Occident, ou en tout cas le monde évolué et industrialisé non-musulman, donc Russie comprise, a toujours soufflé sur le feu des conflits ethniques locaux à son propre bénéfice. Il y a trois siècles, le champ de bataille, outre le militaire, était celui du commerce maritime. Toutes les puissances, y compris les chrétiennes, pour frapper l’adversaire à ses ressources économiques, pratiquaient la piraterie. Aujourd’hui, le second front, c’est l’énergie, le pétrole et le jeu des grands gazoducs. Il est arrivé qu’il se forme, entre l’Occident et des États musulmans des coalitions purement occasionnelles, comme quand Napoléon s’est allié à la Perse contre la Russie. Carl Schmitt aurait souri et approuvé. Ce qui fait problème, c’est quand la politique ne fait plus son métier, fût-il cynique, mais se travestit en religion et devient de la traîtrise. L’Italie a assumé un rôle qui n’a pas été secondaire dans cette partie géopolitique séculaire. En 1480, Mehmed II a attaqué Otrante, déportant, violentant et massacrant une foule énorme de civils sans défense, dont huit cents martyrs qui ont refusé de se convertir à l’Islam et ont tous été décapités sur place, par groupes de cinquante à la fois. Tout cela, cependant, s’est produisit à cause des autres états italiens. Andrea Gritti, ambassadeur de la République de Venise, avait encouragé l’action de Mehmed II, en lui faisant savoir qu’il verrait d’un bon oeil un coup de main sur Otrante : la présence ottomane au sud de la péninsule aurait été une très grosse épine dans le flanc de Ferrante d’Aragon, roi de Naples et rival des Vénitiens. Florence elle-même avait envoyé au sultan beaucoup de signes positifs (et peut-être même plus), parce qu’elle était, à son tour, en conflit avec Ferrante. Beaucoup d’ingénieurs militaires toscans, Léonard de Vinci inclus, offraient leurs services au sultan pourvu qu’ils fussent bien payés. Autrement dit, les envahisseurs musulmans sanguinaires d’Otrante ont été l’instrument d’un impitoyable règlement de comptes entre les principautés italiennes.
Dans un de vos romans, vous avez écrit : « Les Ottomans sont l’instrument idéal. » Pourquoi l’étaient-ils ?
Avant tout, il faut distinguer entre l’échelon haut et l’échelon bas. Les Ottomans étaient l’instrument idéal aux deux niveaux. À l’échelon haut, parce que les finances, l’administration, le gouvernement et le commerce de l’Empire ottoman étaient essentiellement aux mains d’Occidentaux. Soliman le Magnifique, comme ses prédécesseurs, choisissait les hauts fonctionnaires de son administration grâce au devşirme, la célèbre « récolte » : le vivier de quinze mille enfants chrétiens qu’il faisait, chaque année, enlever en Roumélie, partie européenne de l’Empire ottoman, par exemple en Hongrie, et ensuite élever à Constantinople, parce qu’il croyait en secret que leur intelligence était supérieure à celle des Turcs. Les kidnappés devaient être rigoureusement chrétiens ; il était interdit d’enlever des enfants de musulmans ou de juifs. Dans le vivier de la « récolte », on choisissait ceux qui feraient ensuite partie des janissaires, le corps choisi et hautement spécialisé qui se retrouvait au sommet de l’armée. Les janissaires étaient donc tous chrétiens de naissance et n’avaient rien à voir avec le sang turc, puisque, dès le départ, le célibat leur était imposé et qu’ils ne risquaient pas d’avoir de descendance. Année après année, les vieilles victimes du devşirme étaient remplacées par le rapt de nouveaux enfants. À leur arrivée sur le territoire de l’empire musulman, les petits étaient très attentivement étudiés d’un point de vue physionomique : selon que les traits de leurs visages révélaient telle ou telle inclination, ils étaient envoyés servir dans le palais privé du sultan, dans l’administration de l’État ou dans l’armée, au sein des janissaires. Même les dignitaires du plus haut grade n’étaient pas turcs. Le grand vizir, c’est-à-dire le premier ministre, qui n’avait à répondre qu’au sultan, n’a presque jamais été turc, ni même musulman. Des quarante-sept grands vizirs qui se sont succédé à la Sublime Porte entre 1453 et 1623, seuls cinq ont été d’origine turque : les autres comprenaient des Albanais, des Chaldéens, des Grecs, des Arméniens, des Géorgiens, des Italiens et ainsi de suite. Ibrahim Pacha, le fameux grand vizir de Soliman le Magnifique, n’était pas turc mais vénitien. Et Sokollu, grand vizir du sultan Selim II, fils de Soliman, était un juif bosniaque converti au christianisme. Déjà un demi-millénaire avant eux, le grand vizir de Grenade, Samuel ibn Nagrela avait été juif.
Une autre citation de vos livres : « Ceux qui financèrent l’attaque de Vienne par Soliman en 1529 étaient des gens de Constantinople mais provenaient d’Europe. » Et encore : « Des patrimoines de familles entières, accumulés pendant des générations et des générations, affluaient dans les caisses du sultan pour financer sa campagne contre les chrétiens ». Qui étaient-ils exactement ?
Des familles de marchands et de banquiers européens, qui s’étaient installées à Constantinople, précisément pour la très grande liberté du commerce dont on y jouissait. Le cas de l’attaque de 1529 n’est qu’un parmi tant d’autres ; le financement occidental aux sultans a été constant. Les témoignages d’époque sont très nombreux. Un des plus intéressants remonte à 1625 et c’est celui d’un drogman, autrement dit d’un interprète en langues orientales, le Vénitien Giovan Battista Salvago, qui a écrit au doge de Venise un rapport secret sur les royaumes barbaresques d’Algérie et de Tunisie. Les états barbaresques d’Afrique du Nord n’étaient que des républiques maritimes vivant de la piraterie, de confession musulmane et tributaires du sultan de Constantinople. Quand on lit le compte-rendu du drogman Salvago, il n’apparaît que trop clairement que les Ottomans et leurs vassaux, dans le secret des accords, étaient soutenus commercialement et logistiquement par ces mêmes puissances européennes qu’ils allaient ensuite combattre au grand jour dans les eaux de la Méditerranée. À qui pouvaient-ils acheter, en fait, tous les précieux produits manufacturés (armes, pièces de rechange pour les navires, ustensiles) indispensables à la navigation et à la guerre, sinon aux Européens ? N’est-ce pas aux marchands de Livourne qu’ils revendaient les esclaves dont ils n’avaient pas réussi à se défaire sur les autres places ? Et surtout, n’est-ce pas d’Italie qu’affluaient volontairement les milliers d’enrôlés qui, chaque année, abjuraient la religion chrétienne pour venir grossir les rangs des corsaires musulmans ? C’étaient eux qui indiquaient à leurs rais, les capitaines des impitoyables navires corsaires musulmans, comment pénétrer de nuit dans leurs villages d’origine, pour y surprendre dans leur sommeil et livrer à l’esclavage, leurs anciens concitoyens. Les plus grands corsaires musulmans ont été des Italiens : Occhiali, Cicala, Ali Ferrarese, Mami Ferrarese, pour n’en citer que quelques-uns. Pour se faire une idée de la politique à deux visages des États européens dans l’histoire militaire et commerciale de la Méditerranée, on peut lire la précieuse contribution de l’historienne Mirella Mafrici, Mezzogiorno e pirateria nell’età moderna (Edizioni Scientifiche Italiane, 1995)**
Donc, le phénomène de l’adhésion spontanée de jeunes occidentaux aux milices islamiques, qui touche aujourd’hui tant d’États européens, a d’importants précédents historiques. On passe ainsi de la haute politique aux vicissitudes personnelles et familiales. Vos livres contiennent quelques évocations biographiques réellement hors du commun, qui s’entrelacent continuellement avec l’histoire d’Italie.
Effectivement, nous sommes tombés sur des histoires qui paraissent conçues pour un livre d’aventures ou d’espionnage, et qui pourtant sont non seulement réelles mais sont même exemplaires. Un nom qui vient tout de suite à l’esprit est celui de Giuseppe Nassi***, qui a non seulement financé généreusement les sultans pour qu’ils anéantissent l’Occident chrétien, mais qui a aussi organisé et subventionné des opérations de déstabilisation en Europe, au bénéfice des Ottomans. C’était un banquier marrane qui avait vécu à Venise, où il se faisait appeler Giovanni Miches. Il prêtait de l’argent aux gouvernements et aux monarques de la moitié de l’Europe. Mais il avait été expulsé de la Sérénissime République parce qu’on l’y soupçonnait de tramer des complots contre les Vénitiens et d’avoir fait incendier et exploser, dans un attentat d’une très grande audace, l’arsenal de la Sérénissime. Les Vénitiens lui avaient donc interdit de mettre le pied dans aucune de leurs possessions en Méditerranée, sous peine d’être pendu comme infâme sur la place Saint Marc, devant le palais du Doge. Exilé de Venise, Nassi s’était établi à Constantinople avec sa très puissante tante Gracia Nassi, héritière de la famille Mendes, une des plus riches dynasties de banquiers du continent. Nassi avait ainsi apporté en dot aux Turcs un immense patrimoine, sans parler du réseau d’affaires et de contacts de sa banque, pour laquelle travaillait une véritable armée de comptables, d’employés, de laquais, de parents et de serviteurs. À Constantinople, grâce son immense fortune, il lui avait été facile de se concilier les faveurs du sultan, grâce aussi à l’aide du médecin de ce dernier, le rabbin Moshe Hamou. Nassi s’est très vite servi de toute son influence pour attiser des guerres entre les États européens, ainsi qu’entre eux et la Sublime Porte, mais par-dessus tout pour préparer la guerre contre Venise. Du reste, il était passé maître dans l’art d’allumer des conflits quand il avait à régler des comptes personnels. Lorsque le roi Henri II de France a un jour tardé à lui rembourser un prêt, Nassi, en guise de rétorsion, s’est arrangé pour faire saisir par les Turcs les navires français qui relâchaient dans les ports du sultan. Pour déstabiliser l’Espagne, grand adversaire du sultan, il a fomenté la Guerre de Quatre-Vingts Ans. Depuis Constantinople, Nassi préparait soigneusement sa revanche contre Venise. C’est ainsi qu’il a conseillé au sultan Selim de faire la guerre à la Sérénissime pour prendre le contrôle de Chypre, précieux joyau des Vénitiens face aux côtes turques. Puis, par l’intermédiaire de ses correspondants secrets à Venise, il a manœuvré pour que la Sérénissime n’envoie pas les renforts promis à Chypre, alors qu’ils étaient stationnés non loin de là, sur l’île de Crète. C’est de cette façon que, grâce à Nassi, Chypre est tombée aux mains des musulmans. Tout cela a été reconstitué avec une précision remarquable par l’historien Cecil Roth.
Dans votre troisième roman, Veritas, le lecteur apprend que ceux qui ont allumé le feu de l’agression musulmane contre l’Empire des Habsbourg dans la seconde moitié du XVIe siècle, en particulier contre l’empereur Maximilien II de Habsbourg, étaient les princes protestants allemands et quelques-uns de leurs émissaires secrets, qui entouraient Maximilien en qualité de ministres et de conseillers. Vous dites qu’après avoir essayé sans succès de le convertir au luthérianisme, ils se sont vengés en déchaînant contre lui les armées turques. Comment les choses se sont-elles réellement passées ? Peut-on parler d’une convergence historique des intérêts de l’Islam et du luthérianisme ?
Dans la mésaventure de Maximilien, on ne peut pas ne pas être ébahi par l’œuvre de pollution politique et financière qu’ont déployé autour de lui quelques protestants purs et durs en faveur des forces ottomanes, et ce avec des conséquences incalculables. Maximilien II, neveu de Charles Quint, n’était pas destiné à la couronne impériale, qui aurait dû revenir à son cousin Philippe II, fils de l’illustre empereur. Mais les princes-électeurs allemands ne voyaient pas d’un bon œil Philippe, qui était un catholique déclaré, et ils avaient réclamé à grands cris le trône pour le jeune Maximilien, autour duquel, depuis plus d’une décennie, avec patience et minutie, ils avaient réussi à introduire des instructeurs au protestantisme plus ou moins dissimulé. Et Maximilien, comme on pouvait s’y attendre, une fois arrivé à l’âge adulte, avait laissé se multiplier autour de lui prédicateurs, conseillers, médecins et hommes de science luthériens, si bien qu’on donnait pour certain qu’une fois sur le trône, il passerait dans les rangs des réformés. Mais Maximilien, après son élection à l’empire (en juillet 1564) a choisi une voie différente : il s’est déclaré simplement chrétien, sans soutenir ni la Contre-Réforme ni le luthérianisme. Choix difficile, orienté vers une recherche de la paix et de la tolérance. Quelques mois plus tard est arrivée la vengeance. En 1565, l’agent diplomatique impérial David Ungnad, fervent protestant, a communiqué, de Constantinople, la nouvelle alarmante que Soliman le Magnifique était en train de mettre en place une armée puissante et très efficace de cent mille hommes, avec laquelle il s’apprêtait à marcher sur Vienne. Maximilien a aussitôt ordonné la mise sur pied d’une armée d’égale importance. Quelque temps après, le vice-payeur impérial, c’est-à-dire le collecteur-adjoint des ressources financières, Georg Ilsung s’est présenté en personne devant Maximilien avec l’annonce surprenante que, grâce à ses contacts étroits avec les banquiers allemands les plus puissants tels que les Fugger (ils étaient d’Augusta, comme Illsung lui-même) et en ajoutant ce qu’il avait puisé dans son patrimoine personnel, il était arrivé à réunir une armée de quatre-vingts mille soldats, avec promesse de renforts ultérieurs. Maximilien, radieux, a aussitôt promu Illsung payeur impérial en chef, faisant ainsi de lui l’homme-clé des finances impériales. Mais quand l’empereur s’est retrouvé en Hongrie, sur le point de lancer ses troupes contre celles commandées par Soliman, on l’a vu hésiter et choisir inexplicablement de se retirer, tandis que les Ottomans lui arrachaient les importantes forteresses de Szigetvár et de Gyula. C’est alors que rompant avec tous les usages, Maximilien a décidé de se justifier publiquement et donné l’explication du mystère : quand il avait voulu passer personnellement en revue les forces dont il disposait, il s’était aperçu que les soldats enrôlés dans son armée n’étaient pas quatre-vingts mille mais moins de vingt-cinq mille. Illsung lui avait menti. En outre, leurs équipements étaient exécrables, et, des renforts promis, il n’y avait pas trace. Pour ces motifs, Maximilien II avait décidé de se retirer. Vingt-cinq mille contre cent mille : ç’eût été un massacre, avec, par-dessus le marché, le risque que les Ottomans, une fois exterminée l’armée chrétienne, poussent jusqu’à Vienne et, la trouvant dégarnie, la prennent d’un seul coup.
Que s’est-il passé ensuite ?
Les surprises n’étaient pas finies. L’empereur avait découvert, mais trop tard, alors que l’armée était déjà sur le chemin du retour, qu’Ungnad aussi lui avait menti : des soldats ottomans faits prisonniers par les forces impériales sur le chemin de Vienne, avaient révélé que l’armée ottomane était loin d’être considérable et fortement armée. Parmi les Turcs, il y avait beaucoup de soldats sans armes et, surtout, il y avait énormément de très jeunes garçons que terrorisait l’ennemi chrétien. Mais surtout, on avait caché à Maximilien le fait le plus sensationnel, à savoir qu’au cours de la campagne militaire, Soliman le Magnifique était mort. Depuis au moins deux mois et l’empereur n’en avait rien su. C’est par un étranger - l’ambassadeur de la République de Venise - qu’il a été informé de la mort de Soliman. La nouvelle était arrivée dans la lointaine Innsbrück trois jours avant d’atteindre le camp de l’empereur, qui se trouvait à deux pas du camp ottoman. Et cela, en dépit du fait qu’Ungnad n’avait cessé de faire la navette entre les deux armées. Ainsi, l’armée de Maximilien n’avait pas pu exploiter le bouleversement de l’armée ottomane, lorsqu’elle s’était tout à coup trouvée sans chef. En réalité, quand il avait quitté Constantinople, Soliman était déjà moribond, mais de cela non plus Ungnad n’avait rien dit. Par ailleurs, qu’est-ce qui avait poussé le sultan à risquer une opération militaire à l’article de la mort ? Avait-il reçu l’information mensongère que Maximilien II était sur le point d’envahir ses territoires ? L’Histoire nous enseigne que, quelquefois, quand deux parties se combattent, c’est une troisième qui ramasse la mise. On a vu trop souvent décider du sort des guerres celui qui faisait la navette entre les combattants, que ce soit pour transmettre des nouvelles, pour s’occuper du ravitaillement ou des fournitures militaires.
Mais même après la justification publique de sa défaite militaire, Maximilien n’a pas pu se libérer de ses conseillers infidèles, dont il dépendait toujours pour trouver rapidement des capitaux frais, pour obtenir l’échelonnement de dettes encore dues ou pour solliciter de nouveaux prêts des Fugger, non sans leur abandonner en garantie les rentrées des douanes et les recettes des mines impériales de mercure d’Idrija. L’argent, cependant, arrivait toujours au compte-gouttes, maintenant l’administration et l’armée impériales dans un état constant de pénurie. Quant à la cassette personnelle de l’empereur, Illsung l’avait confiée à un élève d’Ungnad, David Hag, payeur de la Cour, qui a géré les fonds du souverain de manière extrêmement suspecte. À sa mort, survenue en 1599, plus de vingt ans après la disparition de Maximilien, on s’est aperçu que Hag s’était contenté d’enregistrer dans les registres comptables, les seules dépenses de l’empereur et jamais ses rentrées : il est plus que probable qu’ont été ainsi soustraites à Maximilien d’énormes sommes d’argent. Il est facile de comprendre qu’en l’absence de personnages aussi déloyaux qu’ Ungnad, Illsung et Hag, l’Empire des Habsbourg se serait acquitté bien différemment de son rôle de rempart contre les Ottomans.
Tout ceci cependant concerne encore ce que vous avez appelé « l’échelon supérieur» de l’instrumentalisation des Ottomans par les Occidentaux. Que peut-on dire de « l’échelon inférieur » ?
À l’échelon inférieur, il suffit de lire les observations des voyageurs européens en Turquie du XVIIe au XIXe siècles. La princesse Cristina de Belgioioso, a assisté à des procès faits à des délinquants de droit commun, et elle disait avoir eu l’impression que, parmi les Ottomans, le criminel n’était pas un homme d’une trempe différente de celle du sage. Les bandits turcs avaient un regard plus sûr qu’elle-même, qui les observait lorsqu’ils étaient à la barre. Cristina n’a par conséquent pas pu manquer de voir, dans ces gens, des « hommes d’une nature différente de la nôtre, qui ignoraient réellement la signification des mots chrétiens de vice et de vertu ».Ayant eu affaire aux Ottomans, dit la princesse de Belgioioso, « je me rendis compte, hélas, qu’au sein d’une civilisation presque aussi vieille que la civilisation chrétienne, mais fondée sur des bases complètement différentes, on rencontrait ce phénomène : l’homme sans conscience ! ». Voilà. Il est certain que l’homme sans conscience est un excellent instrument, facilement manipulable. C’est pourquoi il a été si commode à l’Occident d’aller le cultiver dans les populations exotiques et puis de le lancer aux frontières de l’Europe, pour y poursuivre ses fins perverses d’(auto) destruction. Cette instrumentalisation est évidente jusqu’à dans la politique intérieure de l’Empire ottoman, qui était en contradiction stridente avec sa politique extérieure. Comme tout empire, d’ailleurs, l’Empire ottoman n’était qu’un immense creuset à filtration basé sur un système féodal. Le sultan, souverain absolu, était représenté dans les provinces par un réseau de régisseurs, qui étaient loin d’être loyaux : les derebey, petits hobereaux agités et féroces, perpétuellement en révolte contre lui. Ils s’emparaient de la collecte des impôts qui auraient dû lui être versés, refusaient d’obtempérer aux demandes de recrutement du gouvernement central, enrôlant au contraire des troupes pour leurs armées personnelles ; ils avaient leurs propres étendards et des uniformes à eux, et il leur arrivait souvent de partir en guerre contre le sultan lui-même. Presque toute l’Asie Mineure est divisée en un petit nombre de ces derebey. Pour ne rien dire des territoires de montagne, où on ne répondait même pas aux appels aux armes. Dans la région du Ghiaour-Dagh, à la frontière entre la Turquie et la Syrie actuelle, pas un seul montagnard n’endossait l’uniforme et ne daignait payer un seul para - la quarantième partie d’une piastre - au trésor impérial. Quand le sultan essayait de les ramener à l’obéissance, les habitants des hauteurs se repliaient vers les sommets, laissant l’armée régulière errer sur leurs terres abandonnées. Ou bien ils se déchaînaient en masse contre les armées du sultan, dans la proportion de vingt-cinq mille montagnards pour un millier de soldats, ce qui suffisait habituellement à mettre fin aux hostilités et à rétablir la paix avec Constantinople. Le calme durait jusqu’au recrutement suivant ou à la prochaine échéance des taxes qui faisait inévitablement recommencer la guerre. L’Empire ottoman comptait de nombreuses populations de ce genre, ce qui suffit à faire comprendre à quel point il est absurde de prétendre que les Ottomans étaient prêts à envahir les nations voisines. C’est le contraire, en fait, qui est vrai : la Sublime Porte avait d’énormes problèmes intérieurs qui auraient dû lui déconseiller toute action de guerre vers l’extérieur. S’étendre à tout prix en Europe, comme l’ont pourtant fait les sultans, en menaçant Vienne, Venise et la Hongrie, alors qu’à peu de lieues de Constantinople, leur empire était totalement ingouvernable, signifie que le but principal n’était pas la conservation de l’Empire ottoman mais la destruction, ou mieux, la déstabilisation de l’Europe chrétienne.
Le terme « déstabilisation » nous ramène encore une fois avec force au présent…
C’est précisément pour cela que nous avons lancé notre appel : l’Histoire doit nous instruire ! Pendant la guerre de Succession d’Espagne, entre 1700 et 1714, lorsqu’est morte l’Europe d’ancien régime et qu’est née celle d’aujourd’hui, les puissances maritimes et commerciales, in primis l’Angleterre, avaient intérêt à déstabiliser les deux adversaires majeurs du conflit, l’Empire des Habsbourg et la France, pour empêcher que le vainqueur, quel qu’il fût, puisse conquérir une position dominante. Le pouvoir anglais se fondait sur le commerce, sur le libre-échange, qui réalise ses gains les plus importants justement par la guerre et par l’affaiblissement des voisins, lesquels peuvent être, bien sûr, envahis militairement, mais qui peuvent l’être aussi au moyen du soft power du commerce et de la culture, sans qu’il soit jamais en mesure de rendre la pareille. La guerre pulvérise les rapports économiques, toutefois, il est bien connu qu’il existe des trafics à grand rayon d’action qui rentabilisent au maximum l’affaiblissement des Nations. Karl Kraus a traité avec une maestria épique, dans Les derniers jours de l’humanité (Agone, 2005), les flopées de « larves, hyènes et lémures » (comme il les appelle) qui se sont enrichis, pendant la Grande Guerre, grâce à la pénurie, au marché noir et aux commandes militaires. Nos grands-parents savaient bien que quand les champs sont rendus stériles par les incursions, les incendies et les dévastations belliqueuses, les peuples tombent dans la toile d’araignée des spéculateurs et des usuriers, qui font payer les marchandises à cinquante fois leur valeur. Et quand les dettes étaient contractées par des rois, il n’était pas rare que des financiers reçoivent, en récompense, des titres nobiliaires. Après une décennie de guerre, les puissances mercantiles sorties victorieuses de la Guerre de Succession d’Espagne, c’est-à-dire surtout l’Angleterre, ont réussi à mettre la France économiquement à genoux, avec l’aide diabolique du terrible hiver de 1709. Et dire qu’à l’époque, on ne connaissait pas les guerres climatiques ! Il a suffi d’ajouter au tableau quelque assassinat de souverain, et les puissances commerciales ont acquis une domination planétaire, qui, sous des formes diverses, dure encore.
Un de vos romans qui doit sortir prochainement, Dissimulatio, est consacré au coup d’État. Rita Monaldi et Francesco Sorti, qu’est-ce que c’est, pour vous, la politique ?
C’est plus un éclair qu’un discours. Le cardinal Mazarin disait que la politique tient tout entière dans deux mots : simula et dissimula.
Interview réalisée par Gabriele Palasciano.
_________________
* Traduits dans une demi douzaine de langues mais toujours inédits dans leur français d’origine (NdT)
** Inédit en français.
*** Considéré comme le précurseur des sionistes.
Source : http://www.cortiledeigentili.com/intervista-a-rita-monald...
Traduction : c.l. pour Les Grosses Orchades

Pour en savoir plus sur Rita Monaldi et Francesco Sorti, voir notre post du 1er janvier 2014 : http://lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.skynetblogs....

« La Cour des Gentils » est une structure du Conseil Pontifical de la culture, qui l’a créée à Paris les 24 et 25 mars 2011, sous les auspices de l’UNESCO, pour favoriser les rencontres et le dialogue entre croyants et non croyants.
L’idée vient du pape Benoît XVI, qui s’est inspiré d’une cour du temple de Jérusalem où, il y a 2000 ans, les non-juifs (Gentils) pouvaient suivre la liturgie du culte, écouter les chants et interroger les docteurs de la Loi. Le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil Pontifical de la culture a été chargé de développer cette structure, dont les activités consistent à faire se rencontrer des personnes de convictions diverses.
Les thèmes proposés aux discussions sont liés aux grands défis posés par la société actuelle et aux aspirations que partage l’humanité.

Mis en ligne le 11 février 2016.
23:32 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |















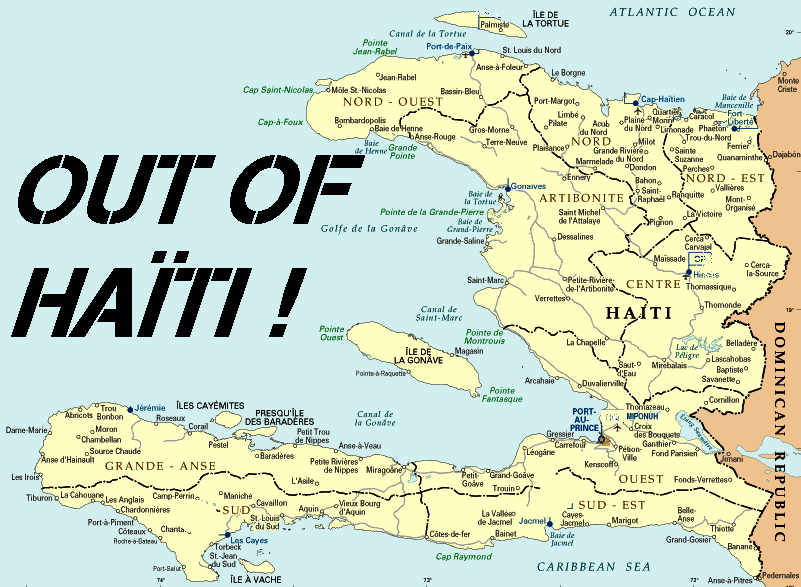







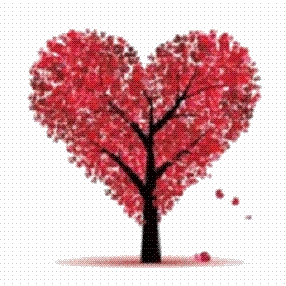
Les commentaires sont fermés.