02/05/2016
LE PASSÉ QUI NE MEURT PAS
Le passé qui ne meurt pas :
Des fragments d’URSS sur la carte de l’Europe

Nagorno Karabakh – Transnistrie – Abkhazie – Ossétie du Sud
Cesare Corda – Saker Italia – 5 avril 2016

Éparpillés dans les immenses territoires qui faisaient partie de l’Union Soviétique et, avant elle, de l’empire tsariste, il existe des coins du monde qui ont été oubliés par le progrès, où même l’histoire semble s’être arrêtée pour s’accorder une pause de réflexion.
Ce sont des fragments d’une civilisation qui n’existe plus, sinon dans la mémoire de ceux qui y ont passé et qui lui ont voué une partie de leur vie, pour ensuite – au début des années 90 – être projetés sans préavis dans une société complètement différente, compétitive, agressive, impitoyable, qui, en l’espace de peu d’années, a d’abord mis en doute puis répudié et ridiculisé, et enfin précocement jeté aux oubliettes, des usages, des idéologies, des modes de vie et de parler, de s'habiller et de penser, qui avaient été ceux de plusieurs générations de citoyens soviétiques et semblaient pouvoir durer au moins aussi longtemps encore.
Mais, presque par magie, par farce ou à cause de l’enchevêtrement chaotique des jeux de la géopolitique, quelques lambeaux de territoire ont été miraculeusement épargnés par la vague de la modernisation et de l’occidentalisation, et, résistant, indociles, ils portent témoignage de ce monde du passé auquel ils appartiennent encore orgueilleusement.
Transnistrie
En mars 2013, avec mes amis Giulio et Jacopo, nous sommes arrivés en voiture à Tiraspol, capitale de la Transnistrie, venant de Chisinau, capitale de la Moldavie.
Jusqu’en 1990, la Moldavie et la Transnistrie avaient formé, au sein de l’URSS, une seule république : la République Socialiste Soviétique Moldave. Et encore aujourd’hui, au niveau international, l’indépendance de la Transnistrie n’est reconnue officiellement par aucun pays.
Pourtant, depuis 26 ans déjà, un peu avant Bender et le fleuve Dniestr, passe une frontière bien gardée et les deux pays vivent désormais séparés de facto.

La Transnistrie, enserrée entre la Moldavie et l’Ukraine, et, plus au sud, la Gagaouzie. La Transnistrie contrôle un territoire de 3.567 kms2 (soit un peu moins que la Ligurie) pour une population de 550.000 habitants. La Gagaouzie, quant à elle, couvre un territoire de 1.832 kms2 et compte une population de 160.000 habitants.
Un vent fort et très froid soufflait en ce mois de mars à Tiraspol, mais le spectacle qui nous attendait valait infiniment plus que n’importe quel inconfort atmosphérique.
Pour qui avait, comme moi, commencé à visiter les républiques nées de la dissolution de l’URSS au début des années 90, ce fut une véritable remontée dans le temps.
En nous promenant sur la Prospekt principale de la ville, il nous semblait être revenus vingt ans en arrière. Les rues et les maisons semblaient être restées intactes pendant ces deux décennies, sans qu’aucune tentative de ravalement ait osé les contaminer. Les magasins exposaient leurs marchandises de manière simple et sans apprêt, comme à l’époque soviétique ou comme le faisaient – si quelqu’un s’en souvient – les magasins modestes de province, dans l’Italie des années 70. Les cafés et les restaurants, spacieux, vides, ouatés, d’une élégance vintage et nostalgique, où on aurait pu passer des journées entières à converser à mi-voix en sirotant de la vodka (précisément ce que nous avons fait, d’ailleurs pendant des heures et des heures, sans nous apercevoir que le temps passait – quelle importance cela pouvait-il avoir ? – seul le temps perdu est du temps gagné)… Le vieux cinéma soviétique où nous sommes entrés voir un film, je ne me rappelle même plus lequel, juste pour savourer l’atmosphère du lieu… La seule discothèque (ou serait-il plus juste de dire la seule salle de bal ?)… Jusqu’à la musique, qui était encore celle d’antan.
Nous avons passé plusieurs jours dans ce paradis perdu, à répéter chaque jour les mêmes lents rituels, dans le but de nous faire assimiler le plus complètement possible par les rythmes de cette ville qui nous avait temporairement phagocytés. Et c’est là, entre une petite vodka et l’autre, que nous avons pris la décision de visiter tous les « états non reconnus » qui étaient nés sur les ruines de l’URSS.

Le centre de Tiraspol, capitale de la Transnistrie, un jour de fête.
L’histoire de cet état et la manière dont il a obtenu son indépendance – comme toujours par une guerre plus ou moins cruelle – mérite d’être approfondie.
L’Union Soviétique était, en fait, composée, à un premier niveau de division administrative, de 15 républiques [1], mais chacune de ces républiques contenait à son tour de nombreuses régions et provinces dotées d’une condition plus ou moins haute d’autonomie (oblast, krai, etc.) ou formant elles-mêmes d’autres républiques mineures.
La dissolution de l’URSS, quoi que nous en ait raconté la presse occidentale, fut un événement non pas voulu mais au contraire subi par la très grande majorité des 15 républiques [2]. Ils étaient de loin les plus nombreux ceux qui auraient préféré continuer à vivre dans un état multi-ethnique, plutôt que se retrouver citoyens d’états nationaux à forte empreinte ethnique et nationaliste, souvent intolérants envers les minorités.
La Moldavie fut dans ce cas. D’après le recensement de 1989, vivaient en Moldavie une majorité de Moldaves-Roumains (64,5%) mais beaucoup d’entre eux s’étaient depuis longtemps russifiés et avaient préféré user du russe comme langue, plutôt que du roumain [3], une forte minorité slave de Russes et d’Ukrainiens (26,8%) et d’autres minorités moins importantes, parmi lesquelles des Gagaouzes (3,5%) et des Bulgares (2%).
En Transnistrie cependant (c’est-à-dire dans la mince bande de territoire à l’est du Dniestr) les rapports numériques étaient inversés, avec 54% de Slaves contre 40% de Moldaves (dont la majorité, cependant, était russophone).
La décision des autorités moldaves d’abolir le russe comme langue officielle en faveur du roumain, et, dans le même temps, de remplacer le roumain écrit en caractères cyrilliques (utilisé de tout temps en Moldavie) par le roumain écrit en caractères latins (utilisé en Roumanie), déchaîna les premières protestations, qui, rapidement, se muèrent en tumulte dans tout le pays.
En Transnistrie, en 1990, fut organisé un référendum sur l’indépendance vis-à-vis de la Moldavie, dont le résultat fut favorable à plus de 90% des voix. En vertu de quoi, le 2 septembre 1990, la Transnistrie déclara unilatéralement sa sécession et la formation d’une république indépendante.
Après la dislocation de l’URSS, la Moldavie, appuyée par la Roumanie, entreprit une campagne militaire pour reprendre le contrôle de la république sécessionniste. On vit alors combattre d’une part l’armée régulière moldave, renforcée de nombreux paramilitaires et volontaires roumains, de l’autre, la population civile de la Transnistrie, qui reçut cependant l’aide décisive de la 14e armée russe, laquelle était justement stationnée à Tiraspol sous les ordres du général Aleksandr Ivanovitch Lebed, et qui remporta une nette victoire sur l’armée moldave, allant même jusqu’à traverser la frontière naturelle représentée par le fleuve Dniestr, pour prendre possession de la ville à majorité russophone de Bender [4].
L’indépendance de la Transnistrie qui, qui dure depuis vingt-cinq ans, est aujourd’hui, cependant, mise en péril, du fait des déséquilibres politiques dans l’Ukraine voisine.
Comme on le voit, le territoire de la Transnistrie a une forme anormalement allongée et s’étend le long de la rive orientale du Dniestr.
L’Ukraine, dès le début des années 90, s’était fait protectrice, avec la Russie, de l’indépendance du petit pays contigu et de sa majorité d’habitants slaves (dont beaucoup étaient justement de nationalité ukrainienne).
Aujourd’hui, pour complaire à ses nouveaux alliés occidentaux, le nouveau gouvernement ukrainien a complètement renversé sa position à l’égard de la Transnistrie, allant même jusqu’à la menacer d’une intervention militaire unilatérale et non provoquée.
C’est ainsi que la Transnistrie se trouve coincée entre deux voisins hostiles (la Moldavie et l’Ukraine, auxquelles s’ajoute à présent la Roumanie), bien trop loin de la Russie, et avec un territoire véritablement difficile à défendre [5].
La demande d’annexion à la Russie (faite en 2014 par la Transnistrie suite à celle de la Crimée) n’a pas encore, à ce jour, été prise en considération, et la vulnérabilité du petit état se prête très bien à la création, par ses voisins hostiles, d’un casus belli.
Même la Moldavie voisine, cependant, ne peut pas être sûre de maintenir son intégralité territoriale. Une seconde région séparatiste, la Gagaouzie, habitée par une majorité de 82% de Gagaouzes [6] russophones opposés au processus de roumanisation forcée et de rapprochement avec l’U.E., menace depuis un certain temps de faire sécession elle aussi.

Dans les rues de Tiraspol
Nagorno Karabakh
Deux ans plus tard, en 2015, toujours à trois, nous avons décidé de visiter le Nagorno Karabakh [7], l’enclave arménienne en territoire azéri, théâtre d’une guerre sanglante qui s’est déroulée de 1988 à 1994, et s’est conclue par l’indépendance de facto de la République.
À la vérité, la guerre ne s’est jamais vraiment arrêtée et, comme dans le cas de la Transnistrie, la République du Nagorno Karabakh n’est reconnue par aucun état au monde. Justement, il y a quelques jours [de la mise en ligne de ce papier, NdT], les hostilités se sont soudain rallumées par une nouvelle agression de l’Azerbaïdjan, et ces hostilités sont toujours en cours avec pertes humaines des deux côtés.

Le Nagorno Karabakh occupe une superficie de 11.458 kms2 (un peu moins que le Trentin-Haut Adige)
Atteindre le Nagorno Karabakh n’est pas simple. La seule route praticable est celle qui part d’Erevan, capitale de l’Arménie, et, après huit heures de montées et de descentes dans les montagnes du Caucase, on arrive à Stepanakert, capitale de la République montagnarde autoproclamée.
Quand nous sommes arrivés en Arménie, c’était cette fois aussi le mois de mars et, après un substantiel repas dans le merveilleux centre historique d’Erevan suivi de la petite vodka rituelle, nous nous sommes arrangés sur le prix avec un taxi et nous avons mis le cap sur notre objectif.
Le premier tronçon de route est en plaine et court le long des pentes du mont Ararat [8] (la montagne sacrée des Arméniens, haute de 5.137 mètres, dont le nom signifie « Création de Dieu » en langue arménienne, mais qui, aujourd’hui, se trouve hors frontières, en territoire contrôlé par les Turcs).
Au bout de quelques heures cependant, la route commence à serpenter dans les montagnes enneigées du Caucase. Nous l’avons parcourue toute sans faire de halte, en sirotant de grosses bouteilles d’excellent vin arménien et en écoutant les souvenirs de guerre de notre taxi, qui était justement un montagnard du Karabakh. Plus d’une fois, il nous est arrivé de nous retrouver au milieu d’une colonne de blindés et d’autres véhicules militaires qui se dirigeaient vers le front, et plus d’une fois nous avons entendu des tirs (je ne sais pas s’il s’agissait de véritables escarmouches, qui sont par là à l’ordre du jour, ou de simples exercices par l’Armée de Défense du Nord Karabakh).
Nous sommes arrivés à Stepanakert au crépuscule et, après avoir trouvé à nous loger dans un modeste hôtel du centre-ville, nous avons commencé à parcourir la grande rue centrale, à la recherche d’en endroit où dîner.
La capitale du Karabakh est, si c’est possible, encore plus hantée et silencieuse que Tiraspol. Il s’agit en réalité d’un village de montagne isolé du reste du monde, situé dans un territoire où des opérations de guerre, quoiqu’à une échelle limitée, durent maintenant depuis près de trente ans. On y voit beaucoup de soldats, très peu de jeunes, de très rares lieux publics, des rues obscures qui se vident à la tombée du jour. Nous nous sommes longuement promenés dans ce lieu amène et élégiaque et, pour finir, nous avons réussi à nous restaurer dans une rustique pizzeria locale, qui servait une espèce de pizza turque ; après quoi, nous nous sommes transférés dans un sombre petit bar pour y finir la soirée, tandis que dans les rues non éclairées régnait un silence irréel.
Nous avons terminé la nuit dans la grande chambre quasi vide de notre hôtel. Nous n’avions guère de temps pour cette visite, notre intention étant de passer nos peu de jours disponibles dans la plaisante Erevan. C’est pourquoi, dès le lendemain matin, notre taxi nous attendait pour l’épuisant voyage de retour.
À cette heure du jour, la ville était plus animée et plus colorée. Nous avons fait une dernière promenade, y avons acheté quelques souvenirs et, après l’abondant déjeuner de rigueur et une brève visite au monument de Dedi Baba, nous avons repris la route. Nous avions prévu une brève halte dans la petite ville historique de Şuşa (Chouchi) pour visiter sa cathédrale et son monastère, avant de continuer vers l’Arménie où nous devions arriver dans la soirée.

Le centre de Stepanakert, capitale du Nagorno Karabakh
Le maintien de l’indépendance de l’isolé Nagorno Karabakh est depuis toujours en péril, dans des conditions par bien des côtés analogues à celles de la Transnistrie.
Les velléités indépendantistes s’y sont manifestées depuis 1988, quand l’URSS était en phase de désintégration. L’enclave arménienne, qui avait accepté de faire partie de la République Socialiste Soviétique d’Azerbaïdjan, dans le cadre d’une Union Soviétique multi-ethnique, n’avait nulle intention de faire partie d’un Azerbaïdjan indépendant et nationaliste, et aspirait par conséquent à se rattacher à sa mère-patrie la République d’Arménie. En 1991, au moment de la désintégration de l’URSS, la guerre couvait. Le parlement du Karabakh vota la sécession d’avec l’Azerbaïdjan et les Azéris, supérieurs en nombre, plus riches et mieux armés, envahirent la région avec l’appui de la Turquie. Stepanakert fut bombardée pendant de longs mois (précisément depuis Şuşa qui était un point d’appui azéri) et de vastes parties de la République tombèrent aux mains des Azéris. La ténacité des montagnards arméniens ne se démentit cependant jamais. En mai 1992, la prise de Şuşa permit de desserrer l’encerclement de la capitale et de rendre moins meurtriers les bombardements dont elle avait souffert quotidiennement, tandis que la conquête du village de Latchin, d’importance stratégique essentielle, permettait d’ouvrir une voie de communication avec l’Arménie. D’où affluèrent dès lors les soutiens militaires et les biens de première nécessité pour la population. La libération de Martakert suivie de celle d’Agdam, toutes les deux en 1993, ont marqué la victoire définitive de l’Arménie, consacrée par les accords de Bichkek et par un cessez-le-feu.
Il s’agit cependant d’une trêve fragile. L’Azerbaïdjan n’a jamais vraiment accepté la perte de la région. L’Azerbaïdjan est beaucoup plus riche et plus peuplé que l’Arménie, et grâce aux ressources que lui garantit l’extraction de son pétrole, il a un budget militaire potentiellement très supérieur. Il jouit en outre de l’appui de la Turquie, qui lui est apparentée par la langue, la religion et l’origine ethnique de sa population.
L’Arménie, en revanche, isolée sur les montagnes du Caucase et entourée d’états plus puissants qui lui sont hostiles, vit presque exclusivement des envois de fonds de la Diaspora arménienne [9] et est sujette à une dépopulation progressive, du fait que les jeunes préfèrent aller chercher fortune en Russie plutôt que rester dans leur pays, qui leur offre si peu de perspectives.
Le Nagorno Karabakh, tout comme la Transnistrie, a un avenir incertain et rempli d’embûches ; il se présente comme le lieu idéal où créer un casus belli [10] et rouvrir des hostilités sur une vaste échelle.

Dans les rues de Stepanakert
Abkhazie et Ossétie du Sud
Cette année, une nouvelle fois en mars et toujours avec Jacopo et Giuliano, j’ai visité l’Abkhazie.
En partant en voiture de la ville russe de Sotchi, le voyage ne dure que trois heures, par la route qui longe la Mer Noire et qui permet de contempler des paysages véritablement remarquables, avec les montagnes du Caucase qui descendent à pic dans la mer.
Ce que longe la partie russe de la route est une riviera constellée d’édifices modernes, de grands palais, d’hôtels et de résidences de luxe, mais dès que l’on passe la frontière avec l’Abkhazie, le spectacle change complètement. Commence alors le voyage de retour dans le temps qui nous fascine tellement.
Avant de partir, à Sotchi, beaucoup nous avaient déconseillé cette destination, soutenant qu’elle était risquée du fait de la présence de « brigands abkhazes » et de bandits qui arrêtent les voitures sur cette route pour voler les voyageurs. Il est possible que cela puisse effectivement se produire si on s’aventure dans quelque village perdu des montagnes, mais le long de la route principale qui relie Sotchi et la Russie à la capitale abkhaze, Soukhoumi, je tiens ce genre de rencontres pour invraisemblables. Nous, en tout cas, n’en avons pas fait, ni à l’aller ni au retour.
Soukhoumi est une gracieuse petite ville qui, comme Tiraspol et Stepanakert, rappelle par beaucoup de côtés la vie au temps de l’Union Soviétique. Pour qui cherche palais modernes, magasins à la mode et lieux de plaisir bruyants et très éclairés, ce n’est certes pas l’endroit idéal. On peut cependant y trouver de bons restaurants, un bord de mer très agréable, un centre historique intéressant, et surtout, on y retrouve cette atmosphère du passé qui, comme un voile transparent et protecteur, enveloppe la ville et la rend fascinante et un peu mystérieuse.
La proximité de la mer et la relative tranquillité de la région en font un lieu de villégiature possible, au remarquable potentiel touristique à très bon marché. Mais, jusqu’à présent, seuls quelques voyageurs – presque tous russes – ont découvert cet endroit.
Les villes maritimes italiennes du siècle dernier ressemblaient probablement assez fort à ce qu’est aujourd’hui Soukhoumi, et si on y ajoute quelque connaissance recommandée d’un peu de russe, il y a là une destination vraiment plaisante, où passer quelques jours loin des destinations touristiques traditionnelles, à savourer la cuisine locale dans quelque petit restaurant côtier, à se promener sur la plage et à déambuler dans les rues du centre historique.

L’Abkhazie a un territoire de 8.432 kms2 (un peu plus petit que les Abruzzes) et une population de 24.000 habitants. L’Ossétie du Sud a un territoire de 3.900 kms2 (plus ou moins l’étendue du Molise) et une population de 55.000 habitants.
L’Abkhazie et l’Ossétie du Sud (que nous n’avons pas encore visitée mais que nous nous proposons de visiter le plus tôt possible) faisaient partie, au temps de l’URSS, de la République Socialiste Soviétique de Géorgie. Celle-ci n’était pas habitée que par des Géorgiens, mais précisément aussi par des Abkhazes et des Ossètes (sans compter d’autres minorités ethniques de la très complexe mosaïque de peuples du Caucase).
Les Abkhazes sont un peuple caucasien présent dans la région depuis l’époque byzantine (en 780, ils ont fondé un premier royaume d’Abkhazie indépendant qui s’est maintenu jusqu’en 1008 [11] ; ils ont une langue à eux, qui appartient au groupe des langues caucasiennes nord-occidentales et, du point de vue religieux, ils se divisent en chrétiens orthodoxes et musulmans sunnites.
Les Ossètes, en revanche, proviennent de l’antique peuple des Alains [12]. Politiquement, ils sont partagés entre l’Ossétie du Nord, qui fait partie de la Fédération de Russie, et l’autoproclamée Ossétie du Sud, qui s’est détachée de la Géorgie. Ils sont de religion chrétienne orthodoxe et leur langue est similaire au persan.
De manière analogue à ce que nous avons vu pour la Transnistrie et pour le Nagorno Karabakh, ces deux régions, au moment de la fragmentation de l’URSS, se sont retrouvées à faire partie d’un état national – la Géorgie – avec lequel elles n’avaient aucune affinité.
La politique de georgianisation forcée entamée au début des années 90 a amené la déclaration d’indépendance, d’abord de l’Ossétie du Sud [13] (28 novembre 1991), puis de l’Abkhazie [14] (23 juillet 1992), et les guerres qui s’en sont suivies contre l’armée géorgienne, guerres qui, ici comme dans les cas évoqués précédemment, se sont soldées par la victoire des indépendantistes et leur sécession.

La plage de Soukhoumi, capitale de l’Abkhazie
En 2008 cependant, la Géorgie, alors gouvernée par l’aventurier pro-américain Saakashvili, a tenté un coup de main et attaqué par surprise (avec l’appui diplomatique US) la petite république de l’Ossétie du Sud, dont elle a bombardé la capitale Tskhinvali. Ce qui, on s’en souvient, a provoqué la réaction immédiate de la Russie, protectrice historique de la région, avec laquelle elle a une frontière en commun.
Les troupes géorgiennes ont été complètement défaites en seulement trois jours. Elles ont dû se replier sur leurs positions de départ et au-delà, tandis que la Russie se décidait à reconnaître l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud et à en assumer la tutelle. (Il s’agit donc là d’états partiellement reconnus [15] et non d’états non reconnus comme ceux évoqués plus haut.)
À la différence de celles de la Transnistrie et du Nagorno Karabakh, l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud n’est donc pas aujourd’hui en sérieux péril. Les deux minuscules républiques ont des frontières directes avec la Russie. Des troupes russes sont présentes sur leurs territoires, et l’éventualité d’une reprise des hostilités de la part de la Géorgie est actuellement très improbable, outre être privée de toute possibilité de succès réelle (à moins d’un appui peu vraisemblable de l’OTAN).

Une rue du centre de Soukhoumi. Les rues plaisantes et arborées du centre historique sont dominées par un édifice massif et sinistre : le palais orange qu’on voit au fond et qui est l’ancien siège du Parlement, à moitié détruit pendant la guerre 1992-1993, resté le symbole de l’indépendance témoignant des sacrifices qu’il faut affronter pour la conquérir et la conserver.
Républiques Populaires de Donetsk et de Lugansk
Pour compléter ces informations, au nombre des états non reconnus ou partiellement reconnus de l’aire ex-soviétique, il faut citer encore la République Populaire de Donetsk et la République Populaire de Lugansk [16], autoproclamées en 2014, suite au coup d’état de Maïdan en Ukraine.
J’ai personnellement visité Donetsk et sa région de nombreuses fois avant la guerre et l’indépendance. Donetsk alors n’avait pas grand-chose en commun avec les « fragments d’URSS » décrits dans les pages précédentes, étant de loin la ville la plus riche et la plus moderne de l’ex-Ukraine, avec des infrastructures (je pense à son stade, à son aéroport, à ses centres commerciaux, aujourd’hui totalement ou partiellement détruits par les bombardements sauvages, y compris de ses zones d’habitation, de l’armée ukrainienne), qui auraient pu faire envie à bien des villes d’Europe occidentale.
Évidemment, la guerre et l’indépendance auront bouleversé le Donetsk que je connaissais jusqu’à en changer totalement le visage. Je pense qu’il s’impose de le revisiter le plus vite possible. J’espère pouvoir en faire bientôt la chronique, comme l’ont déjà fait tant de mes compatriotes qui, au cours de ces deux années de guerre, se sont rendus au Donbass pour y apporter de l’aide humanitaire, voire, dans certains cas, pour y combattre dans les rangs de la Résistance aux escadrons de la mort ukrainiens.
___________________
NOTES
[1] Russie, Ukraine, et Biélorussie, les trois grandes nations slaves. Lituanie, Lettonie, Estonie, les trois républiques bordant la Mer Baltique. La Moldavie, dont la frontière occidentale touche la Roumanie. La Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan au Caucase. Et enfin, les cinq républiques centre-asiatiques : Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan.
[2] À l’exception des trois républiques baltes, où, effectivement, la majorité des populations était favorable à l’indépendance (sans toutefois tenir compte des fortes minorités russophones, surtout en Lettonie et en Estonie, qui ont au contraire vécu de façon traumatique la séparation d’avec la mère-patrie et qui, depuis lors, vivent dans un état de semi-apartheid légalisé, honte sans précédent pour l’Europe « démocratique »). Dans toutes les autres républiques, la majorité des populations était favorable au maintien de l’URSS. Dans neuf des quinze républiques (Russie, Ukraine, Biélorussie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Tadjikistan et Turkménistan) fut même organisé, en 1991, un référendum, qui donna partout une large majorité favorable au maintien de l’URSS.
[3] Aujourd’hui encore, quand on se promène à Chisinau, capitale de la Moldavie, on entend parler roumain autant qu’en russe. Dans les campagnes de la Moldavie, le roumain est la principale langue véhiculaire. En Transnistrie, Gagaouzies et dans les municipalités baltes, on parle au contraire principalement le russe.
[4] Ville natale de l’écrivain russe Nicolaï Lilin, qui y a situé certains de ses romans.
[5] La Transnistrie, distante de plus de 500 kms à vol d’oiseau de la frontière russe continentale la plus proche, et qui n’a pas de débouché sur la mer. Sans la collaboration de l’Ukraine, elle est donc militairement indéfendable par la Russie. En réalité, considérant le fait que toute l’Ukraine sud-orientale, de Kharkhov à Odessa, est russophone et russophile, après un hypothétique démembrement de l’Ukraine et un retour de ses régions orientales et méridionales dans l’orbite russe, un continuum territorial avec la Transnistrie serait réalisable.
[6] Les Gagaouzes sont une population d’ethnie turque mais de religion chrétienne orthodoxe et de langue principalement russe (il existe cependant une langue gagaouze, qui a des affinités avec le turc), qui ont migré en Moldavie et dans le Boudjak au début du XIXe siècle en provenance de Bulgarie et d’autres régions qui appartenaient alors à l’empire ottoman.
[7] Cette région montagneuse du Caucase méridional faisait partie du Royaume d’Arménie depuis 190 avant notre ère. Aujourd’hui, elle est encore habitée par des Arméniens et sa langue officielle est l’arménien, mais utilisée là dans sa version orientale.
[8] Selon la légende, c’est sur cette montagne qu’a échoué l’Arche de Noé, après le Déluge Universel.
[9] En fait, sur neuf millions d’Arméniens, seuls trois millions vivent en Arménie. Trois autres millions vivent en Russie, presque un million aux USA, un demi-million en France, 150.000 au Nagorno Karabakh. Il existe aussi de fortes minorités arméniennes en Géorgie, en Iran et en Syrie, tandis que la très nombreuse communauté arménienne de Turquie a été complètement exterminée par les Jeunes Turcs pendant le génocide arménien de 1915-1916 qui a fait environ 1,5 millions de victimes. Suite au refus de la Turquie de reconnaître ce génocide, les relations diplomatiques entre l’Arménie et la Turquie ne sont toujours pas à ce jour normalisées, et la frontière entre les deux pays est fermée et militairement gardée.
[10] En 2014, en plein milieu de la crise ukrainienne, le Département d’État américain a fait très fortement pression sur l’Azerbaïdjan, pour qu’il ouvre un second front au Nagorno Karabakh et, seule la convocation soudaine en août à Sotchi, par Poutine, du président de l’Arménie Serzh Sargsyan et de celui de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev a évité le pire au dernier moment. Depuis quelques jours cependant, une nouvelle escalade a débuté (2 avril 2016), sous forme d’une agression azeri inattendue contre le Karabakh, deux jours exactement après la rencontre du Secrétaire d’État US John Kerry et du président de l’Azerbaïdjan Aliyev à Washington, pour y... discuter des modalités d’une solution au Nagorno KIarabakh. Cette agression est toujours en cours.
[11] À cette date, l’Abkhazie est entrée pour la première fois dans l’orbite géorgienne. Elle a reconquis son indépendance au XIIe siècle, pour la reperdre au siècle suivant à cause de la conquête ottomane.
[12] Peuple nomade de pasteurs guerriers d’origine iranienne, ils sont mentionnés pour la première fois dans la Géographie de Strabon au 1er siècle de notre ère. Au IXe siècle, ils ont formé, sur les montagnes du Caucase, un royaume chrétien qui a duré jusqu’à la fin du XIIIe siècle, quand il fut absorbé par la Horde d’Or mongole.
[13] La guerre d’Ossétie du Sud a duré du 5 janvier 1991 au 24 juin 1992. Les troupes de l’Ossétie du Sud, appuyées par des volontaires venus de l’Ossétie du Nord et avec le soutien de la Fédération de Russie, ont fini par défaire l’armée géorgienne.
[14] La guerre en Abkhazie a duré du 14 août 1992 au 27 septembre 1993. Les troupes abkhazes étaient flanquées de celles de la Confédération des Peuples des Montagnes du Nord-Caucase (Конфедерация горских народов Кавказа) et du bataillon Bagramian, composé de volontaires arméniens résidents en Abkhazie, et elles eurent raison de l’armée nationale géorgienne.
[15] Les deux républiques ont été reconnues non seulement par la Russie, mais également par le Vénézuela, le Nicaragua, les républiques océaniennes de Nauru et de Vanuatu, et la république polynésienne de Tuvalu.
[16] Ces deux états, de formation récente quoique occupant des régions assez limitées à cause de l’agression ukrainienne qui leur a arraché beaucoup de circonscriptions (à ce jour, les territoires sont de 8.550 kms2 pour la République de Donetsk et d’environ 8.350 kms2 pour la République de Lugansk) sont, de très loin, les plus peuplés des états non reconnus. La République de Donetsk compte en fait 2.3 millions d’habitants, et celle de Lugansk, 1.5 million.
Source : http://sakeritalia.it/sfera-di-civilta-russa/il-passato-c...
Traduction : c.l. pour Les Grosses Orchades

Meuh, non, ils n’essaient pas du tout de déclencher une guerre atomique mondiale !
L’Estonie accueille les troupes de l’OTAN près de la frontière russe
RT en français – 2 mai 2016

Les pays-membres de l’alliance envoient leur contingent militaire en Estonie pour y mener des exercices militaires, baptisés «Spring storm» et qui mobiliseront 6 000 militaires jusqu’au 20 mai.
L'Etat-major estonien des Forces armées a annoncé le début des exercices militaires le 2 mai dans le sud-est du pays, dans les comtés de Tartu, Voru et Polva qui se trouvent dans une zone frontalière de la Russie.
Source : https://francais.rt.com/international/19946-estonie-accue...

Le présent qui ne veut pas mourir
Pour une fois, on va chercher le commentaire à droite :
Le temps des coups d’État rampants
Le cas Dilma
Jérôme Leroy – ANTIPRESSE – 24 avril 2016

Finalement, aujourd’hui, quand on veut faire un coup d’État, on n’a plus besoin du folklore sanglant de jadis : des chars dans les rues, des paras surarmés aux carrefours, des étudiants parqués dans les stades, des ministres arrêtés au petit matin et deux ou trois brutasses galonnées, si possible en lunettes noires, pour parler sur une unique chaîne de télévision et que les stations de radio diffusent de la musique classique.
Ça, c’était dans le monde d’avant, l’archétype du coup d’État ayant eu lieu un 11 septembre 1973, au Chili. En général, le coup d’État est de droite pour une raison simple : l’armée est rarement de gauche et quand la gauche arrive au pouvoir, c’est toujours considéré par la droite comme un horrible accident de parcours qui trouble l’ordre légitime des choses. Certes, le coup d’État, aussi appelé putsch ou pronunciamiento, est parfois de gauche comme en Russie en 1917 ou au Portugal en 1974. Mais il est suivi d’un processus révolutionnaire alors que le coup d’État de droite est suivi d’un processus réactionnaire. C’est toute la différence par exemple entre Pinochet à Santiago et les capitaines d’avril au Portugal, un guitariste aux doigts tranchés et un œillet dans le canon d’un fusil d’assaut.
Maintenant, en matière de coup d’État, les choses sont à la fois plus compliquées et plus simples. Plus compliquées parce qu’à l’époque d’Internet, il est tout de même très difficile de verrouiller l’information et de fermer ses frontières, même temporairement, deux choses absolument nécessaires quand vous voulez faire le ménage chez vous et apprendre aux partageux de toutes sortes à filer droit. Mais c’est aussi plus simple car l’information n’a plus besoin d’être verrouillée puisqu’elle est entre les mains de quelques-uns et que les banques, par exemple, sont plus efficaces que les blindés pour mettre à genoux un pays.
Souvenons-nous de l’année dernière, en Grèce. Des gens très polis, avec de jolies cravates dans des bureaux climatisés de Bruxelles ont expliqué très calmement mais très fermement à Alexis Tsipras que demander son avis à son peuple n’était pas une chose à faire et que s’il ne signait pas sur le champ un memorandum leur permettant de presser la Grèce jusqu’à la dernière goutte, ils allaient renvoyer son pays à l’âge de pierre en coupant les liquidités : bref, on a vu comment un distributeur de billets vide était plus efficace qu’une mitrailleuse lourde pour faire courber l’échine à toute une population.
Le coup d’État est même parfois invisible, ou presque. Si on accepte comme définition le fait d’imposer à un pays le contraire de ce pour quoi il a voté, il y a eu un coup d’État en France le 8 février 2008. Après avoir fait réviser la Constitution le 4, le président Sarkozy faisait ratifier le traité de Lisbonne par voie parlementaire quatre jours plus tard, traité de Lisbonne qui était, on s’en souviendra, une resucée à peine modifiée du TCE rejeté par 55% des électeurs moins de trois ans plus tôt.
Un renversement postmoderne
Un de ces coups d’État new-look, postmoderne pourrait-on dire car il rompt avec les formes anciennes de l’Histoire, se déroule en ce moment au Brésil et c’est la présidente Dilma Rousseff qui risque bien d’en être la victime. Il se trouve que Dilma Rousseff est de gauche, membre du PT (Parti des Travailleurs) au pouvoir au Brésil depuis la première élection de Lula en 2002. Sur le plan politique, le bilan du PT est loin d’être honteux si l’on songe à l’état du Brésil au moment de son arrivée. Un des pays les plus inégalitaire au monde a, tout en respectant l’orthodoxie financière exigée par un FMI toujours aux aguets, réussi à augmenter sa croissance de manière significative, à électrifier l’ensemble du pays et surtout, grâce au programme Bolsa Familia, réduit considérablement l’extrême pauvreté et fait disparaître la faim et la mortalité infantile, tout simplement en conditionnant une aide financière aux familles à la scolarisation et la vaccination des enfants. C’est tout bête, la gauche, la vraie : c’est se demander pourquoi des pays riches produisent des pauvres et se dire qu’il doit y avoir quelque part un problème de redistribution et de répartition. Les choses furent plus difficiles pour Dilma Rousseff mais, malgré tout le bilan est là. Évidemment, il y a eu le scandale Petrobras qui a vu des dignitaires du PT se servir dans la caisse de la grande compagnie pétrolière. Ce n’est pas bien, pas bien du tout.
Mais on remarquera deux choses. La première, c’est que les prédécesseurs du PT faisaient la même chose mais il ne leur serait pas venu à l’idée d’aller envoyer dans les favelas autre chose que des escadrons de la mort. Au moins, la différence entre un corrompu de gauche à la brésilienne et un corrompu de droite, c’est que le corrompu de gauche garde un certain surmoi social. Il se goinfre mais il ne laisse pas les pauvres le ventre vide. On préférerait de vertueux incorruptibles, bien sûr, mais en même temps ce n’est pas nous qui mourrons de faim.
La seconde, c’est que Dilma n’est pour rien dans l’affaire Petrobras. En fait on lui reproche d’avoir maquillé les comptes du pays en finançant des dépenses budgétaires par des emprunts aux banques publiques afin de faciliter sa réélection. Bon, ce n’est pas pour dire mais si cela suffisait à destituer un chef d’État, procédure actuellement en cours au Brésil, nombre de dirigeants européens auraient du souci à se faire. De plus, les députés qui viennent de voter la procédure d’empêchement, eux, pour le coup, sont impliqués dans des affaires de corruption et d’enrichissement avérées.
En plus, quand par hasard on nous parle de la situation au Brésil, c’est pour nous montrer les manifs anti-Dilma et anti-PT en nous parlant de la colère du peuple brésilien face à la malhonnêteté de ses dirigeants et à la politique d’austérité qu’ils font régner. Ce ne sont pas pourtant pas ceux qui souffrent le plus au Brésil, ces manifestants. Le journal Zero Hora nous apprend que 40 % d’entre eux gagnent plus de 10 fois le salaire minimum et que 76 % ont voté en faveur du candidat de droite Aécio Neves lors de la dernière élection présidentielle de 2014. Et l’on est beaucoup plus discret sur les rassemblements pro-Dilma tout aussi nombreux. Serait-on en présence, très banalement, d’une lutte des classes à l’ancienne avec une bourgeoisie qui ne supporte pas ou plus de voir le pouvoir lui échapper depuis 2002 ? Le tout soutenu par le propre vice-président de Dilma, Michel Temer, venu de la droite, nommé dans un souci d’unité nationale, mouillé jusqu’aux yeux dans l’affaire Petrobras et qui se retourne contre Dilma en multipliant les promesses de ministères aux députés hésitants.
Dilma sauvera-t-elle son poste avec le soutien toujours massif des classes populaires ? On n’en sait rien à l’heure qu’il est mais soyons certains que cette ancienne guerillera qui doit être la seule chef d’État avec Poutine à savoir démonter et remonter une kalach, qu’on surnommait la « durona » du temps de la dictature militaire où elle fut torturée et où elle ne lâcha rien, ne se laissera pas faire. Et que sa défaite serait une mauvaise nouvelle pour la gauche, bien sûr, mais pour toute personne qui croit en cette chère vieille chose qu’est la démocratie.

Comme, sur 80 millions de francophones d’Europe occidentale, il ne s’en est pas trouvé un seul pour sous-titrer cet importantissime discours, le voici dans son portugais d’origine, sous-titré en italien :
Dilma Roussef - Saker Italia – 21 avril 2016

Pour ne pas, nous, mourir idiots :
BRÉSIL - le droit historique de résister
Beto Almeida – Carta Maior – LGS – 25 avril 2016

À certaines occasions de l'histoire du Brésil, le droit de résister à un coup d'état ou à la fraude a été utilisé avec succès avec un immense soutien populaire.
Compte tenu de son importance sur la scène internationale, le Brésil a toujours été et reste l’objet de politiques interventionnistes, de sabotages, de déstabilisations de la part des grandes puissances impériales et de leurs mécanismes, qu’ils soient des sociétés transnationales, des moyens de communication, des services d’information et d’espionnage et, plus récemment, des institutions non gouvernementales, mais toujours guidés et financés par les objectifs étatiques de ces grandes nations, et en particulier des États-Unis.
Source : http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-direito-hi...
Via : http://www.legrandsoir.info/bresil-le-droit-historique-de...

AMÉRIQUE LATINE : Pourquoi ces changements ?
Bernard Tornare - Overblog - 25 avril 2016

Au cours des cinquante dernières années, il y a eu trois alternances majeures en Amérique latine: la première fut celles des dictatures militaires, elle a échoué; puis sont venu les gouvernements néolibéraux (Collor au Brésil, Fujimori au Pérou, Menem en Argentine, Garcia Meza en Bolivie et au Venezuela Caldera). Ils ont échoué et ont été rejetés par le peuple aux élections. Puis vinrent les gouvernements démocratiques populaires et maintenant il y a une menace que ces gouvernements soient rejetés encore une fois par des gouvernements néolibéraux comme celui de Macri en Argentine.
Nous devons nous demander pourquoi cela s’est produit.
Source : http://b-tornare.overblog.com/2016/04/amerique-latine-pou...

AMÉRIQUE LATINE – Fin d’un cycle ou épuisement du post-néolibéralisme
François Houtart – CADTM – 21 avril 2016

L’Amérique latine fut l’unique continent où des options néolibérales furent adoptées par plusieurs pays. Après une série de dictatures militaires, appuyées par les États-Unis et porteuses du projet néolibéral, les réactions ne se firent pas attendre. Le sommet fut le rejet en 2005 du Traité de Libre Échange avec les États-Unis et le Canada, fruit d’une action conjointe entre mouvements sociaux, partis politiques de gauche, ONG et Églises chrétiennes.
Les gouvernements progressistes
Les nouveaux gouvernements au Brésil, Argentine, Uruguay, Nicaragua, Venezuela, Équateur, Paraguay et Bolivie, mirent en place des politiques rétablissant l’État dans ses fonctions de redistribution de la richesse, de réorganisation des services publics, surtout l’accès à la santé et à l’éducation et d’investissements dans des travaux publics. Une répartition plus favorable des revenus des matières premières entre multinationales et État national (pétrole, gaz, minerais, produits agricoles d’exportation) fut négociée et la bonne conjoncture, pendant plus d’une décennie, permit des rentrées appréciables pour les nations concernées.
Parler de la fin d’un cycle introduit l’idée d’un certain déterminisme historique, suggérant l’inévitabilité d’alternances de pouvoir entre la gauche et la droite, notion inadéquate si le but est de remplacer l’hégémonie d’une oligarchie par des régimes populaires démocratiques. Par contre, une série de facteurs permettent de suggérer un épuisement des expériences post-néolibérales, en partant de l’hypothèse que les nouveaux gouvernements furent post-néolibéraux et non post-capitalistes.
Source : http://cadtm.org/Amerique-Latine-Fin-d-un-cycle-ou

Hillary Clinton et la guerre néolibérale de Wall Street contre l’Amérique Latine
Eric Draitser – Arrêt Sur Info – 2 mai 2016

Qu’un coup d’État soit en cours au Brésil et que la droite utilise des mesures politiques extraordinaires pour renverser Dilma Rousseff sont désormais des secrets de polichinelle.
Mais ce dont on parle peu dans tous ces débats sur la destitution de la présidente et la corruption qui gangrène le Brésil est le contexte plus large de toute cette affaire : comment la finance internationale travaille avec Hillary Clinton et d’autres élites politiques américaines pour réaffirmer le Consensus de Washington en Amérique Latine ; comment la droite dans toute la région collabore à ce projet ; et comment cela se manifeste dans les pays visés. Bien que les pièces de ce puzzle puissent être partiellement cachées, il est temps de les assembler pour découvrir le tableau d’ensemble.
Source : http://questionscritiques.free.fr/edito/Hillary_guerre_ne...
Via : http://arretsurinfo.ch/hillary-clinton-et-la-guerre-neoli...

RUSSIE
La vie sauvage a repris possession de Tchernobyl
(Savoir quelles malformations et quels cancers elle trimballe est une autre histoire)
Source : https://www.rt.com/news/340739-chernobyl-wildlife-photogr...

Pierre le Grand ne l’a jamais vue ainsi

Mis en ligne le 2 mai 2016.
Suite
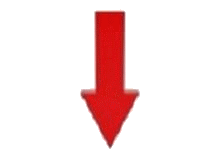
22:10 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |















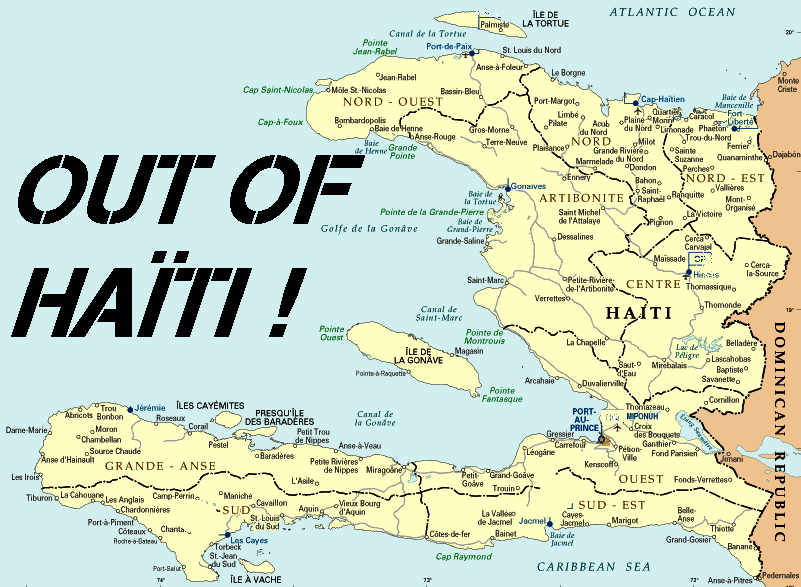







Les commentaires sont fermés.