02/04/2016
SUITE ANNONCÉE / 4 (et dernière)
D’un passé pourtant pas si lointain…
Suite Annoncée / 4
(et dernière)
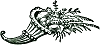
Un cas extrême d’intégration réussie : Salomon Reinach
S’il fallait caractériser du nom d’un seul homme la IIIe République, celui de Salomon Reinach y suffirait sans doute.

Né le 29 août 1858 à Saint-Germain-en-Laye d’une famille juive d’Allemagne, Salomon eut deux frères : un aîné, Joseph, né en 1856, et un cadet, Théodore, en 1860.
Les deux frères de Salomon allaient, contrairement à lui, faire des carrières politiques, devenir ce qui fut appelé des « juifs d’État ». Joseph, journaliste et secrétaire de Gambetta, fut député des Basses-Alpes et Théodore, juriste, archéologue, historien, mathématicien, philologue, numismate et musicologue, fut député de la Savoie et est aussi connu pour s’être fait construire, à Beaulieu-sur-Mer, une demeure « à la grecque » (dans le goût « début du XXe ») : la villa Kérylos, qui se visite encore.
La manière dont les frères Reinach furent élevés et ce qui en résulta démontre a contrario la malfaisance de l’enseignement tel qu’il est conçu et pratiqué aujourd’hui. Rien qu’à ce titre, ils mériteraient notre attention, et c’est pourquoi il vaut la peine de s’attarder un instant sur leur histoire familiale.
La famille Reinach
Le premier ancêtre connu, Hans Mayer, était suisse, originaire du canton d’Argovie, qu’il quitta au XVIIIe siècle pour aller s’établir à Mayence et y prendre le nom de Reinach.
Le grand-père, Joseph-Jacob, alla, lui, s’établir à Francfort-sur-le-Main comme marchand de produits agricoles et de bestiaux. En 1814, il eut des jumeaux, Herman et Adolf, qui se lancèrent ensemble dans le commerce international. C’est Herman, père de nos trois Reinach, qui allait devenir banquier multimillionnaire. Il commença par s’installer à Paris, après un séjour à Londres.
[ N’oublions pas qu’en 1792, cédant à l’insistance de Robespierre, de Marat, de l’abbé Grégoire et de leurs partisans, la Convention avait aboli l’esclavage dans les colonies, et fait des juifs et des protestants des citoyens à part entière qu’ils n’étaient pas jusque là.]
Herman avait donc une bonne raison de s’installer en France plutôt qu’ailleurs. Mais il était cependant persuadé qu’un homme de son époque, s’il voulait faire quelque chose de sa vie, devait parler au moins deux langues étrangères. Outre son allemand natal et son français d’adoption, il n’avait pas ménagé ses efforts, pendant son séjour à Londres, pour apprendre aussi l’anglais. Son frère et lui s’étaient acheté un manuel de correspondance commerciale dont ils avaient appris par cœur toutes les lettres, et ils avaient pris pour professeur de conversation leur cocher, dont ils payaient les leçons en pintes de bière.
Homme très débrouillard, Herman n’était cependant pas que cela. C’était aussi un amoureux des Lumières, grand admirateur de Voltaire et de Rousseau, qui, en 1848, opterait résolument pour la République, mais qui – métier oblige – fréquenterait bien entendu la grande bourgeoisie d’affaires arrivée au pouvoir grâce à la Révolution sans être elle-même révolutionnaire pour un sou. Installé dans les beaux quartiers, il recevrait chez lui banquiers, industriels, patrons de presse et hommes politiques aussi bien qu’artistes et intellectuels, bref, tout ce qui comptait à Paris, de Thiers à Victor Hugo en passant par Michelet, Renan et tous les autres, plus quelques têtes couronnées d’ici et là.
C’est dans ce milieu que les trois frères ont grandi.
Le « phénomène Reinach » doit beaucoup aux qualités de selfmade man de Herman (à l’époque, on eût dit- en français - qu’il s’était « formé à l’école de la vie »). Sans renier sa judéité, il ne pratiquait aucune religion et avait des idées personnelles sur l’éducation des enfants. Il n’allait donc pas élever ses fils dans le judaïsme, suivant en cela sans le savoir les recommandations du Plan d’Éducation Nationale de Lepeletier de Saint-Fargeau, et pas trop non plus à l’école. Car, quand l’école ne répond pas à ce qu’on est en droit d’attendre d’elle, il faut faire le travail à sa place. Or, Herman se méfiait des lycées, qui étaient encore sous la coupe – militaire - de l’Empire, et il se désolait de voir que, surtout dans les petites classes, tant de temps était perdu en dictées, alors que les enfants maîtrisaient déjà l’orthographe. Et aussi, pourquoi donc les maîtres tenaient-ils tant à dicter leurs propres cours aux élèves, alors qu’il y en avait d’imprimés ? D’après lui, 1) les enfants gâtaient leur écriture en essayant de noter l’intégralité de ce qu’ils entendaient, 2) ils en oubliaient de réfléchir par eux-mêmes.
Rien de passif, on le voit, chez le banquier en pleine ascension. Il eût fait beau voir qu’on lui interdise de garder ses enfants chez lui si l’école n’était pas à la hauteur ! Tout ceci le poussa – il en avait les moyens – à engager un précepteur pour faire la classe à ses fils. Ce fut Charles-Marie Laurent, un jeune homme « cultivé, consciencieux et d’un caractère agréable » qui n’avait, malheureusement, aucune autorité sur eux : « Il leur interdisait les mots grossiers, mais il ne parvenait pas à les empêcher de se battre. Tous d’une violence extrême, leur salle d’études était un véritable champ clos : quand le bruit de leurs luttes arrivait jusqu’à moi, je montais pour distribuer impartialement des taloches aux combattants, sans chercher à démêler le motif de leurs querelles. » Mais Charles-Marie avait deux passions : Victor Hugo et Vercingétorix, sur lequel il écrivait une tragédie. C’est ainsi que Joseph serait toute sa vie hugolâtre et que Salomon finirait conservateur en chef du Musée des Antiquités nationales.
Suivant les convictions paternelles, tout le monde était polyglotte chez les Reinach. Mais… « Qui na pas fait plus que son père n’a rien fait », avait prétendu Léonard de Vinci, les trois fils de Herman apprirent donc aussi le latin et le grec, chose habituelle à l’époque pour quiconque entendait faire quelques études. Et, bien entendu, ils finirent par y aller, à l’école, et y devenir forts en thème. Ils se mirent même, sans le faire exprès, à y remporter tous les prix… qu’il eût peut-être été plus politique de ne pas monopoliser, mais comment le savoir. Ils étaient surdoués, et, pour leur père, ces prix étaient la preuve d’une intégration réussie à la société française.
Au concours général, Salomon, puisque c’est lui qui nous intéresse, remporta non seulement six prix et dix accessits, mais se vit même – à seize ans ! – publier par Le Temps (du 27 avril 1874). L’écolier y protestait contre la suppression du concours de géographie en classes de 3e et seconde, ce qui « inévitablement condamnait à l’oubli et à la décadence » une étude déjà négligée par la Sorbonne, et par là refermait l’horizon intellectuel de la jeunesse. « Certes, il est avant tout nécessaire à un homme de connaître la géographie de son pays, mais est-ce que le Français est condamné à demeurer toujours chez lui ? Industriellement, commercialement, militairement peut-être un jour, le Français sera appelé hors de la France ; il doit donc être instruit non seulement de la géographie de l’Europe, mais de celle de tous les pays où pourra se déployer son intelligence. » Certes, cela n’excluait pas les aventures coloniales, mais au moins n’était-ce pas hexagonocentriste.
Quoi qu’il en soit, à une époque où le colonialisme, justement, était si fort à la mode, et où d’aucuns se mettaient à beaucoup parler de la « race » indo-européenne, de sa supposée supériorité sur les autres, d’aryanisme, du Diable et de sa mère, il valait mieux, si on n’en était pas, ne point remporter absolument tous les prix au concours général. Ainsi, c’est sans doute encore sans acrimonie mais tout juste, que les chansonniers montmartrois brocardaient « les frères Je Sais Tout ».
Arrêtons-nous un bref instant pour considérer avec un serrement de cœur une époque de l’histoire de France où le bon peuple payait pour aller écouter chansonner les résultats aux concours des écoles.
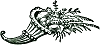
Débuts dans la vie
En novembre 1876, Salomon entre premier rue d’Ulm. Cela lui vaut, suivant la tradition, le titre de « cacique ». Il a 18 ans et vient de passer ses vacances d’été à traduire l’Essai sur le libre arbitre d’Arthur Schopenhauer, qui paraîtra l’année suivante « pour la première fois en français ». Une onzième édition paraîtra en 1909, et c’est encore ce texte qui – on ne compte plus le nombre des rééditions – paraîtra en 1992, dans la « Petite bibliothèque » de Rivages Poche.
Quelles sont les relations de Salomon Reinach avec le libre-arbitre ? Sacrément difficiles à distinguer. Celui qui a été élevé sans religion et qui se battra toute sa vie pour l’école laïque, va traverser, pendant ses études, une crise de mysticisme. Le phénomène est courant. Ce n’est pas J.B. Pouy qui nous contredira, ni les enfants de communistes qui fuguent pour faire, à pied, le pèlerinage de Compostelle. Ce qu’on peut dire, c’est que chez Salomon Reinach, le choix du rationalisme et une tendance au mysticisme très difficile à réprimer vont se faire la guerre ou se compléter, non seulement dans la vie mais dans l’œuvre.
En 1880 – il a 22 ans -, il publie un Manuel de philologie classique, qui, comme il s’y attendait, sera violemment critiqué. Ses maîtres l’avaient mis en garde. Michel Bréal, par exemple : « Imprimez-le bien vite, dans un an, vous n’oseriez plus. » D’autres se scandalisent qu’il ose, justement à son âge, donner un avis sur ces choses. Mais, est-ce vraiment une question d’âge ? N’est-ce pas plutôt son caractère qui le pousse à nourrir « l’heureuse illusion d’une science naissante, qui prend pour horizon les bornes du connaissable » ? Illusion ? Oui, certes, il partage celle de son temps sur le pouvoir de la science à repousser toutes les bornes et à sanctifier ce qui, jusque là, ne l’était pas. On sait mieux aujourd’hui ce qu’il faut en penser. Mais l’ambition (et non l’illusion) de Reinach est de défricher une jungle différente, à savoir : TOUT apprendre (dans les bornes toujours reculées du connaissable) et TOUT transmettre. Au plus grand nombre. Même « aux jeunes filles ». C’est-à-dire aux femmes.
Que ceux qui hausseraient aujourd’hui les épaules veuillent bien se rappeler que, moins de huit décennies plus tôt, M. Sylvain Maréchal, précurseur de l’anarchie et de la grève générale, avait « essayé de se rendre utile en publiant un Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes », et qu’en 1909 encore, M. Henri d’Almeras regretterait amèrement qu’on ne l’ait pas écouté. Quoi qu’il en soit, ce projet pédagogique, que Reinach va poursuivre sa vie durant, scandalisa fort les vieux messieurs en charge de dispenser le savoir dans une école où tout était fait par et pour les hommes, et seulement pour ceux d’une certaine classe. C’est évidemment, au contraire, son plus grand titre à notre attention.
Reinach a connu très vite la grandeur et les limites du savoir. Se méfiant de ceux qui le maîtrisaient mal et cherchaient à le monnayer en pouvoir, il a voulu ruiner leurs ambitions. Dans la « préface intime » à son Manuel, il révèle que ce livre fut une machine de guerre. À notre avis, il ne se vantait pas.
Rappelons brièvement, pour le situer, que Reinach est surtout connu comme archéologue et comme spécialiste de l’histoire des religions, mais qu’il fut bien plus que cela. Philologue, philosophe et passionné d’éducation, il sera si doué pour le dessin qu’il envisagera un moment de se consacrer à la peinture. Son œuvre, qui est immense, remplirait à elle seule une bibliothèque. « Elle témoigne d’une intelligence polymorphe, d’une érudition prodigieuse et d’une capacité de travail exceptionnelle. À l’École Normale déjà, Reinach forçait l’admiration ; il était une encyclopédie vivante. (…) On l’a présenté comme l’héritier de Diderot. On a comparé son activité à celle de Pic de la Mirandole. On a cité Voltaire et son domaine de Ferney pour évoquer les qualités de l’épistolier et l’hospitalité de son salon. » [1]

Salomon Reinach vers 1900
Il nous reste à évoquer, trop schématiquement pour être justes et trop longuement pour un simple post, la carrière et l’œuvre de l’« intégré ».
Reinach l’Athénien
Sa carrière d’archéologue commença par un séjour à Rome, où il fouilla les environs de la Domus aurea (le palais de Néron)
Dans la Domus aurea se trouvait un autre tableau [représentant Phèdre et Hippolyte, NdA], dont il ne subsiste une trace que dans un dessin de Salomon Reinach. On y reconnaît le schéma visible dans la composition de nombreux sarcophages.
En mars 1880, à Naples, Reinach s’embarqua pour Le Pirée, où il fit la connaissance de Charles-Joseph Tissot, ministre de France à Athènes et grand antiquaire. « Je me présentai à Tissot. Il me revit à notre bibliothèque, et nous étions liés avant de nous connaître. Il m’a dit plus tard qu’il m’avait pris en affection parce qu’il me voyait une curiosité générale et que je paraissais désireux, à la différence des spécialistes, d’apprendre ce que je ne savais pas. » Mais, bientôt, Tissot reçut une autre affectation, celle d’ambassadeur extraordinaire à Constantinople. Cela ne lui laissa que peu de temps pour travailler à une Afrique romaine qu’il méditait depuis longtemps et qui jouerait plus tard un rôle important dans la vie de Reinach.
Celui-ci se lança dans le travail en observant les règles que lui avait rappelées son ancien maître, Foucart : obligation absolue de renoncer aux travaux de compilation et d’abandonner toute idée de catalogues et d’index. Il faut dire que les catalogues et les index seront toujours en effet le péché mignon de Reinach. Il disait d’eux qu’ils permettaient « sinon de tout savoir, du moins de savoir où tout trouver ». Car il eut toujours en vue « ceux qui sont arrêtés au seuil d’études nouvelles moins par leur manque de connaissances premières que par l’ignorance des sources où la science se puise ». L’archéologie, cependant, se pratique sur le terrain. Abandonnant provisoirement son rôle de justicier, il mit avec humour ses derniers écrits – des mélanges d’archéologie et d’histoire de l’art – sous la protection d’Amalthée.

« Amalthée n’est pas seulement le joli nom de la chèvre qui nourrit Jupiter enfant, en Crète, et fut récompensée de ses services par une place au ciel ; elle avait une corne qui, s’étant brisée par accident, devint par la faveur de son nourrisson, ce que l’on appelle une Corne d’abondance, ou corne d’Amalthée, remplie de toutes sorts de plantes, de fleurs, de fruits. La légende ne dit pas qu’ils fussent tous des meilleurs, mais du moins, il y en avait beaucoup et la provision s’en renouvelait à mesure qu’on se permettait d’y puiser. »[2]
Il en alla de même pour les écrits de Salomon Reinach.
Au cours de sa campagne de fouilles, il tira du néant (en 1888) le Voyage en Orient de Philippe Le Bas. C’était là un lien de plus le rattachant au XVIIIe siècle et à la Révolution, Philippe Le Bas n’étant autre, en effet, que le fils unique du suicidé de Thermidor et l’auteur, entre beaucoup d’autres choses, d’un Dictionnaire encyclopédique de l’Histoire de France en 12 volumes, qui est encore très lisible (nous l’avons lu) et pas obsolète, même s’il y manque tout ce qui fut découvert après lui. Deux immenses savants, qui ne se sont pas connus, se sont ainsi croisés comme des bateaux dans la nuit.
Nous ne détaillerons pas les multiples tâches et activités qui furent celles de l’helléniste en Grèce. Outre travailler sur les chantiers de fouilles, il acquit (marchanda) des terres cuites de Myrina « le disputant en grâce à celles de Tanagra », des fragments d’inscriptions, des médailles. Plusieurs de ses acquisitions rejoindront les collections du Louvre, pour lequel il se montrera toujours un généreux mécène.
À propos de marbres historiés qu’il convoitait, il lui arriva de mentionner dans son carnet l’une ou l’autre anecdote. Comme celle-ci, par exemple : « Il y a quelques années, un protégé français nommé Valadour obtint un firman pour l’exploitation des marbres du Temple de Téos. Deux bombardes chargées de marbres quittèrent la petite scala de Sigadjik ; et quand Pottier et Hauvette vinrent l’an dernier à Téos, Baladour leur proposa de leur vendre ses marbres historiés. Depuis, Baladour a filé, laissant dans le pays 2.000 piastres de dettes et une réputation détestable. » Les marbres ne pouvaient pas être vendus et « Baladour » les avait vendus deux fois. Honte sur nous : cela nous a fait rire.
Tout en fouillant et négociant des acquisitions, l’archéologue écrivait des articles pour La République française, dont un sur les écoles juives de Salonique. Mais une attaque de typhoïde le força bientôt à demander un congé. À la fin de l’année, il rentra en France et, à peine arrivé à Paris écrivit un article sur « La musique en Lorraine », projeta une histoire des arts musicaux et entreprit une Chronique d’Orient. Pendant les treize années qui allaient suivre, il rédigerait régulièrement un bulletin critique consacré à l’archéologie classique en Méditerranée. Mais Reinach l’Athénien, c’était fini. Dès le mois de novembre, il avait rejoint à Londres Tissot qui venait d’y être nommé ambassadeur et qui avait besoin de son aide. Il essayait en vain de mettre en forme son ambitieux travail sur l’Afrique romaine mais n’y arrivait pas : sa santé se dégradait. Il comptait sur Salomon pour l’aider.
Reinach l’Africain
C’est donc une fois de plus à ses talents de compilateur, de dresseur de catalogues et d’index, bref d’organisateur intellectuel que son aîné fit appel. D’abord à Londres, puis en Tunisie. Reinach passa ainsi du secrétariat de Tissot à celui de la Commission archéologique en Tunisie, dont Tissot était le président. C’était l’époque où la République des Jules était en pleine effervescence coloniale. Deux ans plus tôt, par le traité de Bardo, la Tunisie était devenue un protectorat français.
Sautons les péripéties dues à la santé déclinante de Tissot. Le 26 novembre (1883) Reinach partait pour Carthage. Il avait 25 ans et venait d’entreprendre la rédaction de… ses mémoires. De novembre à mai 1884, il allait poursuivre seul sa mission, en recevant par correspondance les instructions de Tissot. Il s’acquitterait aussi de diverses autres tâches, notamment pour l’Alliance Israélite Universelle, à laquelle il écrivait le 26 décembre 1883 (lettre à Isidore Loeb) : « J’ai l’honneur de vous transmettre un premier rapport sur la condition des écoles de l’Alliance en Tunisie. Je les ai visitées en compagnie de M. Ernest Babelon, conservateur au cabinet des médailles de Paris, et je me suis efforcé de recueillir à leur sujet des renseignements de sources diverses, propres à m’éclairer sur les services qu’elles rendent et les lacunes qu’elles présentent encore. » L’Alliance avait, en 1879, fondé un établissement secondaire à côté du collège musulman de Sadikki et du collège Saint-Louis de Carthage. Celui-ci était devenu, en 1882, le collège Saint-Charles, à l’initiative du cardinal Lavigerie. Reinach répondait à « deux questions importantes » : « la condition générale des Juifs en Tunisie et leur attitude à l’égard de l’Italie et de la France ». Il le faisait dans l’esprit de l’exposé qu’il avait publié dans La République française sur les écoles juives de Salonique : avec indépendance. Il heurtait ainsi de puissantes idées reçues, s’inquiétant du faible niveau de formation des rabbins souvent superstitieux dont il faisait un portrait peu flatteur, et s’étonnant en outre des robes des jeunes filles juives, qui les faisaient paraître pour ce qu’elles n’étaient pas.[3] Il concluait ainsi son rapport : « Les écoles de l’Alliance ont une rude concurrence à soutenir avec celles du collège Saint-Charles et les différentes écoles congréganistes dues à l’activité de Mgr Lavigerie. »
Cela dit, Salomon et le cardinal étaient dans les meilleurs termes, car Lavigerie, administrateur du vicariat apostolique de Tunis depuis 1881, privilégiait deux domaines qui lui étaient chers : l’éducation et l’archéologie. Il se préoccupait très fort de l’une et apportait autant qu’il le pouvait son soutien à l’autre en facilitant les fouilles. Pour ce qui était des écoles juives, Reinach s’en préoccupait dans une perspective où, à l’évidence, la formation intellectuelle l’emportait sur la question religieuse.
De Paris, Tissot avait aussi demandé à Reinach de jouer un rôle dans l’« Association nationale pour la propagande de la langue française ». Celle-ci avait déjà attiré l’attention de Lavigerie, par ailleurs ami de Gambetta, dont Joseph était le secrétaire. On l’avait même sondé pour savoir s’il accepterait d’en être le secrétaire. Mais, peu soucieux de siéger aux côtés de Paul Berl, dont l’hostilité à l’Église ne faisait aucun doute, il avait décliné. Cependant, en janvier 1884, lorsque l’Alliance française fut définitivement organisée sous la présidence de Ferdinand de Lesseps, Lavigerie finit par accepter une des quatre vice-présidences.

Le cardinal Lavigerie, peint par Bonnat. 1888
Et voilà nos deux improbables compagnons, le Juif rationaliste et le futur évêque de Carthage, partis pour implanter de concert l’école laïque dans la toute fraîche colonie, pardon, dans le tout frais protectorat, pour ce qu’ils estimaient être le plus grand bien des Africains, qu’ils fussent juifs, musulmans ou chrétiens. Leurs intentions, à n’en pas douter, étaient pures, même si, ni l’un ni l’autre, ils ne se sont demandé ce qu’ils faisaient là au juste, à quel titre, avec quelle légitimité, ni ce qu’en pensaient les Tunisiens, que nul n’avait songé à consulter. Quoi qu’il en soit, ce ne fut pas du goût de l’Église, qui n’apprécia pas de voir un de ses prélats participer à une « machine de guerre du laïcisme », introduire en quelque sorte le Diable parmi ses ouailles.
Monseigneur rentra dans le rang et Reinach rentra à Paris, où Tissot, agonisant, mourut le 2 juillet, ayant fait de lui son exécuteur testamentaire. Salomon Reinach, à son habitude, s’acquitta de manière exemplaire de la tâche qui lui avait été confiée. En 1885, paraissaient les Fastes de la province romaine d’Afrique, et, de 1884 à 1891, les trois volumes – dont un atlas – consacrés à la Géographie comparée de la province romaine d’Afrique. Seul, le dictionnaire berbère-français que Tissot avait entrepris pendant un séjour au Maroc, trop peu avancé pour être complété, ne vit jamais le jour.
Pendant tout ce temps, Reinach avait continué à travailler à son Manuel de philologie, c’est-à-dire à améliorer et à compléter ce livre qui était « toute sa jeunesse », en une sorte de « commentaire perpétuel au texte et aux notes du premier volume ». Son ambition était claire et déclarée : il s’agissait de revendiquer « courageusement l’héritage de nos ancêtres, augmenté de l’héritage de nos pères, quitte à demander aux méthodes nouvelles, aux progrès de la pédagogie, le secret d ‘apprendre davantage en apprenant plus vite. » Nos ancêtwes les Gaulois ? Pas loin. Et pourquoi pas ? (Salvador, tu nous manques !)
Reinach et les antiquités nationales
Ayant renoué avec la philologie, Reinach renoue aussi avec l’archéologie grecque. Il termine son Traité d’épigraphie écrit son premier « courrier de l’art antique » pour La Gazette des beaux-arts et rédige un Précis de grammaire latine, puis une Grammaire latine à l’usage des classes supérieures et des candidats à la licence ès lettres et aux agrégations, écrit pour le Bulletin de correspondance hellénique, un article sur « une synagogue juive à Phocée ». Il donne enfin, avec E. Pottier, un catalogue raisonné desTerres cuites et autres antiquités trouvées dans la nécropole de Myrina. Broutilles que tout cela, pour le stakhanoviste des catalogues et des index.
C’est à ce moment qu’on lui offre un poste d’attaché au musée de Saint-Germain. S’ouvre alors à lui un nouveau domaine qui va le passionner : celui de la préhistoire et de la Gaule romaine.
À son habitude, il poursuit en même temps d’autres activités. Par exemple, à partir de 1887, il est membre du comité central de l’Alliance israélite et il sera l’un des fondateurs de la Jewish Colonization Association, dont nous avouons ne rien savoir. Il commença en même temps, y consacrant un temps et une patience infinis, la publication des articles et notices qui deviendraient plus tard les cinq volumes de Cultes, mythes et religions.
Mais pas seulement.
Nous n’avons rien dit de sa vie mondaine. En 1888, une série de circonstances allaient le conduire, d’un salon l’autre, à celui de Liane de Pougy et à la découverte des poésies de Pauline Tarn, alias Renée Vivien.
Lors de son séjour en Grèce, il avait été amené, lors d’une escale de son bateau à l’île de Lesbos, à visiter avec le médecin du bord, « une malheureuse hydropique qui gisait depuis sept mois sans mouvements ». Il avait alors écrit dans son journal : « Peu s’en fallut que cette infortunée ne fût la première Lesbienne que je rencontrasse. À la tare des monstruosités morales restera attaché dans mon esprit le souvenir des monstruosités physiques ». Eh bien, il allait changer d’avis sur « les monstruosités morales » et s’intéresser, par le biais des poésies de la moderne Sapho, à ces dames et à leurs particularités.
Le désir de voir un vase grec l’avait entraîné chez la femme de l’archéologue Ernest Beulé, qui avait fouillé en 1851 l’entrée de l’Acropole d’Athènes. Reinach raconte à Liane de Pougy : « J’y rencontre Charlotte Laissier, veuve depuis quelques mois et me lie avec elle. Cinq ans après, elle se remarie et devient Mme de la Redorte, nous restons liés. En 1910, alors que je refuse toute invitation, j’accepte pourtant un jour de dîner chez elle avec Mme de Brimont, je me lie avec elle. Quatre ans après, je la mène au Salon ; elle me cite des vers de Pauline, j’achète ses volumes et les dévore. Mme de B me mène chez Flossie [Natalie Barney], qui me révèle L’Idylle [L’Idylle saphique publiée par Liane de Pougy en 1901], je veux voir Ahnine [Liane de Pougy], je lui écris deux mots après l’avoir vue – et je reviens, on s’écrit, on ne cesse plus de s’écrire. Ainsi, remontant le cours des années et des hasards, c’est à un vase grec que je dois de vous connaître. Introducteur dont vous étiez digne, et qui me convient. »[4]

Renée Vivien habillée « à la Camille Desmoulins »
Pour les curieux, Mme de Brimont était l’arrière-petite-nièce de Lamartine. Quant à Mme de la Redorte et son mari, ils figurent dans un texte des Vrilles de la vigne, de Colette, « Printemps de la Riviera », qui sera retranché de l’édition définitive. Elle y évoque un séjour en 1906 à la villa Cessole, chez Renée Vivien. Les invités, parmi lesquels figurent Liane de Pougy, Jean Lorrain, Caroline Otero, Jeanne de Bellune, etc., sont présentés par leurs initiales :
« On regarde beaucoup le couple de la R…, surtout la femme, cette joueuse enragée et riche, Mme de la R…, dont les petites mains sèches sèment et récoltent des poignées d’or et de précieux papiers sales… Ses mains gantées, son corsage, son chapeau, sa figure décolorée, tout est blanc. Elle ressemble à un oiseau pâle au bec busqué, et ses pâles yeux charment l’or… »[5]

Mais d’où vient que tant de femmes exceptionnelles eurent alors la rage de singer des hommes qui ne l’étaient pas ?
Où finissent les mondanités et où commencent les occupations savantes ? À partir de 1890 et pendant deux ans, puis de 1895 à 1902, Salomon Reinach allait suppléer Alexandre Bertrand à la chaire d’archéologie nationale à l’École du Louvre. C’est là qu’il donna, en 1899, une série de conférences sur la religion celtique. C’est là aussi qu’il parla pour la première fois de totem et de tabou, toutes choses qui se retrouveraient un jour dans Cultes, mythes et religion, après avoir fortement intéressé Sigmund Freud.
On sous-estime souvent l’influence qu’eut Sparte sur l’imaginaire français. Depuis le milieu du XVIIIe siècle où les Oratoriens, soucieux d’arrêter l’hémorragie d’ouailles soit vers le protestantisme, soit vers l’Antiquité païenne ou l’athéisme, avaient eu recours à l’histoire ancienne, voire à l’historicisation des mythes pour inculquer à leurs élèves un certain nombre de vertus chrétiennes déguisées, Sparte, Athènes et Rome s’étaient emparées des esprits. On peut presque à coup sûr définir le rôle qu’allaient jouer dans l’histoire de France les uns et les autres, aux choix qu’ils faisaient de leurs modèles. Si, pour Robespierre, Sparte, ce fut Léonidas (« Étranger, va dire à Sparte qu’ici nous gisons, dociles à ses ordres. ») et si, pour Saint-Just, ce fut l’endroit où la brièveté du discours était loi (« Le prix d’éloquence sera donné au laconisme »), pour Salomon Reinach, c’est à Sparte que les filles et les garçons avaient jadis reçu la même éducation égalitaire. Il eut pour ambition d’initier aux choses de l’art et de la philosophie les jeunes filles, certes de bonne famille, il faut bien commencer quelque part et on n’imagine pas les porteuses de pain et les blanchisseuses au Louvre. Elles y seront invitées « avec leurs mamans », ce qui l’amènera à se dire « conférencier pour vieilles dames », sous-estimation s’il en fut.
Mais Reinach ne fit pas que suppléer Alexandre Bertrand au Louvre, car c’est à lui aussi qu’il dut son poste d’attaché au Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, dont il finirait conservateur en chef et dont il enrichirait considérablement les collections, y compris de ses deniers.
Il devait plus tard, à propos de « l’affaire », lui rendre hommage en rappelant que c’était pour Dreyfus que « ce Breton défenseur des vérités de 89 » était descendu « pour la première fois dans la lice à soixante-dix-sept ans ».
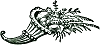
Cultes, mythes et religions
Sous ce titre ont été réunis cinq livres, eux-mêmes constitués d’essais et d’articles allant de cinq ou six à soixante pages, sur tous les sujets relatifs à l’histoire des peuples. Il suffit d’en énumérer les titres pour donner une idée de l’ampleur et de la diversité de l’entreprise. :
- Totems et tabous
- Celtica
- Mythes et rituels en Grèce, à Rome et chez les Hébreux
- Mythologie figurée
- Christianisme, survivances et déviances
Ce qui ressort de ces 1300 pages « choisies », c’est une curiosité inépuisable, une empathie inlassable pour « les autres » quels qu’ils soient. Car ce qu’avait entrepris Reinach, à travers l’art, l’archéologie, la mythologie, les coutumes patiemment glanées et décryptées, c’est l’histoire de ceux qui n’en ont pas : les classes inférieures, en effet, n’eurent jamais droit aux chroniques des historiens, celles d’Hérodote excepté. Pour elles, on dit « anthropologie ».

À partir de la Révolution et sûrement à cause d’elle, mettons à partir de Jacques-Antoine Dulaure (Des Divinités génératrices : ou du culte du Phallus chez les anciens et les modernes), un nombre grandissant de savants de tous les pays allaient de plus en plus s’intéresser à l’étude de ces classes inférieures dont l’histoire n’avait jamais été écrite parce qu’elle n’avait jamais intéressé personne, ou du moins personne sachant lire. Reinach ne fut pas le seul mais il fut l’un des premiers et un de ceux qui se trompèrent le moins dans leurs interprétations.
Quelques extraits :
http://psychanalyse-paris.com/-Cultes-Mythes-et-Religions...
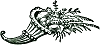
Orpheus, Histoire générale des religions
… aurait dû être un manuel scolaire.
L’État, entendant promouvoir l’instruction laïque, confia la tâche de le rédiger à un homme connu pour son hostilité envers le pouvoir de l’Église et son attachement à la laïcité. Il allait être déçu. L’auteur, pourtant, s’est acquitté de sa tâche de manière exemplaire. On peut même dire que rien, avant ou après ce livre, n’a été si conforme à l’esprit du Plan d’éducation nationale voté par la Convention le 13 août 1793 et jamais appliqué. On sait ce qu’il préconisait en matière de religion :
« Jusqu'ici j'ai développé le système de diverses habitudes dont la réunion forme le complément d'un bon cours d'éducation; et cependant je n'ai pas encore prononcé le nom de cette habitude morale qui exerce une si souveraine influence sur toute la vie de l'homme; je veux dire, la religion : sur cette matière délicate, il est plus aisé d'exprimer ce qui est mieux que ce qui est possible.
C'est d'après le principe que l'enfance est destinée à recevoir l'impression salutaire de l'habitude, que je voudrais qu'à cet âge, il ne soit point parlé de religion, précisément parce que je n'aime point dans l'homme ce qu'il a toujours eu jusqu'à présent, une religion d'habitude.
Je regarde ce choix important comme devant être l'acte le plus réfléchi de la raison.
Je désirerais que, pendant le cours entier de l'institution publique, l'enfant ne reçût que les instructions de la morale universelle, et non les enseignements d'aucune croyance particulière.
Je désirerais que ce ne fût qu'à douze ans, lorsqu'il sera rentré dans la société, qu'il adoptât un culte avec réflexion. Il me semble qu'il ne devrait choisir que lorsqu'il pourrait juger. »
Michel Le Peletier – Plan d’éducation nationale (extrait)
Or, Reinach, voulant mettre sous les yeux des jeunes gens ce qu’il leur convenait de savoir pour être en mesure de juger, s’est appliqué, dans son livre, à leur communiquer ce qui est sûr et rien d’autre.
On peut regretter qu’un seul chapitre soit consacré aux « Celtes, Germains et Slaves » et un seul autre aux « Chinois, Japonais, Mongols, Finnois, Africains, Océaniens, Américains », alors que l’Islam et le Judaïsme ont droit à un chapitre chacun et le Christianisme à cinq, ce dont il s’est justifié en disant : « Ce n’est pas ma faute si l’histoire du christianisme se confond un peu, depuis deux mille ans, avec l’histoire universelle et si, en esquissant celle-là, j’ai été amené, dans une certaine mesure, à raconter brièvement celle-ci. » Cherchant ce qu’il y avait d’historique dans les livres sacrés du judaïsme et du christianisme (Ancien et Nouveau Testaments), sa conclusion est « à peu près rien ». Il va même jusqu’à recommander l’Essai sur les mœurs de Voltaire, avec lequel, pourtant, sur les religions, il n’est « pas d’accord ».
Et pourtant, ce livre (à nos yeux) exemplaire lui sera refusé.
Ce que n’avaient pas prévu les messieurs du Ministère, pour qui parler de religion, c’était surtout parler contre, prendre parti, mettre en garde, c’est que Reinach, tout en séparant l’historique du fabuleux, allait chercher, au contraire, ce qui, dans chaque croyance si lointaine et bizarre fût-elle, avait concouru à faire avancer la conscience humaine vers un plus haut degré de maturité. Il avait, pour cela, essayé de se mettre à la place des croyants. Mais ce genre de scrupules n’est pas le fort des cerveaux binaires. Alors que c’était là l’essence même de la laïcité. Hélas pour eux, les enfants des écoles allaient donc être endoctrinés à la nouvelle religion laïque.
Il faut rappeler, car c’est un des nœuds de notre histoire récente à tous, que la IIIe République fut farouchement anticléricale et qu’elle avait fait sienne la conviction des philosophes du XVIIIe siècle, pour qui les religions – toutes les religions – avaient été créées par d’habiles gredins pour imposer leur loi aux crédules. Reinach, plus darwinien qu’eux, était sûr et avait démontré qu’il n’en était rien, conscient d’abord de l’abîme qu’il y a entre « morale » et « religion ». Que les religions soient toutes nées naturellement ne fait plus de doute aujourd’hui. Cette idée était tout simplement anathème aux yeux de ceux qui avaient lancé leurs hussards noirs à l’assaut de « l’obscurantisme ». Ils se sentirent floués.
Ou du danger qu’il y a à essayer de s’intégrer à quelque chose de moins intelligent que vous…
Ce livre plus que nécessaire, qui eut contre lui les juifs, les catholiques et les bouffeurs de curés, aurait-il aussi contre lui, aujourd’hui, les musulmans ? Probablement. Sauf ceux de très haute volée, de la trempe de Reinach...
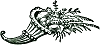
« De cet anticléricalisme va naître, il est vrai, une politique scolaire de grande qualité. Jules Ferry, un des très grands ministres de la IIIe République, mit en place un régime éducatif qui durera jusqu’en 1962.
L’école laïque, gratuite et obligatoire ne sera pas aussi laïciste qu’on a bien voulu le dire. C’est grâce à cette politique que va naître l’ascenseur social républicain, permettant aux fils d’ouvriers ou de paysans de sortir de leur condition et d’accéder aux plus hautes fonctions de l’État ou de l’économie. Il est vrai que le système n’était pas égalitariste, comme il l’est aujourd’hui. Les bourses étaient attribuées, à condition sociale égale, à ceux qui les méritaient, par leur travail et leurs résultats. C’était peut-être élitiste, mais c’était efficace.
La IIIe République est le modèle d’une république jacobine : elle rejettera, de 1875 à 1940, toute politique de décentralisation que défendait, depuis 1850, la droite monarchiste ou libérale. Si l’on regarde les manuels d’histoire d’avant 1980, il est fait gloire à la IIIe République de sa politique coloniale. Il n’était point question alors de repentance. À l’actif de la IIIe République, l’intégration dans l’ensemble français de la Tunisie et du Maroc, de la plus grande partie de l’AOF, sauf le Sénégal, de la plus grande partie de l’AEF, sauf le Gabon, de Madagascar, du Cambodge, du Laos de l’Annam et du Tonkin, territoires pour lesquels la Chine reconnut notre souveraineté, par le traité de Tianjin, en 1885. Il est vrai, d’ailleurs, que la colonisation française, si elle fut généralement fort humaine, était fondée sur les principes définis par Jules Ferry. Pour lui, « les colonies sont le moyen de permettre l’accès à la civilisation de peuples étrangers à nos valeurs ». Pour lui encore « les colonies sont le moyen de placement des capitaux le plus avantageux… La fondation d’une colonie, c’est la fondation d’un débouché ». Malheureusement, la colonisation française ne fut guère efficace. Les investissements furent limités, et les infrastructures (routes et voies ferrées) de médiocre qualité. Au reste, en 1914 comme en 1938, le total des voies ferrées construites en AOF et en AEF représente un kilométrage plus faible que celui du seul Nigeria. Si la politique marocaine de Lyautey et de ses successeurs fut un grand succès, ce fut assez largement le cas en Indochine aussi et en Algérie. En Indochine, il faudrait souligner les efforts considérables faits (entre 1940 et 1945) par l’amiral Jean Decoux. En Algérie, le gouvernement de la République ne saura pas favoriser l’essor de l’agriculture et n’aura pas le courage de résister tant aux mollahs qu’aux colons, et n’instituera pas l’enseignement laïc et obligatoire que prévoyaient les lois Ferry. De surcroît l’anticléricalisme gouvernemental freina les efforts d’évangélisation des Pères Blancs, notamment en Kabylie. »
« Comme il l’est aujourd’hui »… On laisse aux monarchistes auteurs de ces lignes la responsabilité de leurs opinions.
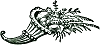
Reinach et l’Inquisition
Si Reinach croyait à la naissance naturelle des religions, il n’en était pas moins profondément anticlérical, s’agissant de l’Église catholique et de ses abus de pouvoir, tant dans le passé que de son temps.
C’est curieux, si on pense que cet homme a toute sa vie entretenu avec des quantités d’ecclésiastiques, savants il est vrai, les meilleures relations du monde, mais c’est ainsi.
En 1900 parut l’œuvre d’un Américain, jugée par lui si importante qu’il avait tenu à la traduire lui-même en français : l’Histoire de l’Inquisition au Moyen Âge, de Henry Charles Lea.
Dans la préface à son Orpheus, Reinach avait écrit :
« Je ne pense pas que les persécutions des Bacchanales par le sénat romain, que celles du christianisme naissant par les empereurs, que les fureurs de l’Inquisition, que la Saint-Barthélemy et les dragonnades doivent être relatées avec froideur, comme des épisodes insignifiants de l’histoire. J’exècre ces meurtres juridiques, fruits maudits de l’esprit d’oppression et du fanatisme : je l’ai laissé voir. Il existe encore des enragés qui glorifient ces crimes et voudraient qu’on en continue la série ; s’ils disent du mal de mon livre, ils lui feront honneur. »
C’est cette exécration de l’esprit d’oppression et du fanatisme qui forma son opinion sur l’Affaire Dreyfus dès l’instant où elle éclata, comme elle l’avait formée auparavant sur la mise à mort des Templiers, celles de Jeanne d’Arc et de Gilles de Rais.

S’il vit immédiatement clair dans l’entreprise (son premier texte en défense du capitaine s’intitula d’ailleurs Clair comme le jour) son aspect purement raciste n’allait jamais vraiment lui apparaître et il resterait persuadé jusqu’à son dernier jour que tout cela n’avait été qu’un complot des Jésuites contre la République.
Certes, on ne prête qu’aux riches, mais il y a quand même deux ou trois crimes que les soldats de saint Ignace n’ont pas commis. Le racisme ordinaire et généralisé ne s’était pas alors révélé dans toute sa hideur. Ni le chauvinisme se parant des plumes du nationalisme. Comment une intelligence à ce point supérieure pouvait-elle imaginer LA psychopathologie de l’inintelligence ? D’autres, plus tard, allaient la découvrir, mais Reinach, bienheureusement pour lui, serait mort - en 1932 - juste avant que se déchaîne la peste qui n’a pas cessé jusqu’à ce jour, même s’il lui faut de temps en temps changer d’objet pour se perpétuer.
Signalons que, malgré ses inlassables efforts pour sauver Alfred Dreyfus, puis pour lui faire rendre justice après son acquittement, ce n’est pas lui qui en a écrit l’histoire, mais son frère Joseph, par ailleurs un des fondateurs de la Ligue des droits de l’homme, née à l’occasion de la célèbre « Affaire ».
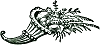
Gilles de Rais, Glozel et Saïtapharnès
D’autres affaires ont marqué la carrière de Salomon Reinach. À commencer par celles de ses opinions à contre-courant.
Dans sa lutte écrite contre les abus de pouvoir de l’Église, il n’avait pas sous-estimé les responsabilités de la couronne, tant dans l’affaire des Templiers que dans celle de Jeanne d’Arc, honteusement abandonnée à son sort par le monarque qui lui avait dû son élévation. Mais il s’est particulièrement passionné pour le cas de Gilles de Rais, dans lequel il vit un autre martyr des deux pouvoirs coalisés.

Procès de Gilles de Rais – Miniature vers 1530
On ne peut pas attribuer à la persécution de Dreyfus celle qu’il vit dans le procès du maréchal, puisque son opinion sur ce point est bien antérieure. Toujours est-il qu’il a comme toujours passé en revue les pièces et scruté les textes, et qu’il en a tiré la conviction que l’ancien compagnon de Jeanne, grand aristocrate breton et richissime propriétaire de terres et de châteaux, était innocent des crimes dont il fut accusé. Sa thèse est que toute « l’Affaire » fut un coup monté et que la cupidité de nobles et de gens d’église en fut la cause. Cette conviction était si forte qu’il alla même jusqu’à essayer d’obtenir de Charles Lea qu’il s’exprime plus nettement dans ce sens, chose que l’historien américain refusa de faire, estimant qu’il en avait assez dit. Salomon Reinach fit alors paraître un texte d’une trentaine de pages où il exposait sa thèse dans un certain détail. Il n’en démordit jamais et peut-être avait-il raison. On ne trouve plus qu’en ligne (voir plus bas) cette brochure épuisée depuis longtemps.
En 1994, l’éminent médiéviste qu’était Jacques Heers a fait paraître « sa » version de l’histoire de Gilles. En gros, il estime que deux procès menés en parallèle, avec des dizaines d’enquêteurs et des centaines de témoins, n’ont pu être truqués, d’autant qu’il aurait été plus simple de liquider le trublion le soir au coin d’un bois. (On schématise.) Malheureusement, les procès du TPIY et de la CPI, pour n’invoquer que ceux-là, viennent de nous prouver le contraire, et même prouver, avec le cas Milosevic, qu’on peut à la fois truquer un procès et liquider un trublion tout en le faisant. La question reste donc ouverte. Salomon Reinach et Jacques Heers se sont basés sur les mêmes pièces. Ce sont leurs interprétations qui diffèrent et qui méritent au moins d’être comparées.
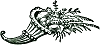
Si l’affaire Glozel n’est pas sanglante, elle n’en est pas moins compliquée, on pourrait même dire compliquée à l’excès. Elle l’est même tellement que nous renonçons à la résumer ici.
Sachez seulement que Glozel est un village où des agriculteurs firent, en 1924, des découvertes qui le rendirent aussitôt célèbre, car on y trouva, ensemble, des objets datant de l’âge du fer et d’autres datant du Moyen Âge (encore une fois, nous schématisons à l’excès). Il y eut des controverses, des commissions internationales, des appels à savants de partout, des procès. Il s’y mêla des intérêts sordides. La communauté des archéologues en fut divisée. Certains se déclarèrent pour l’authenticité des trouvailles, d’autres pour un trucage… qui ne fut jamais prouvé.

Salomon Reinach aux fouilles de Glozel en 1928
En 1926, Reinach, appelé à la rescousse, se prononça pour l’authenticité, de même d’ailleurs que l’abbé Henri Breuil. Ceux qui ne sont pas d’accord le lui reprochent encore.
Pour en savoir plus sur cette sombre affaire, voir ICI.
Ajoutons que Reinach a défendu sa thèse dans un livre intitulé Éphémérides de Glozel (Paris, Kra, 1928), dont Wikipedia a eu la bonne idée de mettre des extraits en ligne.
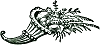
L’affaire de la tiare de Saïtapharnès concerne Salomon Reinach de façon plus personnelle.

Le 1er avril 1896, le Louvre fit savoir qu'il avait acheté une tiare d'or découverte en Crimée et ayant appartenu au roi scythe Saïtapharnès. Le musée avait acquis cette œuvre inestimable sur les conseils d'Albert Kaempfen (1826-1907), alors directeur des Musées nationaux et des archéologues Antoine Héron de Villefosse et Salomon Reinach. Une inscription grecque sur la tiare donnait à lire : « le conseil et les citoyens d'Olbia honorent le grand et invincible roi Saïtapharnès ». Pour les experts du Louvre, cette tiare confirmait un épisode datant de la fin du IIIe siècle ou du début du IIe siècle avant notre ère.
Or, il s’agissait d’un faux.
Deux ans auparavant, elle avait été commandée à un artisan juif d’Odessa, par deux commerçants qui lui avaient expliqué qu’il s’agissait d’un cadeau spécial qu’ils voulaient faire. L’orfèvre, Israël Rouchomovsky, avait reçu 7.000 francs pour son travail, qui les valait bien.
Le fait est que les deux hommes d’affaires (des « Valadour » ?), réussirent à vendre leur prétendu cadeau au musée du Louvre, pour la coquette somme de 200.000 francs-or. Que la transaction ait eu lieu un 1er avril ne semble pas avoir mis la moindre puce à l’oreille à cette brochette de savants.
Tout aurait pu en rester là si un autre archéologue, l’Allemand Adolf Furtwängler, n’avait été pris de doutes. La tiare n’avait pas qu’un style mais plusieurs et elle manquait singulièrement de patine… Il s’ensuivit des discussions, dont le bruit parvint jusqu’à Odessa. L’orfèvre, peu soucieux d’être pris pour un faussaire, fit le voyage de Paris pour venir conter à qui de droit son affaire. On en voulut des preuves. Il les donna. Et le scandale éclata. Dépenser 200.000 francs-or de fonds publics pour un faux qui en avait coûté 7.000… Ha ha ha !
Les chansonniers et les caricaturistes s’en donnèrent à cœur-joie. Le président Loubet fut représenté, tiare en tête, faisant des ronds de jambe au roi d’Italie. La tiare eut même les honneurs du Carnaval de Nice, où elle défila avec le cadre vide de la Joconde récemment volée. Mais pourquoi Salomon Reinach fut-il brocardé plus et plus longtemps que les autres, comme s’il eût été seul en cause ? Antisémitisme ? Il semble bien que oui. On n’ose penser à ce qu’eussent tiré de ces attaques frisant la diffamation voire la calomnie les zozos du CRIF ou de la LICRA… Reinach, qui était un homme honnête et bien élevé, but le calice jusqu’à la lie. Il s’était trompé, il s’était trompé.

Pour la petite histoire…
L’orfèvre ne fut pas inquiété. Il reçut même une médaille d’or du Salon des arts décoratifs et s’installa à Paris, où il est mort en 1934.
« L’authentique tiare de Saitapharnès » apparaît, avec Arsène Lupin, dans L’Aiguille creuse de Maurice Leblanc.
Enfin, en 1997, un musée de Jérusalem l’a empruntée au Louvre pour l’exposer dans le cadre d’une rétrospective Rouchomovsky.
Avouons que sa tiare était quand même bien belle et que, si elle n’est pas d’époque, elle aurait mérité de l’être.
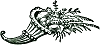
Reinach et l’éducation des jeunes filles
Dans sa préface à Orpheus déjà citée, Salomon Reinach écrivait :
« Comme j’ai la prétention et l’espoir de trouver autant de lectrices que de lecteurs, je me suis imposé une certaine réserve, surtout dans l’exposé des anciennes religions orientales. J’affirme aux mamans qu’elles peuvent donner ce livre à leurs filles, pour peu que la lumière de l’histoire ne les effraie pas. Les sacrifices que j’ai dû faire ne sont pas, à tout prendre bien regrettables ; mais si la bienveillance du public répond à mes efforts, je ferai paraître quelque jour une édition plus complète – pour les mamans. »
On voit affleurer à cette occasion l’obsession du savant pour l’émancipation au moins spirituelle des femmes. Mais il se préoccupa tout autant de leur émancipation intellectuelle. C’est pourquoi, à partir de 1911, il se lança dans la rédaction et la publication de petits manuels destinés à faciliter aux jeunes filles l’étude du français d’abord, du latin et du grec ensuite, et enfin de l’histoire des philosophies. Sidonie et le français sans peine fut bientôt suivi de Cornélie ou le latin sans pleurs, puis d’Eulalie ou le grec sans larmes. En 1926, il faisait paraître le premier des trois volumes des Lettres à Zoé sur l’histoire des philosophies. Bien des femmes, mais aussi bien des hommes – jeunes et moins jeunes, voire universitaires – pourraient aujourd’hui revenir avec profit et sans honte à ces sources de Gai Savoir.
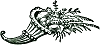
Salomon Reinach et les Juifs
Défenseur des droits des juifs mais aussi de leur culture, quoique son amour ne fût pas aveugle et que l’obscurantisme ne fut jamais son fait, Reinach accepta en 1886 la vice-présidence de l’Alliance israélite universelle, fonction qu’il remplit de son mieux jusqu’à ce qu’on l’obligeât d’en démissionner « pour violent antisionisme ».
Nahum Goldman raconte :
« Salomon Reinach et l’Association qu’il présidait, était violemment antisioniste[6] et ouvertement partisan de l’assimilation. Nos amis parisiens nous racontèrent un incident qui me révolta ; le savant juif Jacques Faitlovitch venait de découvrir les juifs Falachas en Abyssinie. Faitlovitch aurait rendu visite à Reinach pour lui parler de sa découverte et demander l’appui financier de l’Alliance pour continuer ses recherches chez les Falachas. Reinach l’aurait repoussé avec ces mots : “Ce que vous avez fait est un malheur. Il y a de toute manière trop Juifs dans le monde. Nous n’avons pas besoin que de nouveaux Juifs nous donnent de nouveaux tracas.” Mon zèle juvénile fut choqué de ces paroles. De retour à Francfort, j’écrivis deux articles ayant pour titre : Salomon Reinach, un phénomène. Ces articles firent beaucoup parler d’eux. Ils étaient extrêmement agressifs et provoquèrent certaines réactions hostiles à Reinach. De graves discussions se produisirent au sein de l’Alliance et Reinach dut renoncer à ses fonctions de vice-président. »
« Mon zèle juvénile » : Goldman avait alors seize ans.

Adolphe Crémieux, fondateur de l’Alliance
L’Alliance avait été créée par des Juifs français, reconnaissants envers la France pour son processus d’émancipation entamé en l'an II [7]. Ils avaient décidé de venir en aide aux Juifs du monde en intervenant auprès des autorités politiques des pays où ils étaient encore persécutés, en réclamant pour eux l’égalité des droits, comme en France. Elle avait aussi développé un réseau scolaire visant à moderniser les Juifs d’Orient et à obtenir ainsi leur émancipation. Son objectif plus large était de répandre les bienfaits de la civilisation française dans le monde juif. Ses dirigeants étaient tous républicains et patriotes.
L'Alliance allait surtout se faire connaître en ouvrant des écoles (aussi bien primaires que professionnelles) dans de nombreux pays, en particulier dans les pays musulmans d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ces écoles visaient à fournir une éducation « moderne », aux standards français, à la jeunesse juive locale, mais étaient aussi ouvertes aux non-juifs. Ainsi, en 1939, elle disposait d'une centaine d'écoles et d'environ 50.000 élèves, essentiellement dans le monde arabo-musulman. En raison de ce maillage important, les autorités françaises considéraient depuis les années 1920 l'Alliance comme un outil majeur de l'influence francophone dans le monde.
Ainsi : « …de nombreuses écoles populaires dans les pays des communautés orientales et en Palestine (écoles à Edirne et Izmir, écoles juives d’Istanbul transformées en établissements de l'Alliance, école professionnelle de Jérusalem en 1882). En 1911, plus de 35 % des enfants d'âge scolaire dans la population juive sont inscrits dans les écoles de l'Alliance. »
École de filles de l’Alliance, Jérusalem, 1935
Quel rôle ont joué l’American Jewish Committee et l’Anglo-Jewish Association dans l’adhésion de l’Alliance au projet sioniste en décembre 1945 ? C’est ce que nous ne savons pas.
Salomon Reinach était mort depuis treize ans déjà, et la preuve fut faite que, là comme ailleurs, les intelligences supérieures n’avaient pas trouvé le moyen de se faire entendre des cerveaux binaires.
Où en serait la Palestine aujourd’hui, si la politique de l’Alliance avait été poursuivie ?
Où en serait le Proche Orient ?
Où en serions-nous ?
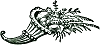
Au lendemain de sa mort, Robespierre dit de Lepeletier de Saint Fargeau, dont il allait défendre et faire adopter le Plan d’Éducation par l’Assemblée :
« Lepeletier fut noble, Lepeletier occupait une place dans un de ces corps si puissants sous le despotisme, Lepeletier fut riche, et depuis la révolution, il fut constamment l’ami du peuple, le soutien de la liberté, et l’un des plus ardents fondateurs de la république. Sous ces trois rapports, Lepeletier fut un prodige. »
Convention, 21 janvier 1793
Sans doute eût-il pu en dire autant de Salomon Reinach.
____________
- Hervé Duchêne, Salomon Reinach devant les hommes et les religions. Préface à Cultes, mythes et religions.
- Préface d’Amalthée, t. I. Paris, Leroux, 1929.
- Hervé Duchêne, op cit.
- Lettres à Liane de Pougy de Max Jacob et Salomon Reinach. Paris, Plon, 1980, p. 175.
- Colette, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, p.1062.
- Elle le restera jusqu’en 1945.
- Le 16 Pluviôse an II, soit le 4 février 1794.
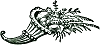
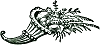
Dans le désordre et bien entendu sans rien d’exhaustif…

Salomon REINACH
Manuel de philologie classique
Paris, Hachette….
…… pages
Salomon REINACH
Cultes, mythes et religions
Paris, Robert Laffont, 1996, 2000, etc.
Collection « Bouquins »,
1350 pages
Note de l’éditeur :
« Il n'y a d'intéressant sur la terre que les religions », notait Baudelaire dans ses journaux intimes. Salomon Reinach (1858-1932) fut de son avis, puisqu'il consacra sa vie entière à l'étude des cultes, des mythes, des croyances, des superstitions. De l'Antiquité gréco-latine à la Gaule gallo-romaine, rien n'échappait à sa curiosité. Et si les frères Goncourt, avec leurs manies de « bibeloteurs » furent à l'origine du musée Carnavalet, Salomon Reinach fut l'un des promoteurs du musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, le musée qui nous renseigne le mieux sur nos origines lointaines, sur nos sources païennes et sur le début du christianisme en France. Salomon Reinach n'étudie pas seulement la manière dont ont été domestiqués nos animaux, il s'intéresse également aux coutumes de mariage de nos ancêtres, au totémisme druidique et à Vercingétorix, à la figure d'Orphée et aux vestales romaines, aux cathares et à Gilles de Rais, à Jeanne d'Arc et à l'Inquisition. Tous les aspects de la vie religieuse le fascinent. Durant des années, il a donné, à des revues plus ou moins savantes, des études extrêmement précises sur des points qui paraissent de détail mais qui sont révélateurs des grands problèmes fondamentaux.
Salomon REINACH
ORPHEUS, Histoire générale des religions
Paris, L’Harmattan, 2002
Collection « Les introuvables »,
628 pages
Note de l’éditeur :
Pourtant résultat d'une commande ministérielle, Orpheus (1909) devait être refusé par l'Éducation Nationale, considérant que la présentation des religions comme un phénomène naturel allait à l'encontre de la morale commune. Sigmund Freud dans Totem et tabou se réfère constamment à cette œuvre. Orpheus ne cesse d'entretenir la curiosité, peut-être moins dans l'idée d'une exactitude historique que dans une perspective anthropologique.

Salomon REINACH
APOLLO, Histoire générale des arts plastiques
professée à l’École du Louvre
Paris, Hachette, 1904, 1952, etc.
352 pages

Salomon REINACH
Epona, la déesse gauloise des chevaux
Paris, Leroux, 1895 (reprint Chapitre.com)
70 pages

Salomon REINACH
L’Origine des Aryens : histoire d’une controverse
Paris, E. Leroux 1892 (reprint Chapitre.com)
133 pages.
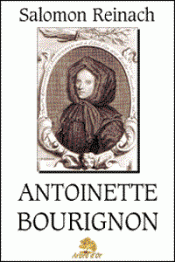
Salomon REINACH
Antoinette Bourignon
Paris, Arbre d’Or, ……
……. Pages
Pour en savoir plus sur cette mystique française très peu connue qui intéressa suffisamment Reinach pour qu’il l’exhume :
http://www.philosophe-inconnu.com/Livres/nouv_bourignon_a...
Henry Charles LEA
Histoire de l’Inquisition au Moyen Âge
Traduit par Salomon REINACH
Paris, Laffont, 2005
Collection « Bouquins »
1504 pages
Note de l’éditeur
L’histoire d’une institution qui, loin d’être une aberration est au cœur même de l’Église. Une réflexion salutaire sur l’intolérance.
Plus que jamais, l’intolérance religieuse travaille nos sociétés ; plus que jamais les rapports entre les états et les églises font problème. Aussi, le grand livre de l’historien américain Henry Charles Lea (1825-1909), unique en son genre, garde-t-il une terrible valeur d’actualité. Il nous permet de comprendre pourquoi et comment, pendant des siècles, l’Église catholique a cru devoir réduire au silence, voire éradiquer ses dissidents. Dès le Moyen Âge, l’Église était devenue un pouvoir économique et politique de premier ordre. Et comme tous les pouvoirs, elle fondait une part de son empire sur des bases matérielles et prêtait le flanc à de nombreuses critiques exigeant le retour à la pureté du message évangélique. C’est pour combattre ces mouvements, dégénérant en hérésies, que les papes ont délégué leurs prédicateurs à travers toute l’Europe, en leur accordant des compétences de plus en plus étendues. Ainsi est née une institution qui, de plus en plus, s’est substituée aux pouvoirs locaux pour broyer toute résistance à ce qu’il faut bien appeler une « pensée unique ». Maîtrisant le latin comme l’allemand, l’espagnol comme l’italien, Henry Charles Lea a parcouru les archives de l’Europe tout entière afin de brosser un tableau complet de cette partie souvent refoulée de notre passé. Cette Histoire de l’Inquisition est aussi une histoire de la liberté de conscience. Qu’elle ait été traduite en français par Salomon Reinach à l’époque de l’affaire Dreyfus et des combats en faveur de la séparation de l’Église et de l’État montre à l’évidence que le combat des Lumières contre l’obscurantisme n’est jamais gagné définitivement.

Salomon REINACH
Gille de Rais
Extrait de la Revue de l’Université de Bruxelles
Liège, Imprimerie électro-mécanique La Meuse, 1904
…… pages
Le texte de ce livre se trouve en ligne ici :
http://www.histoiredelafolie.fr/psychiatrie-neurologie/gi...
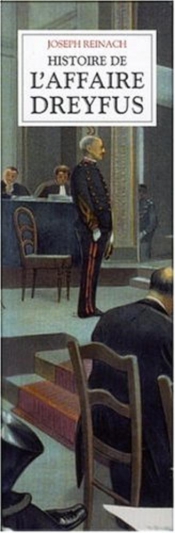
Joseph REINACH
Histoire de l’Affaire Dreyfus en deux volumes
avec une illustration en couleurs en couverture de chaque volume ; emboîtage orné d'une reproduction en couleurs.
Paris, Robert Laffont, 2007
Collection « Bouquins »
2316 pages

Salomon REINACH
SIDONIE ou le français sans peine
Paris, L’Harmattan, 1995.
Collection « Les introuvables »
(reprint de l’édition Hachette de 1911)
…. Pages

Salomon REINACH
CORNÉLIE ou le latin sans pleurs
Paris, L’Harmattan, 1995.
Collection « Les introuvables ».
186 pages
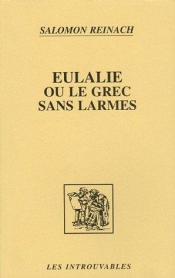
Salomon REINACH
EULALIE ou le grec sans larmes
Paris, L’Harmattan, 2000
Collection « Les introuvables »
196 pages
Note de l’éditeur :
Peut-on apprendre la grammaire française ou pire, celle de langues réputées mortes comme le latin ou le grec, en s'amusant ? Tel est le défi auquel s'est attelé Salomon Reinach au début du siècle, avec succès : à travers ces petits ouvrages drôles et bienveillants, pleins d'historiettes et d'anecdotes, ce sont toutes les chausse-trapes inamicales du français, du latin et du grec qui sont aplanies avec grâce et efficacité.
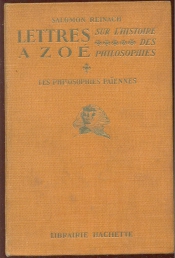
Salomon REINACH
LETTRES À ZOÉ sur l’histoire des philosophies
I – Les philosophies païennes
Paris, Hachette, 1926
185 pages
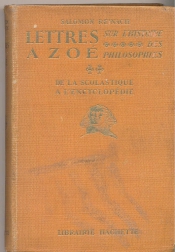
Salomon REINACH
LETTRES À ZOÉ sur l’histoire des philosophies
II – De la scholastique à l’Encyclopédie
Paris, Hachette, 1926
….. pages

Salomon REINACH
LETTRES À ZOÉ sur l’histoire des philosophies
T.III – De l’Encyclopédie à nos jours
Paris, Hachette, 1926
292 pages.
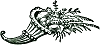
Notice sur Salomon & Théodore Reinach
Académie des Inscriptions et Belles Lettres
http://www.aibl.fr/membres/academiciens-depuis-1663/artic...
N.B. Les emprunts faits par ce post à M. Hervé Duchêne sont si nombreux que nous ne les avons pas mentionnés au coup par coup.
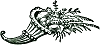
Mis en ligne le 2 avril 2016.
20:57 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs, Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |















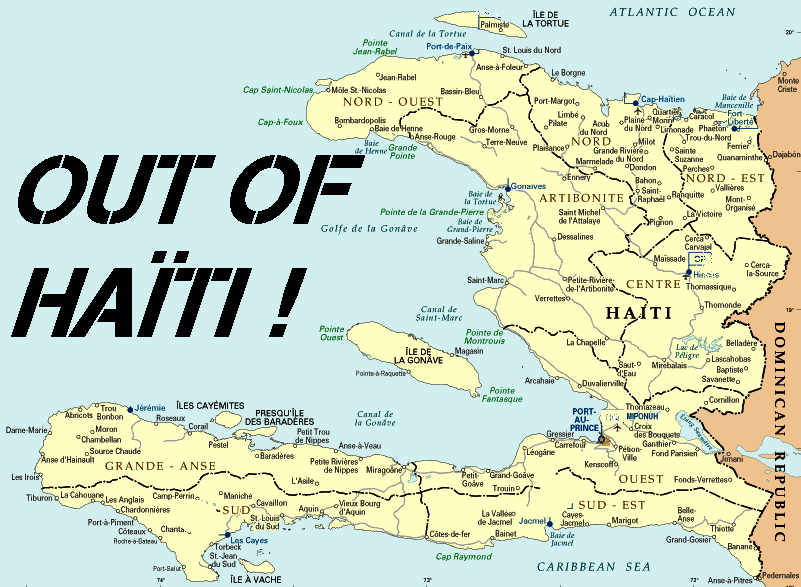







Les commentaires sont fermés.