20/04/2015
LOUONS MAINTENANT LES GRANDS HOMMES
Louons maintenant les grands hommes
Pour mémoire :
Let us now praise famous men est un livre de James Agee, écrivain et de Walker Evans, photographe. Leur titre est une citation de Siracide, aussi appelé Ben Sira, ou encore L’Ecclésiaste, qui disait « Et maintenant, celébrons les grands hommes glorieux qui nous ont engendrés ».
USA 1936. Grande Dépression. New Deal. F.D. Roosevelt veut que l’on enquête sur les populations les plus pauvres du pays et sur le moyen de les aider. Le magazine Fortune commande ce travail à plusieurs journalistes et photographes. Seuls, Agee et Evans feront de cette enquête une œuvre. Les « hommes » dont il est question sont trois familles de métayers blancs du Sud profond et le livre témoigne de leur extrême misère. Fortune ne le publiera pas. Nous lui empruntons son titre.
Pour en savoir plus :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louons_maintenant_les_grands_hommes
Notre post d’aujourd’hui n’a d’autre but que de célébrer de grands écrivains qui viennent de nous quitter et les 27 millions de martyrs soviétiques à qui nous devons d’avoir été libérés du nazisme allemand, si pas du nazisme tout court.
Comme on le sait, les maîtres néocons US n’ont eu qu’à tirer un coup sur la laisse pour que, ne reculant devant aucune bassesse, les gouvernements caniches d’Europe fassent savoir à celui de la Fédération de Russie qu’ils n’assisteraient pas, merci, aux célébrations du 70e Anniversaire de la Victoire de l’URSS et un peu des Alliés sur le IIIe Reich.
Cette insulte a au moins le mérite de ne plus laisser subsister aucun doute sur la vérité historique la plus massivement occultée, à savoir, que le but réel de la IIIe Guerre mondiale a bien été de détruire l’URSS et de s’emparer de tout ce qu’elle représentait : territoires, richesses, populations d’esclaves potentiels, après avoir préemptivement détruit tout ce qui tendait à l’égalité-fraternité en Espagne, et qu’Adolf Hitler, Benito Mussolini et leurs troupes ne furent jamais que le bras armé de ces bourgeoisies du capital baptisées en leur temps, par Philippe Buonarroti, « Parti de l’égoïsme ». Quiconque en doute encore doit se référer sans tarder à Mme Annie Lacroix-Riz, à MM. Jacques Pauwels, Henri Guillemin et aux quelques autres, très rares, que clamer la vérité dans le désert n’a pas rebutés.
Répondre au mépris à l’égard du Jour de la Victoire.
Mikhaïl Vassilievitch Demourine – IA Regnum –8 avril 2015

Celui qui écrit ces lignes est un homme politique, un publiciste et un diplomate de formation. Il est le premier fonctionnaire russe à qui l’Union Européenne ait appliqué des « sanctions » (en droit international : agression, acte de guerre.) en matière de visa, en 2004 Il a quitté le service diplomatique en 2005, en désaccord avec ce qu’il estimait être l’inconséquence de la politique de la Russie envers les pays baltes. Il développe ici un propos mesuré mais très ferme et argumenté, au sujet des (scandaleuses) réactions occidentales à l’invitation de participer aux cérémonies du 70e anniversaire du Jour de la Victoire.
Il faut répondre, dit-il, aux dirigeants étrangers qui ont décliné l’invitation de participer à la célébration du Jour de la Victoire, en excluant de cette dernière leurs ambassadeurs à Moscou.
Cela va sans dire et mieux encore en le disant.
Le problème qui s’est fait jour autour de l’invitation des représentants étrangers aux cérémonies consacrées au 70e anniversaire du Jour de la Victoire a engendré une situation idiote, aux relents mauvais. Alors que je travaillais au Ministère des Affaires étrangères, je me suis prononcé, en 2004, contre l’invitation généralisée des Européens au soixantième anniversaire. Pour quelle raison devrions-nous en effet amener sur la Place Rouge, en cette journée pour nous chérie et sainte entre toutes, ceux qui sont incapables de prendre conscience, ni par l’esprit ni par le cœur, de la signification qu’elle revêt à nos yeux, et plus encore, qui raillent notre fête, que nous célébrons pour honorer les exploits et les sacrifices de nos pères et grands-pères ? Je pense que dans le meilleur des cas, quelques milliers d’Européens seulement, ou même quelques centaines, comprennent que pour le peuple de l’Union Soviétique, la Victoire ne fut pas tant triomphe (bien que triomphe elle fut évidemment aussi) que salut. Nos pertes furent immenses, particulièrement en ce qui concerne les simples citoyens civils exterminés au cours de l’invasion allemande. Ces pertes ne sont pas comparables à celles subies, disons par les Pays-Bas, où elles équivalaient à zéro en cas de non-résistance. Dans les régions concernées, ce furent jusqu’à 80% de nos concitoyens qui furent éliminés, comme en disposait le plan «Ost».
Ceux qui subirent l’occupation allemande en Europe de l’Est et du Sud-est (mais non pas, évidemment, ceux qui la vécurent en qualité d’auxiliaires des occupants) ainsi que leurs enfants, sont les seuls à comprendre de façon adéquate ce qui s’est produit, tant chez eux, que dans la partie européenne de l’URSS au cours des années de la Seconde Guerre Mondiale. La mémoire humaine a la propriété de s’effriter. Mais c’est de manière intentionnelle qu’au cours des dernières décennies, la juste compréhension du sens de cette guerre a été lessivée jusqu’à disparaître des cerveaux européens.
Ce qui s’est produit récemment en République Tchèque est significatif à cet égard. Le Président Zeman s’est élevé contre le diktat américain non seulement de par le caractère humiliant de ce dernier pour le dirigeant d’un État souverain, mais, j’en suis convaincu, parce qu’il a voulu prendre position au sujet de l’objet de ce diktat. Pour le Premier Ministre tchèque Sobotki, beaucoup plus jeune, une telle prise de position officielle sur les plans historique, politique et culturel prend une valeur nettement moins importante.
Tous les politiciens étrangers qui ont décliné l’invitation des autorités de Russie pour le 9 mai l’ont fait sur la base d’une discipline proaméricaine, mais aussi compte tenu de leurs situations spécifiques respectives. Celle de Varsovie est caractérisée par une haine séculaire vis-à-vis de Moscou, liée à la perte de nombreuses possibilités historiques du fait de sa tendance destructrice à envisager sa liberté comme étant en premier lieu la liberté de porter préjudice à la Russie. Que la Pologne étudie donc l’histoire. Qu’elle apprenne que chaque fois qu’elle a pris part à une coalition contre la Russie, et d’autant plus lorsqu’elle en a été l’initiatrice, elle a récolté une défaite historique. Mais tout cela ne lui vient pas à l’esprit.
Quant à ceux qui jouent aujourd’hui un rôle de premier plan dans les pays baltes, leur revanchisme pronazi ordinaire les incite à fonder leur «idée nationale» sur les exploits non pas de ceux qui libérèrent l’Europe du nazisme, mais de ceux qui furent les ennemis de l’Armée Rouge et qui se noyèrent ignominieusement dans l’oubli avec leurs maîtres hitlériens.
Pour l’élite du «petit frère» bulgare, c’est devenu une triste règle historique que de se retrouver à chaque moment critique de l’histoire au côté des ennemis de ceux qui les libérèrent du joug ottoman.
La haine secrète des Anglo-saxons à l’égard de Moscou provient de ce qu’au milieu du siècle dernier, elle fut non seulement la plus puissante sur les plans militaire et économique, mais qu’elle déjoua leurs projets politiques, dès l’entrée en guerre, et jusqu’à la fin de celle-ci, ce qui pour leur morgue «d’arbitre du monde», fut doublement insupportable.
Pour ce qui concerne l’Occident dans sa globalité, il faut évidemment être doté d’un courage intellectuel et moral certain pour admettre l’idée que les Européens s’avérèrent incapables de venir à bout par eux-mêmes du phénomène du national-totalitarisme, qui a grandi sur le sol européen et s’est nourri des sucs de ce dernier, et non de ceux de qui d’autre que ce fut. Il en va de même pour qu’ils admettent que la tâche fut menée à bien par ceux qu’ils considéraient appartenir à une «civilisation» largement inférieure à la leur. Au sein du Vieux Monde, et outre Atlantique, il y eut des politiciens dotés d’un pareil courage, et qui voulaient vraiment se débarrasser de la répugnante peste hitlérienne. Nous les connaissons. Nous nous souvenons d’eux. Mais aujourd’hui ce sont les descendants politiques et spirituels de ceux pour qui cette peste n’était pas du tout repoussante qui ont pris le dessus. En tous cas, elle était acceptable dans la mesure où elle contribuait à résoudre enfin le soi-disant «problème Russie», ce monstre incompréhensible, immense, qui faisait face à l’Europe et refusait on ne sait pourquoi de se soumettre à elle. Aujourd’hui, ils recherchent une nouvelle peste du même genre, pour «remettre la Russie à sa place».
Revenons maintenant à nos invités étrangers à la cérémonie du 9 mai. Comme je l’ai déjà dit, il eut mieux valu ne pas les convier, comme firent, en admettant de rares exceptions, nos pères, qui portèrent cette guère sur leurs épaules. Ils comprenaient clairement qui devait participer à leur célébration. Nous devrions préserver cette tradition et nous en tenir à l’échange de délégations officielles à cette occasion, et seulement dans les cas où existe un intérêt mutuel. Mais une fois l’invitation lancée, donnons-y suite sérieusement. Ne réduisons pas cela à une occasion de se montrer, mais soulignons clairement une solidarité à l’égard du sacrifice et de l’exploit des vainqueurs du mal le plus effrayant qui ait jamais paru sur notre planète. Laissons pour l’opinion publique des pays respectifs de messieurs les dirigeants étrangers, le verbiage selon lequel bien sûr nous reconnaissons «la part» de la Russie dans l’écrasement du nazisme, mais non, nous n’irons pas à Moscou car nous n’approuvons pas la position du pouvoir russe quant à la situation en Ukraine. Car on ne peut s’y tromper longuement ; pour les gens sains d’esprit, il est évident que dans le Sud-est de l’Ukraine se déroule une lutte pareille à celle que menèrent les peuples de l’URSS entre 1941 et 1945. Ceux qui mènent ce combat le font dans le but de pouvoir déterminer leur propre destin, et ils luttent contre ceux qui, s’appuyant sur le soutien de l’Occident, veulent supprimer ce droit et imposer leur propre volonté. Et exterminer ceux qui ne seront pas d’accord.
Que proposerais-je donc de faire vis-à-vis de ces pays dont les dirigeants déclinent sur la base de motifs politiques, l’invitation à participer aux cérémonies de commémoration du Jour de la Victoire à Moscou ? Interdire à leur ambassadeur de participer à ces cérémonies. Vous voulez être à cheval sur les principes ? Et bien nous le serons jusqu’au bout ! Pourquoi ferions-nous preuve de respect à l’égard de ceux qui ne respectent pas ce qui pour nous est sacré ? Ne plus inviter les représentants de tels pays aux cérémonies va tout simplement de soi. Jusqu’à ce qu’ils en fassent eux-mêmes la demande. Il viendra un temps où la Russie sera forte. Alors ils demanderont !
Mais si les ambassadeurs de ces pays sont admis à ces cérémonies, la situation n’en deviendra que plus perverse : on crache sur nous, nous nous essuyons et nous sourions. La ligne de front politique et idéologique traverse aujourd’hui la question du sens de la Victoire du peuple Soviétique lors de la Grande Guerre Patriotique contre l’Allemagne nazie et ses alliés. «Fraterniser» par-delà cette ligne de front est inacceptable. Sinon, la chute nous attend.
Source : http://reseauinternational.net/repondre-au-mepris-a-legar...
Parade de la Victoire Moscou 1945 - Парад Победы
Ceci est l’original de la bande d’actualités filmée à Moscou le 9 mai 1945, sans « re-mastering ». Si vous la visionnez en entier, au bout de 7 minutes 50’ et de 19 minutes 50’ environ, vous verrez les drapeaux pris à l’ennemi avec leur croix gammée, l’emblème bien connu, qui est resté, aujourd’hui, celui des nazis ukrainiens (et des nazies ukrainiennes, n’oublions pas les jolies femmes qui posent pour Elle).
Puis, à la minute 34, lorsque, après le défilé au son de « Stenka Razine », ils jettent les drapeaux par terre, on revoit le sigle à nouveau utilisé aujourd’hui en notre nom par notre Pravy sektor et nos bataillons privés d’Ukraine.
« Le gÉnie, le gÉant, le gÊneur »
« L’INCOMMODE TÉMOIN DU XXe siècle »…

Le 21 mars dernier, en compagnie de Grita Löbsack, épouse de son traducteur espagnol Miguel Saenz, qui allait lui servir d’interprète, un journaliste d’El Païs s’est rendu à Lübeck, dans la maison où vivaient Günter Grass et son épouse Ute.
Les visiteurs furent reçus avec des douceurs sucrées faites maison, d’après une recette laissée par le premier mari d’Ute, récemment venu lui aussi en visite. Ils avaient apporté avec eux un jambon serrano, dont Grass s’était aussitôt mis à « jouer », lui trouvant la forme d’une mandoline italienne. Il était allègre, attentif au monde comme jamais et plein de projets, tels que par exemple retourner au Cercle des Beaux-Arts de Madrid exposer ses dernières œuvres. Il devait s’aider d’un respirateur mais continuait de fumer la pipe. Quelques jours plus tard, une pneumonie l’envoya à l’hôpital, et c’est elle qui eut le dernier mot.
Günter Grass : « La douleur est la cause principale qui me fait travailler et créer. »
Transcription de l’interview inédite accordée par l’écrivain allemand au journal espagnol El Païs, en sa maison de Lübeck, le 21 mars dernier.

Question : En tant qu’être humain, que vous apporte l’écriture quotidienne de poèmes ?
Réponse : Mon premier livre est sorti dans les années 50 et ce fut un livre de poésie avec des dessins. Ce n’est que plus tard que j’ai commencé à écrire un roman : Le tambour. À cette époque, je vivais à Berlin où j’étudiais la sculpture. J’écrivais un roman, et quand je l’achevais, il me fallait changer de moyen d’expression. À ce moment-là, c’était la poésie, parce que je me rendais compte que, en m’identifiant à tant de personnages de mes romans, je m’éloignais de moi-même. Et je voulais y revenir et aussi me mesurer à moi-même, en quelque sorte.
Q : Et vous dessiniez.
R : Quand j’avais dessiné pendant longtemps, il me fallait revenir aux mots, à la poésie. Il me fallait revenir à la rencontre de moi-même et aussi du lieu où je me trouvais, parce que toute mon activité antérieure m’avait éloigné de moi.
Q : Que trouvez-vous, quand vous revenez à vous-même ?
R : Dans les années 50 et 60, j’ai dû me mettre à porter des lunettes, et j’ai écrit un poème où j’y faisais allusion. Dans ce poème, je dis que tout est plus précis mais… en oblique, que les impuretés se voient avec plus de netteté. Et avec les années qui passent aussi, je me rends compte des progrès de l’âge, d’une certaine fatigue des matériaux du corps, et qu’il faut recourir à un atelier de réparation. En même temps, j’acquiers la conscience de ce que tout est « fini », a des limites.
Q : Vous avez toujours eu cette impression, même dans votre jeunesse ?
R : Pour moi, cela a été très clair très vite, parce que, philosophiquement, je n’étais pas sous l’influence de Heidegger mais de Camus. C'est-à-dire que nous vivons maintenant et, maintenant, nous avons la possibilité de faire quelque chose de notre vie. C’est Le mythe de Sisyphe, que j’ai découvert après la guerre. Au fil des années, je me suis rendu compte que nous avons la possibilité de nous auto-détruire, chose qui auparavant n’existait pas, on disait que c’était la Nature qui causait les famines, les sécheresses, toutes choses dont la responsabilité ne nous incombait pas. Pour la première fois, nous sommes responsables, nous avons la possibilité et la capacité de nous annihiler et nous ne faisons rien pour que le monde échappe à ce péril. À côté de la misère sociale qu’il y a maintenant partout, voilà que nous avons le problème du changement climatique, dont nous ne tenons même pas compte des conséquences. On organise une réunion après l’autre et la problématique reste la même : on ne fait rien
Q : Et les problèmes augmentent.
R : On doit y ajouter le problème de la surpopulation. Tout ça mis ensemble me fait me rendre compte de ce que les choses sont limitées, de ce que nous ne disposons pas d’un temps indéfini, Si on tient compte de la durée d’existence de notre planète, il nous faut reconnaître que nous sommes des invités qui y passons un temps très court et déterminé, et que la seule chose que nous allons laisser derrière nous est une poubelle à ordures atomique… Dans les années 70 et 80, j’ai écrit deux romans épiques, Le turbot et La ratte : la capacité de l’homme à s’autodétruire est reflétée par ces romans.
Q : Il n’y a pas un seul de vos livres de prose qui n’aille au centre de votre propre vie, depuis Le tambour jusqu’à Pelures d’oignon ou En crabe… La fiction vous sert à raconter votre réalité intérieure…
R : Oui, et c’est pourquoi je tiens à dire que ce nouveau livre qui va sortir en automne est fait de textes brefs dans lesquels je veux montrer la relation intense qu’il y a entre la prose et la poésie. Normalement, les germanistes séparent les genres. Moi, je veux les voir réunis, parce que je crois qu’ils sont liés : les frontières entre la prose et la poésie, pour moi, ne sont pas définies, elles sont fluctuantes.
Q : Cette association vous permet de mieux dire ce qui vous arrive ?
R : De ma mère, j’ai hérité deux talents : pour moi, ça n’a jamais été un problème de laisser une chose pour m’adonner à une autre… Je veux dire que j’ai deux talents et qu’avec beaucoup de travail, je dois les développer et essayer de m’exprimer en me servant des deux. Choisir entre une chose et une autre n’a jamais été une alternative mais un enrichissement. Par exemple, si j’écrivais pendant longtemps, j’avais la sensation que la sculpture me ferait beaucoup de bien, parce qu’elle exprimait quelque chose de tous les côtés à la fois, quelque chose qui était dans l’espace. Beaucoup de mes poèmes commencent par un dessin : quand l’idée d’une métaphore me vient, je la concrétise sur le papier, et tout de suite, j’en fais un dessin, pour voir si elle tiendra la route ou pas. En composant Trouvailles pour gens qui ne lisent pas [117 aquarelles et 131 poèmes courts, à notre connaissance inédit en français, NdT], je peignais des aquarelles et, avant même qu’elles soient sèches, je commençais à écrire des poèmes de quatre ou cinq lignes. C’est un bon exemple de la manière dont les disciplines (peinture, écriture) se mélangent et s’enrichissent mutuellement.

2005 - Vernissage d’une exposition de ses dessins (Luxembourg, Galerie Clairefontaine)
Q : Humainement, que signifie le travail, pour vous ?
R : Vous avez lu mes livres, et vous savez, comme je l’ai dit dans Pelures d’oignon, qu’à seize ans, j’ai survécu par pur hasard, qu’en trois ou quatre semaines de temps, pendant la guerre, j’ai eu cinq ou six fois l’occasion de mourir comme tant d’autres de mon âge. J’en ai encore conscience aujourd’hui. Travailler le plus possible m’aide à me prouver à moi-même que j’ai survécu, que j’existe et que je continue à vivre, que je suis vivant.
Q : Tout à l’heure, vous avez mentionné Camus. L’œuvre de Camus est une explication ou une expiation de la douleur, une recherche de la survie à travers la littérature. Camus, vous l’appréciez pour cette même attitude ?
R : L’essai sur le mythe de Sisyphe décrit le travail : ce qui est horrible, c’est de soulever le rocher en sachant que cela ne sert à rien, puisqu’il va quand même retomber ; cependant, Sisyphe n’a d’autre possibilité que de le soulever, puisque, s’il ne le fait pas, il sera sans fonction. Camus termine cet essai en disant qu’on peut considérer que Sisyphe était un homme heureux… Pour moi, c’était très important, c’était une nouvelle interprétation du mythe réellement passionnante ; toute la cause, au fond, est dans la douleur. Chaque personne a sa propre situation, et je me suis rendu compte que non seulement je pouvais m’exprimer artistiquement, mais que je devais traiter des thèmes déterminés : celui de ma jeunesse et de la capitulation sans conditions de l’Allemagne, avec la destruction totale de toutes ses maisons mais aussi l’effondrement total de ses habitants.
Q : Une histoire de douleur.
R : Pendant toute ma vie et jusqu’à ce jour, c’est toujours la même chose. Et ce qui est incroyable, c’est que l’histoire de l’Allemagne est une histoire sans fin, parce que l’Holocauste et le génocide sont des crimes horribles ; ils sont une histoire qui ne finit jamais. Nous le voyons bien aujourd’hui en Grèce : une fois de plus, nous sommes confrontés aux problèmes des horreurs causées par les soldats allemands pendant l’occupation… Cette histoire nous suit et nous suit encore… C’est pourquoi j’en reviens une fois de plus au thème de la douleur de Camus : la douleur est la cause principale qui me fait travailler et créer.
Q : Camus a cette phrase : « la belle chaleur qui régnait sur mon enfance m’a privé de tout ressentiment » [L’envers et l’endroit, Préface. NdT]. Votre enfance à vous a-t-elle aussi été capitale pour le développement ultérieur de votre œuvre littéraire ?
R : Dans Pelures d’oignon, il y a une nécrologie de ma mère. Elle est morte d’un cancer à 57 ans. J’étais retourné voir mes parents et ma sœur deux ans après la guerre. Ma mère, ils l’avaient expulsée de Dantzig. Quand je l’ai revue, c’était une femme brisée et vieille…. Quand j’étais petit, je lui racontais beaucoup d’histoires qui sortaient de mon imagination, et l’imagination des enfants est très fertile. Elle disait : « Mensonges d’enfant ». Mais, dans le fond, ces mensonges lui plaisaient. Je lui disais toujours que, quand je serais majeur et que j’aurais de l’argent, je l’emmènerais dans des pays merveilleux et tout ça… Mais comme elle est morte si tôt, je n’ai jamais pu lui prouver que je disais la vérité… Jamais je n’ai rien pu faire pour elle… Elle a été malheureuse quand je lui ai dit que je voulais devenir artiste, mon père y était complètement opposé, mais elle m’a toujours soutenu, et moi, j’ai été malheureux pour elle. Aujourd’hui encore, je suis malheureux de n’avoir rien pu faire pour elle de ce que je lui avais promis. J’ai un complexe maternel prononcé : je ne suis jamais allé chez le psychiatre et c’est la source de toute ma créativité.
Q : Vous dites que, dans Pelures d’oignons, vous racontez l’histoire d’un jeune homme (vous) qui aurait pu mourir et disparaître. Ce n’est pas arrivé, vous êtes là. Mais, d’une certaine manière, est-ce que cette guerre ne vous a pas blessé pour toujours, vous et votre génération ?
R : Sûrement, oui. Nous avons tous été marqués par la IIe Guerre mondiale. Et ses effets les plus terribles sont ceux à long terme… qui n’en finissent pas. C’est pourquoi ma génération est plus attentive aux problèmes du présent, puisqu’il semble que nous nous dirigions vers une IIIe Guerre mondiale sans pouvoir dire comment elle a commencé. La IIe Guerre mondiale a commencé par l’entrée de l’Allemagne en Pologne, mais, au fond, elle avait déjà commencé avec la Guerre d’Espagne. Pour l’Allemagne, l’Italie, l’URSS et les autres, la Guerre Civile espagnole fut l’occasion de tester leurs armes dans un conflit concret. Lorsqu’elle s’est achevée, en 1939, a commencé la IIe Guerre Mondiale. En 1936, le Japon avait commencé par entrer en Mandchourie, puis, de là, en Chine, et on sait quels horribles massacres se sont perpétrés… sans compter qu’il y avait encore d’autres foyers de guerre en Asie… Aujourd’hui, nous avons, d’une part, l’Ukraine, dont la situation ne s’améliore en aucune manière ; en Israël et en Palestine, c’est tout le temps pire ; le désastre que les Américains nous ont laissé en Irak, les atrocités de l’Armée Islamique et le problème de la Syrie, où les gens continuent à se battre même s’ils ont disparu des informations… Il y a la guerre partout, nous risquons de commettre à nouveau les erreurs du passé, dès que nous serons entrés comme des somnambules dans une IIIe Guerre mondiale.
Q : Vous avez écrit Mon siècle sur le XXe siècle et ses méfaits. Ce XXIe siècle prolonge les méfaits et le fanatisme est un lieu commun. Est-il la méchanceté humaine du XXIe siècle ?
R : J’en doute. Je ne dis pas du tout que celui-ci est bon et que celui-là est mauvais, ce serait par trop simplifier les choses… Bush a été un problème… Bush parlait du mal et il ne faisait rien pour y trouver une solution : il conduisait au manichéisme, au blanc et noir… Ce qu’il faut faire, c’est se rappeler les origines de cette histoire. Par exemple, que s’est-il passé après la Ière Guerre mondiale ? L’empire ottoman s’est effondré, on a morcelé les Balkans et le pétrole est devenu primordial. L’Irak, auparavant, n’existait pas, il a été inventé de toutes pièces par les puissances coloniales victorieuses… La Palestine est devenue un protectorat anglais, de même que la Syrie est devenue un protectorat français. Et l’Holocauste a généré le problème palestinien. Tout cela, au fond, n’a été qu’annexions de territoires et, jusqu’au jour d’aujourd’hui, tous les problèmes sont nés de l’attitude des vainqueurs de la Ière Guerre mondiale.
Q : Peut-on espérer que l’homme sera meilleur au XXIe siècle ? Il semble régresser, et vous, en prédisant la IIIe Guerre mondiale, semblez voir l’avenir avec pessimisme.
R : Ce n’est pas du pessimisme. Je me base sur l’expérience et sur les fautes que nous avons commises, quelque chose qu’on peut vérifier historiquement, c’est pourquoi je doute que l’homme s’améliore. Que l’homme soit capable d’apprendre des erreurs du passé est une autre chose. Par exemple, regardons le conflit avec la Russie. Depuis l’effondrement de l’URSS, qui fut un désastre, sont apparus Eltsine et Poutine ! Après quoi sont venus Poutine et Poutine ! Poutine a surgi en 88 et en 90, quand tout s’écroulait, quand en dépit de tous les engagements occidentaux, l’OTAN l’encerclait de plus en plus près. Or, il y a des traumatismes russes, depuis Napoléon et depuis la IIe Guerre mondiale et les 27 millions de morts qu’y causèrent les Allemands, et voilà qu’ils se retrouvent à nouveau encerclés par l’ennemi. Je ne dis pas que ce qu’ils ont fait en Crimée se justifie, c’est injustifiable, mais il faut les comprendre, et c’est ce que nous devons absolument faire : comprendre la Russie.
Q : Et nous ne la comprenons pas.
R : Nous avons perdu la capacité de comprendre les erreurs que nous avons commises depuis 1989. Après la chute de l’URSS, le Pacte de Varsovie s’est dissout, mais l’OTAN a continué imperturbablement, comme si rien ne s’était passé. Il n’y a eu aucune tentative sérieuse pour créer une nouvelle alliance de sécurité incluant la Russie, et ce sont là des échecs terribles. On promet à l’Ukraine qu’elle fera partie de l’Union européenne et qu’ensuite, elle entrera dans l’OTAN. C’est logique, c’est normal que la Russie réagisse avec nervosité. Toutes les réactions de Poutine ont des causes et, puisqu’en Europe, nous avons pris l’habitude de collaborer économiquement et financièrement, il aurait fallu que nous suivions aussi une politique extérieure commune. Malheureusement, nous dépendons beaucoup trop des désirs des Américains, et les États-Unis sont loin de nous et de ce que nous devrons faire. Si les Républicains arrivent au pouvoir, il y aura une nouvelle course aux armements, et il y aura une fois de plus un ennemi terriblement menaçant aux portes de la Russie.
Q : Vous avez créé beaucoup de métaphores. Celle qui a le plus marqué est celle d’Oskar Matzerath. On a l’impression que ce personnage, qui ne voulait pas grandir ni se mêler au monde adulte, refuserait de grandir aujourd’hui aussi…
R : La différence entre le XXe et le XXIe siècles est que le XXe a été caractérisé par ses idéologies, et pas seulement par le fascisme italien, le national-socialisme allemand et le communisme, mais aussi par l’american way of life et par le capitalisme dominant. La seule de toutes ces idéologies qui soit restée est celle du capitalisme et le capitalisme est capable de changer. Cependant, le capitalisme est en train de se détruire : toutes ces quantités irrationnelles d’argent qui passent par le monde entier et qui n’ont rien à voir avec l’économie réelle. Cette irrationnalité n’était pas aussi marquée au XXe siècle. Oskar serait aujourd’hui une personne différente et il lui faudrait luttrer contre des résistances différentes. De plus, il serait plongé dans des milieux complètement différents. Au XXe siècle, Oskar provenait d’un milieu prolétaire et petit-bourgeois et c’est à cela qu’il devait réagir. Aujourd’hui, il serait un computer freak, un hacker ou quelque chose de ce genre, et il lui faudrait vaincre d’autres résistances.
Q : Avez-vous été Oskar Matzenrath ?
R : Non, moi j’ai poursuivi ma croissance.
Q : Vous auriez aimé l’être ?
R : Non, au fond, non. Je ne suis pas semblable à Oskar. Ce qui se passe, c’est que le personnage d’Oskar a des racines picaresques, il joue le rôle d’une espèce de miroir, avec une loupe capable d’allumer un incendie, capable par ailleurs d’exprimer l’infantilisme du XXe siècle, dont je n’ai pas eu envie d’être ni envie de me défendre.
Q : Vous travaillez sous des gravures de Goya. Que vous apporte Goya ?
R : Je travaille en effet sous une série d’eaux-fortes de Goya. Chaque fois que j’atteins un anniversaire important, de ceux qui se terminent par un 0 ou un 5, ma femme m’en offre un, s’il s’en trouve encore sur le marché. Pour moi, c’est comme la mesure de l’artiste, le critère de la vérité. C’est d’une imagination impressionnante, la manière dont il illustre la démence de ce monde ! J’ai plusieurs des Caprichos, de ceux qui montrent qu’il était contre l’Inquisition et la démence de l’Église catholique d’une part, et pour la vie comme elle est, de l’autre… Goya est, pour moi, le grand exemple, celui qui me donne la mesure de ce qui est bien ou mal.
Source :http://cultura.elpais.com/cultura/2015/04/13/actualidad/1428918239_167030.html
Traduction c.l. pour Les Grosses Orchades
N.B. - On peut discuter plusieurs des affirmations de Günter Grass. Ce n’est pas à nous de le faire. Grass est un artiste multiforme digne de la Renaissance, il n’est pas un politique ni un historien. Il se trompe (selon nous) sur des faits, lorsque c’est sa conscience allemande qui parle, lorsqu’un sens catholique du péché obscurcit à ses yeux des réalités qui sont sans ambiguïté à ceux des mécréants.
Un entretien de Günter Grass avec Pierre Bourdieu
(2012 ?)
Si on vous demandait quel grand homme incarne, plus que quiconque, Barcelone, peut-être diriez-vous Gaudi. Nous répondrions sans hésiter Ledesma. Il vient de mourir, le 2 mars dernier, comme nous l’avons signalé dans notre post précédent. Il avait dix ans au début de la Guerre d’Espagne. Il en est indissociable. Son œuvre aussi.
Francisco González Ledesma

Un hommage de Laherrère (Actu du noir) :
https://actudunoir.wordpress.com/2015/03/02/mort-de-francisco-gonzalez-ledesma/
Pour mémoire, une page d’histoire au hasard :
Un épisode peu glorieux, les accords Bérard/Jordana : une trahison
http://www.24-aout 1944.org/IMG/pdf/les_accord_honteux_berard_jordana_.pdf
Une autre plus honorable, hélas privée :
François Mauriac et l’Espagne
http://temoignagechretien.fr/articles/international/lheure-du-choix
Jean Lacouture : http://francois-mauriac.aquitaine.fr/h_engage/htm/contenu/espagne/engage05.htm



« Les voilà, vos terroristes ! »
(François Mauriac, 1939 - Prix Nobel de littérature en 1952)
Eduardo Galeano: « Peu de Palestine reste. Pas à pas, Israël l’efface de la carte »

Eduardo Galeano, l’écrivain sensible, l’homme attachant n’est plus. Il s’est éteint trop vite, trop tôt, le 13 avril, alors qu’il n’avait que 74 ans. Nous lui rendons hommage en publiant un texte qu’il avait dédié à la Palestine. [ASI]
Pour se justifier, le terrorisme de l’État fabrique des terroristes : il sème de la haine et récolte des alibis. Tout indique que cette boucherie de Gaza, qui selon ses auteurs veut en finir avec les terroristes, réussira à les multiplier. Depuis 1948, les Palestiniens vivent condamnés à l’humiliation perpétuelle. Ils ne peuvent même respirer sans permission. Ils ont perdu leur patrie, leurs terres, leur eau, leur liberté, leur tout. Ils n’ont même pas le droit de choisir leurs gouvernants. Quand ils votent pour celui pour lequel ils ne doivent pas voter, ils sont punis. Gaza est punie. C’est devenu une souricière sans sortie, depuis que le Hamas a proprement gagné les élections en 2006. Quelque chose de semblable était arrivée en 1932, quand le Parti Communiste a triomphé aux élections d’El Salvador.
Source : http://reseauinternational.net/eduardo-galeano-peu-de-pal...
Vivir sin medio
Et parce que Raúl Castro est encore, lui, bien en vie (touchons du bois !) et qu’il vient de dire de vive voix, brièvement (50 minutes) mais décisivement, ce que Galeano avait écrit dans Les veines ouvertes de l’Amérique latine, nous lui donnons ici la parole, d’autant plus volontiers que ce remarquable discours a été prononcé, le 11 avril dernier, en présence de Barack Obama, au Sommet des Amériques, le premier auquel il ait été permis à Cuba d’assister.
Soit dit en passant : en a-t-on fait des supputations, quand une espèce de dégel a été annoncé entre l’île et le puissant voisin… C’en était fait des Cubains… les USA avaient enfin triomphé… ils allaient se farcir les imprudents castristes en deux coups de cuillère à pot… etc. etc. La seule hypothèse à laquelle personne apparemment n’a songé, c’est que les USA ont été contraints de réintégrer les Cubains, par les autres pays d’Amérique latine.
Discours de M. Raúl Castro Ruz, président de la République socialiste de Cuba, au VIIème Sommet des Amériques, Panama, le 11 Avril 2015.

Il était temps que je parle devant vous au nom de Cuba. On m’avait informé au départ que je devais parler huit minutes. Alors j’ai fait un gros effort, aidé de mon ministre des Relations extérieures, pour ramener mon discours à ce temps de parole. Mais comme vous me devez six Sommets, ceux d’où nous avons été exclus (rires et applaudissements), j’ai demandé au président Varela, juste avant d’entrer dans cette magnifique salle, de me céder quelques minutes de plus. Surtout après avoir écouté tant de discours si intéressants. Je ne parle pas seulement de celui du président Obama, mais aussi de celui du président équatorien Rafael Correa, de celui de la présidente Dilma Rousseff, et d’autres. Sans plus de préambules, je commencerai donc.
Cher Juan Carlos Varela, président de la République du Panama ;
Chers présidents et présidentes, chers et chères Premiers ministres ;
Chers invités,
Je tiens tout d’abord à exprimer ma solidarité à la présidente Bachelet et au peuple chilien pour les catastrophes naturelles qu’ils sont en train de souffrir.
Source : http://www.legrandsoir.info/discours-de-m-raul-castro-ruz...
En vivo :
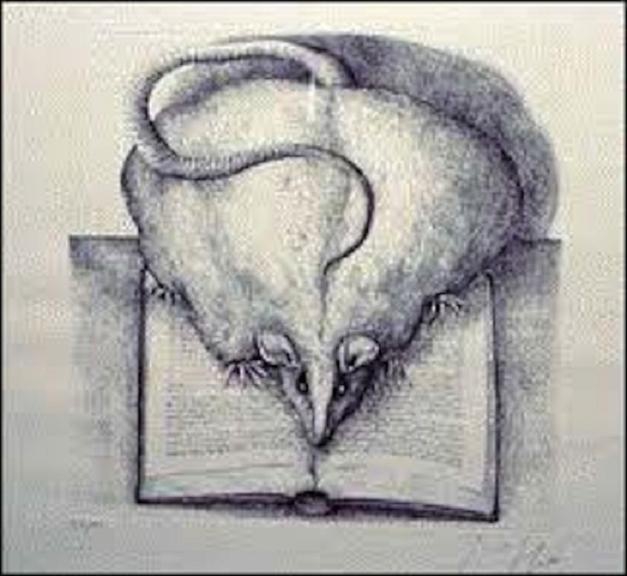
Livres
(oui, chez Günter Grass, les rattes lisent)
Günter GRASS : bien sûr, il faut TOUT lire.
Francisco González LEDESMA : bien sûr, il faut TOUT lire aussi, en commençant par les écrits post-franquistes parus chez l’excellent éditeur français (il en reste quelques-uns) L’ATALANTE, à Nantes, mais il faut lire aussi les autres, les Méndez, etc.
Voir ci-dessous, tout en bas (à vos roulettes), la Postface à Los Napoleones qu’il a écrite pour ses lecteurs français, lors de la réédition de 2001.
Eduardo GALEANO : bien sûr, il faut TOUT lire, à commencer par :

Les veines ouvertes de l’Amérique latine
Plon – Terres humaines – 1998
447 pages
Réédité en Poche (Pocket) - 2001.
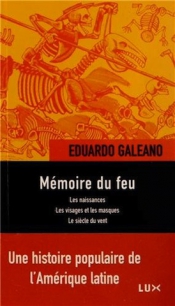
Mémoire du feu : Les naissances ; Les visages et les masques ; Le siècle du vent - (Une histoire populaire de l’Amérique latine)
Lux – 2013 – 990 pages
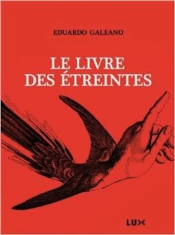
Le livre des étreintes
Lux – 2012 – 250 pages
« Système de la dissociation : On n’est jamais si bien servi que par soi-même. Ton prochain n’est ni ton frère ni ton amant. Ton prochain est un concurrent, un ennemi, un obstacle à franchir ou une chose à utiliser. Le système qui ne donne pas à manger, ne donne pas non plus à aimer : nombreux sont ceux qu’il prive de pain, mais plus nombreux encore sont ceux qu’il condamne à une famine d’étreintes. »
Non sans ressemblance avec les Trouvailles pour gens qui ne lisent pas de Grass : Textes courts, précédés de dessins de l’auteur.
Voir, sur Babelio, le commentaire de mariecesttout
François MAURIAC : au pif, dans une production foisonnante, diverse et longue…
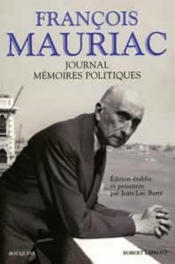
Journal – Mémoires politiques
R. Laffont/Bouquins – 2008
1138 pages
« D'un charnier à un autre charnier, l'humanité n'apprend rien, ne retient rien. La nouvelle guerre est toujours plus stupide, la moins excusable. Nous y courons les yeux ouverts. » (Article paru dans Le Temps, 27 mai 1938).
Georges BERNANOS : « Il faut le lire, absolument ! » (Henri Guillemin).

Les grands cimetières sous la lune
Points – 2014
329 pages
Sur ce pamphlet, voir Simone Weil et Albert Camus
Avant celui-là – en 1931 – il avait écrit :
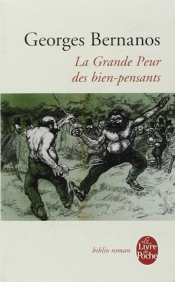
La Grande Peur des bien-pensants
Le Livre de Poche – 1998
414 pages
George ORWELL sur la Guerre d’Espagne, où il fut :

Hommage à la Catalogne : 1936-1937
10/18 – 1999 + Rééd.
293 pages
« Texte fondateur qui préfigure en partie les visions dramatiques du monde totalitaire de 1984, Hommage à la Catalogne est autant un reportage qu'une réflexion sur la guerre d'Espagne. Engagé aux côtés des républicains, Orwell voit dans la trahison des communistes les conséquences du jeu politique stalinien. Il en découlera la prise de conscience d'un nécessaire engagement... »
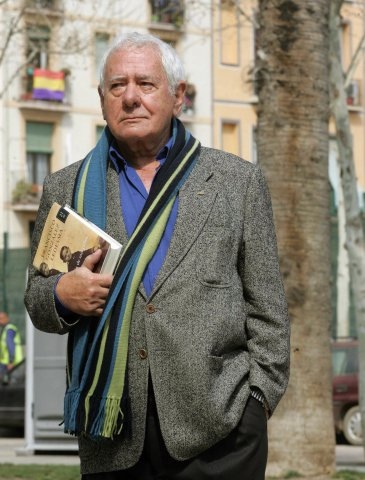
Francisco González Ledesma
Postface (autobiographique) de l’auteur À l’Édition française de LOS NAPOLEONES
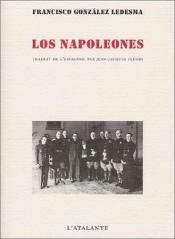
Ce jour-là, cela faisait soixante-douze heures que nous n’avions rien avalé. Nous les plus âgés nous tenions le coup, mais il était probable que mes deux petits frères allaient finir par mourir de faim. C’est pourquoi ma mère – c’était toujours elle qui prenait les décisions – déclara :
– Cet après-midi, il nous faut aller à tout prix au port. Avec les bombardements, il y a beaucoup de bateaux échoués, et à bord on trouvera à manger. Nous irons à la nage et nous prendrons ce qui nous tombera sous la main.
J’avais 12 ans et ma mère 32. Nous ne savions nager ni l’un ni l’autre…
Ce matin-là, j’avais pris une autre décision héroïque, mais tout seul : près de notre maison, sur le Paralelo barcelonais, il y avait des dépôts de l’armée, pratiquement à l’abandon à cause de l’arrivée imminente des troupes de Franco ; la population affamée s’y était précipitée, malgré la présence de quelques sentinelles qui en interdisaient l’accès à coups de fusil. Des gamins de ma rue et moi-même avions décidé d’y pénétrer coûte que coûte.
Et au milieu de cette foule, il nous fut donné, en premier lieu, d’assister à un coup de chance inouï : une des sentinelles tira à hauteur de la tête sur un assaillant et la balle le transperça, mais il se produisit un vrai miracle car le projectile ne provoqua aucun dommage important. Cet homme était en train de hurler : la balle pénétra par une joue, traversa la bouche grande ouverte et ressortit par l’autre joue, sans même frôler une dent. Ce jour-là, j’ai appris bien des choses (dans la mesure où les bombardements et la guerre ne me les avaient pas déjà toutes apprises), et l’une d’entre elles fut que chacun de nous, quoi qu’il fasse, ne mourra que lorsque son heure sera venue. Bien des années plus tard, je fus conforté dans cette idée : un portier du journal de La Vanguardia – dont je devais plus tard devenir rédacteur en chef –, en proie à une dépression, tenta de se suicider ; il choisit la fenêtre la plus élevée de l’édifice et se jeta dans le vide. Mais dans l’un des commerces du rez-de-chaussée on était en train de dérouler un store fermé quelques secondes plus tôt. Le portier s’en sortit indemne, et quelques jours plus tard il reprit son travail.
Si ce matin-là j’appris que la mort ne vient qu’à son heure, j’appris aussi, entre autres choses, qu’il y a des morts absurdes.
Nous parvînmes, mes camarades et moi, à pénétrer dans le dépôt militaire, mais une immense pile de sacs s’effondra sur deux d’entre eux, les enterrant sous leur poids, et les gamins restèrent là à pourrir des jours et des jours, car personne ne déplaça les sacs : le bruit avait couru que les Maures arrivaient, et ceux-ci, comme nous le croyions fermement, allaient nous égorger tous.
Mais tout cela se déroulait le matin, et j’étais en train de vous raconter ce qui eut lieu l’après-midi. Je vous disais que ma mère et moi avions décidé, quoique ne sachant pas nager, d’aller à bord d’un bateau échoué. Nous avions atteint le Paseo de Colón, près des quais, et nous nous trouvions au centre d’une esplanade déserte, lorsque débuta la charge de la cavalerie maure. Je suis persuadé que vous le savez pour l’avoir entendu dire, les Maures étaient les soldats favoris de Franco, ce fervant catholique, sauveur de l’Espagne… et j’espère pour vous, amis lecteurs, que vous ne vous êtes jamais trouvés face à une charge pareille. Tout en brandissant leur cimeterre, les Maures poussèrent d’effroyables cris et lancèrent leur monture dans un galop effréné. Ma mère et moi restâmes allongés sur le sol pendant que la charge passait par-dessus nos corps, et je crois que c’est depuis ce moment-là que j’aime les chevaux, car ils s’efforcent d’éviter les obstacles au lieu de les piétiner. Mais alors que nous essayions, ma mère et moi, d’atteindre en courant un porche pour nous y abriter (des années plus tard, j’ai appris qu’il s’agissait de la maison où avait vécu Cervantès lors de son séjour barcelonais), j’assistai à un spectacle qui m’a profondément frappé et que je n’oublierai jamais : quatre soldats de l’armée républicaine, genou en terre face à la cavalerie maure, en train de tirer avec leurs pitoyables Mauser, disposés à accomplir leur devoir jusqu’au bout. Il n’y avait aucun officier, ils n’avaient pas de drapeau, n’avaient reçu aucune consigne, aucun ordre. Rien que leur sens du devoir. Et si ce matin-là j’avais appris ce qu’était une mort absurde, cet après-midi-là j’appris ce qu’était une mort héroïque.
J’ignore si tous les sacrifices sont inutiles. Il est sûr et certain que celui-ci le fut totalement : les malheureux soldats étaient morts alors que Franco avait gagné la guerre… et qu’il s’apprêtait à gouverner l’Espagne durant presque quarante ans. Cependant, quelque chose s’est gravé à jamais dans mon âme d’enfant : loyauté et sens du devoir. Le 19 juillet 1936, alors que les fascistes tentaient de s’emparer de la ville, j’avais vu bon nombre d’hommes et de femmes aller au-devant de la mort sans autre arme qu’une vieille carabine, sans autre drapeau qu’un bout de chiffon rouge, mais avec un espoir au cœur. Ces quatre soldats de 1939, eux, n’avaient même pas cela, même pas d’espoir. Depuis lors, j’oublie ce qu’il y a de relatif en ce monde, pour me rappeler seulement qu’il existe encore des valeurs absolues, des morts sans sépulture, des héros anonymes et sans médaille, et lorsque j’écris je leur rends sans trêve un hommage silencieux, parce que je sais qu’ils existent, parce que je les ai vus exister. Je reconnais qu’aujourd’hui peu de gens croient en ces valeurs, j’accepte de courir le risque que vous me considériez comme un homme qui n’est plus dans l’air du temps.
J’ai oublié de vous dire la date de ces événements : le 26 janvier 1939, jour de la chute de Barcelone. Et, en disant cela, j’accepte un autre risque : celui de vous inspirer une certaine compassion, car un simple calcul vous permettra de vous rendre compte que l’enfant qui était en train d’apprendre tant de choses est devenu un vieil homme.
Sur la place des Trois Cultures, à Mexico, une plaque rappelle l’ultime bataille que les Aztèques ont livrée – et perdue – en ce lieu. Il y est écrit qu’avec la domination sans partage des Espagnols débuta « un accouchement long et douloureux ». Eh bien, j’ai toujours pensé qu’il en avait été de même pour Barcelone – et ses enfants affamés – en janvier 1939. J’ai vu changer bien des choses, quoique au fond de moi il en subsiste quelques-unes qui, au moins, ont forgé ma personnalité, une personnalité peut-être vaine, mais qui a gardé quelques idéaux et m’a permis de les reconnaître dans les rues de ma ville. Je n’ai pas perdu le souvenir de la mort absurde, pas plus que le respect de la mort héroïque, et mes romans ont redonné vie à ces hommes et femmes qui sont tombés la foi au cœur. Il y a une phrase célèbre qu’a prononcée un instituteur face au peloton d’exécution : « Vous, vous ne savez pas pourquoi vous me tuez, mais moi, je sais pourquoi je meurs. »
Dans le roman que vous avez entre les mains vivent deux personnages aux idées entièrement opposées : Iglesias et Gonzalez Conde (et permettez-moi de vous confier que l’histoire de la liste des fusillés, qui a permis à Iglesias de sortir sain et sauf de la Modelo, est rigoureusement authentique). Nous y trouvons également Ochando, qui a vécu dans la dignité et qui, comme tant et tant d’Espagnols, a accepté un sort indigne, même si est indigne celui qui humilie, non l’humilié. Dans Soldados vit Marcos Javier, le militant communiste, dont le nom m’est venu inconsciemment à l’esprit comme un hommage à un poète « rouge », Marcos Ana, qui après de nombreuses années de prison découvrit que la seule chose qui lui restait, c’était les prénoms de ses parents, Marcos et Ana… et depuis lors il en a fait son nom… Et dans Los Simbolos vit Fernández-Soldat, l’homme qui a lutté et espéré jusqu’au bout, jusqu’au moment où, voyant Felipe González passer ses vacances à bord du yacht de Franco, lorsque la politique est devenue la politique des affaires, il essuie ses larmes avec un mouchoir qui est un bout de drapeau rouge…
Mais ma mémoire n’a pas seulement gardé les morts qui offraient leur dsang pour l’avenir, elle a aussi gardé les instituteurs qui offraient à l’avenir la seule chose qu’ils possédaient : la parole. Dans les écoles gratuites de la République, j’ai eu des maîtres exceptionnels ; l’un d’eux s’appelait Fernández, et des années plus tard j’ai dû refouler mes larmes en le voyant faire des paquets dans une salle des ventes. Cet homme qui croyait en Dieu – et voyait Dieu dans chaque enfant – hante les pages de Los Simbolos, sous le nom de Fernández-Salomon, celui qui fait la classe, même sur les toits en terrasses des quartiers pauvres. Avec des êtres tels que lui, j’ai appris à aimer des choses aussi simples – aussi importantes et aussi mal aimées – que la lumière du matin et la voix des poètes. Une femme, une institutrice, m’a appris à aimer en silence la solitude des femmes, qui parfois ne disposent même pas de la parole comme consolation. Alors que j’étais très jeune, je la voyais tirer vers elle un camarade, le presser contre sa jupe et ensuite éclater en sanglots.
Et les chiens perdus… Comme je les ai aimés dans les rues de cette Barcelone de la faim et du silence qui auraient été odieuses si elles n’avaient été, en même temps, celles de la solidarité ! Nous les enfants du quartier pauvre, nous parrainions un chien qui nous suivait partout, et nous gardions pour lui un morceau de pain que nous n’avions pas et une caresse que nous ne recevions pas. Dans cette Barcelone sans espoir, il y eut de petites choses miraculeuses qui nous remplissaient d’espoir, même si, pour quelqu’un qui rêvait d’être écrivain, une poignée de héros morts, quelques instituteurs mis à pied et des chiens errants représentaient un bien maigre bagage. Mais nous n’en avions pas d’autre.
Je vous ai parlé plus haut d’un « accouchement long et douloureux » ; dans ma ville, il se déroulait sur deux tableaux. D’un côté, c’étaient les prisons pleines, les quartiers misérables et les exécutions à l’aube. Les soldats qui avaient occupé Barcelone ne nous avaient pas égorgés comme nous le craignions sincèrement ; au contraire, ils se montrèrent cordiaux et aimables, et nous aidèrent à survivre. Mais dans leur sillage, venaient les tribunaux militaires qui, eux, étaient sans pitié. Chaque matin, sur les plages de Somorrostro et de Pékin, on exécutait des dizaines d’hommes et de femmes dont il fallait effacer jusqu’au souvenir. Amis lecteurs, si vous visitez Barcelone et que vous vous promenez dans la nouvelle Ville olympique construite sur ces plages, sachez que ses fondations plongent dans une lagune de sang.
L’autre aspect de cet accouchement qui modifiait tellement la ville était placé, pour bien d’autres, sous le signe du bonheur, une rage de bonheur. Étaient alors apparus des personnages qui ont marqué à jamais ma communauté, et je crois qu’il est intéressant de leur consacrer quelques mots, eux à qui j’ai dédié quelques pages dans mes romans. Certains faisaient partie des « vainqueurs », c’étaient les « occupants », les « sauveurs de l’Espagne », des justiciers avec un pouvoir – et par là même un bonheur – que n’avaient pas connu autrefois les seigneurs féodaux eux-mêmes. Dans leur ombre prospéraient les profiteurs, les « fidèles du régime » en quête d’une prébende ou d’une place au soleil, quand bien même ils devraient pour cela écraser père et mère… Et avec eux apparaissaient les nouveaux industriels, les nouveaux commerçants, les nouveaux riches, qui officiellement « développaient le pays », alors qu’ils n’étaient en réalité que des industriels et des commerçants de la faim. Je les voyais toutes les nuits attendre les choristes du Teatro Cómico sur le Paralelo, dans leurs luxueuses automobiles, et, entreprenants et canailles, leur tripoter les fesses avant même qu’elles fussent montées à bord ; je les voyais également dans des endroits chics, et qui même sentaient bon, aujourd’hui disparus, comme le Rigat, sur la place de Catalogne – sur l’emplacement de l’actuel Corte Inglès –, où des demoiselles sans fortune promenaient leur cul et cachaient une larme secrète. Il y avait aussi le Llibre, à l’angle de la Gran Vía et du Paseo de Gracia, où se trouve actuellement l’hôtel Avenida Palace, ou bien encore le Parador del Hidalgo, sur le Paseo de Gracia, entre les rues Valencia et Mallorca, ces lieux où de vraies jeunes filles passaient leur temps à attendre les messieurs, les hidalgos, en exhibant leurs jambes croisées, leur regard perdu et leurs dix-sept ans de crève-la-faim. Tous les soirs elles étalaient là leur nécessité de gagner quelques pièces, leur avidité qui, au bout du compte, était une forme d’espoir. Et c’est ainsi que naissait une nouvelle ville…
Ce roman auquel vous avez consacré un peu de votre temps est en partie l’histoire de ces hommes et de ces femmes et je peux vous assurer que sur bien des points il est rigoureusement authentique. Toutes ces familles, je les ai bien connues en tant qu’avocat, lorsqu’elles me confiaient leurs intérêts, parfaitement résumés en une simple phrase – gagner vite de l’argent ! – et plus tard en tant que journaliste, après avoir abandonné une profession lucrative pour me lancer dans l’aventure de la presse et de la rue, car je me sentais incapable de me regarder dans la glace chaque matin. Mais je n’eus aucun mérite en cela : c’était l’ultime tentative pour sauver cette part de moi-même qui venait de mon enfance.
Comme il n’y a jamais de miracle, il convient certainement d’expliquer comment un gamin affamé est devenu un avocat doté d’un certain prestige. Tout cela, je le dois aux souffrances, de ma mère, qui, la journée durant, travaillait comme couturière pour les pauvres, et à sa sœur, l’inoubliable tante Victoria, qui était à Saragosse modiste pour les riches. C’est elle qui m’accueillit chez elle et décida que je devais devenir quelqu’un. Ma tante Victoria portait en elle la force, l’acharnement et l’orgueil, c’est-à-dire l’unique patrimoine des morts de faim de l’Espagne profonde, et cela lui venait en droite ligne de ceux qui avaient su se battre la tête haute : son père, mon grand-père maternel, était boulanger à Logroño, et le jour où son patron lui avait dit qu’il était trop vieux pour travailler et qu’il ne pouvait plus porter les sacs de farine, piqué dans son orgueil, il descendit l’escalier du fournil portant un sac sur le dos (la descente est plus difficile que la montée) et le patron assis dessus.
Ce roman est donc l’histoire de gens que j’ai connus ; j’ai été témoin de leurs manigances dans leurs bureaux, et parfois de leur mort dans leur lit. Je les ai appelés Los Napoleones car ils ne pouvaient se réclamer d’aucune légitimité, ils avaient commencé très bas et ils finirent par n’avoir comme credo que leur seule ambition. Ils estimèrent que leur pays et leur liberté étaient à jamais écrasés, ils perdirent leurs idéaux – pour autant qu’eux ou leur père en aient jamais eu – et firent de l’argent le bien suprême. Leur histoire est celle d’une gigantesque corruption morale, mais on ne peut nier qu’ils aient développé leur pays ; à mon grand regret, les ans m’ont appris qu’en général les bons écrivent des poèmes ou des paroles de chanson, alors que les méchants ouvrent des commerces, créent du travail et savent choisir la meilleure terre, non pas pour y mourir mais pour y planter leur semence.
Dans ce roman, donc, j’ai évolué dans le monde de la réalité, mais je n’en étais pas à mon premier essai. Barcelone, au-delà de son intense activité commerciale, a toujours eu un fond libéral, et en son sein sont nés tous les épisodes de violence toutes les révolutions et, si l’on veut, tous les idéaux disparus. Aussi, poussé par ce que je voyais dans les rues et par une force à laquelle j’étais incapable de résister, je commençai à écrire, à l’âge de seize ans, un roman intitulé Sombras viejas [Ombres du passé] que je terminai trois ans plus tard. J’y racontai la vie des étudiants de gauche avant 1936, évoquant leur idéalisme et leur fin tragique lorsqu’ils se rendirent compte, en 1939, qu’on avait détruit la ville qu’ils avaient rêvée. C’est aussi l’histoire de la première révolution « rouge » fomentée par le gouvernement catalan lui-même et son président, Lluis Companys, qui périt quelques années plus tard, fusillé par les franquistes dans les fossés du château de Montjuich, en demandant une seule faveur, celle de mourir pieds nus, en contact avec sa terre. Sombras viejas est aussi l’histoire de la solitude de deux femmes sans autre compagnie que celle d’un souvenir et d’une ombre qui évolue parfois dans l’air.
Ce premier roman connut un sort tout à fait dans l’air du temps à cette époque-là : un grand éditeur, qui avait été « rouge », Josep Janés, avait créé le Prix international du roman, dont le jury était présidé par Somerset Maugham, et je le gagnai avec cette œuvre à l’âge de vingt et un ans. Est-il besoin de préciser qu’à vingt-deux ans, j’étais auteur d’un roman que la censure franquiste avait interdit par deux fois, et la seconde fut définitive ?
Sombras viejas est donc la première œuvre de celles que j’ai écrites sur ma ville natale ; vient ensuite Los Napoleones que vous venez, amis lecteurs, de découvrir. La troisième – en s’en tenant à la chronologie historique – est Le Dossier Barcelone, la quatrième Soldados et la cinquième Los Simbolos. Ce cycle de Barcelone – et de ma vie – s’achève avec Cenizas [Cendres], qui montre que les idéaux constituent l’ultime refuge – probablement illusoire – de la mémoire.
Ma ville est la protagoniste de tous ces romans, avec les péripéties qu’elle a vécues, et moi avec elle, avec son histoire la plus récente, celle d’hommes et de femmes oubliés qui, peu à peu, n’ont rien laissé dans ses rues, pas même une ombre.
L’histoire de ses rues – plus précisément celles des quartiers ouvriers où je suis né – est à l’origine d’une série de romans policiers ayant pour héros le vieil inspecteur Méndez. J’ai quelque réticence à les inclure dans le genre trop ambigu ou trop vaste, qu’on appelle « roman noir », car il s’agit plutôt de radiographies de la société (du moins telle était mon intention, peut-être vaine) où l’on voit palpiter le passé d’un quartier populaire parmi les plus célèbres du monde entier : le Barrio Chino, selon une terminologie d’autrefois, ou cinquième district, aujourd’hui intégré dans le district de la Vieille Ville, lui aussi bien trop vaste et ambigu. J’ai choisi la technique et l’intrigue policières parce qu’elles permettent de se plonger dans la vie secrète des villes, laquelle ne peut probablement pas s’expliquer d’une autre façon.
Méndez a déjà fait l’objet d’interviews et même d’un article dans une encyclopédie, mais je ne voudrais pas terminer cette postface sans le citer, car même s’il n’a pas existé réellement, il est la combinaison de quatre personnes, elles, bien réelles. De ces quatre policiers que j’ai connus est né Méndez, mon ami, mais un ami chicaneur, à manier avec des pincettes, et de surcroît mal vu des autorités.
Tous les autoportraits ont quelque chose de faux parce que ce que l’on a vécu s’y mélange avec ce que l’on a rêvé – et peut-être est-ce là que réside vraiment le réel –, et parce qu’ils sont l’expression d’un échec, étant donné que l’on n’écrit jamais ce qu’on aurait voulu écrire.
Mais du moins suis-je parvenu à mettre un point final à ce roman, et vous lecteurs, avez-vous eu l’amabilité de le lire jusqu’au bout… Je ne sais trop si je dois vous présenter mes excuses ou vous dire de tout cœur merci.
Francisco González Ledesma
avril 2001.
Dernière minute :
Grèce
19 avril 2015
Les prisons de type-C sont abolies ! La grève de la faim s’achève
Une batterie de lois a été validée par le parlement grec : abolition des prisons de type-C, décriminalisation du port du masque en manifestation, expertise indépendante de l’ADN, libération des prisonniers invalides de longues peines, rétrécissement du cadre d’enfermement des mineurs et en général, libération de milliers de personnes sans-papiers.
|
Newsletter hebdomadaire du Secours Rouge - Pour lire les articles, cliquez sur le titre - Pour vous désinscrire, envoyez-nous un e-mail avec 'STOP' comme objet |
Voir le dossier: Grèce
Mis en ligne le 20 avril 2015.
Nos bateaux d’aujourd’hui :
Bombardement d’Alicanthe, 1938.
22:12 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs, Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |















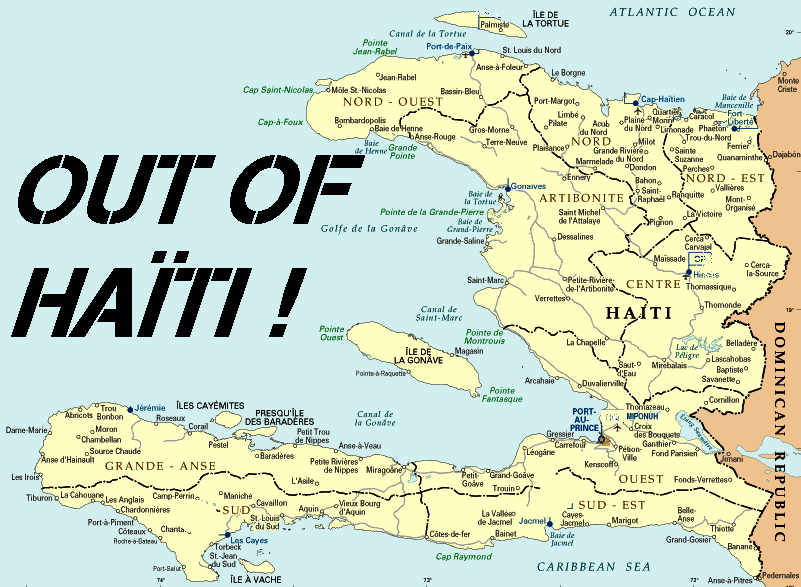








Les commentaires sont fermés.