09/02/2017
ESPRIT DE L'ESCALIER - II - Un roman allemand
Esprit de l’escalier…
II.
Un roman allemand
« La situation en général, cette chienlit qui se nomme le présent… »
Günther Grass, Toute une histoire
En hommage à Manuel de Diéguez (suite)

En 1995, au moment où le Mercure sortait, à Paris, Le testament français, premier roman d’Andreï Makine, qui allait lui valoir les prix Goncourt et Médicis et un jour le conduire à l’Académie, les éditions Steidl Verlag publiaient, à Göttingen, le 11e roman de Günther Grass, Ein weites Feld (en français, Toute une histoire) qui vaudrait à son auteur « un extraordinaire déchaînement de critiques haineuses ». Comme lorsque, par exemple, le critique-vedette Marcel Reich-Ranicki (sorte de Bernard Pivot d’Outre-Rhin) s’est fait photographier en train de déchirer ce livre avec hargne et a permis que la photo paraisse en couverture du Spiegel (août 1997). Il est des lynchages qui ont valeur de distinction plus honorable qu’un prix Nobel. Il est même des auteurs auxquels il est donné de comparer les deux.
En cette année 1995, où la patrie d’origine d’Andreï Makine, exsangue, achevait d’être mise en coupe réglée par « Eltsine et sa clique », celle de Günther Grass subissait le même sort aux mains de l’Allemagne de l’Ouest et du camp occidental. Mais ce ne sont pas là les seuls points communs entre les deux livres.
Si celui de Makine raconte l’histoire et l’ascendance française fantasmée d’un jeune Sibérien, celui de Grass raconte l’histoire et l’ascendance française fantasmée d’un jeune Prussien devenu vieux, qui assiste, le jour de ses 70 ans, à la chute du mur de Berlin et au dépeçage de sa patrie, feue la République des Ouvriers et des Paysans. En revanche, si la grand’mère française du héros de Makine n’est pas sa vraie grand’mère, le héros de Grass a, sans le savoir, une petite-fille française bien réelle quoiqu’illégitime. Mais n’anticipons pas.
Enfin, dans Requiem pour l’Est de Makine et dans Toute une histoire, deux jeunes femmes accouchent, en 1945, dans des conditions effroyables, des œuvres de deux soldats allemands. Mais leur descendance connaîtra de bien différentes destinées. L’une sera dostoïevskienne, l’autre… toujours en cours, réussira une percée dans le futur.
Le travail de très grand artiste de Günther Grass a été de sertir ce tournant majeur de l’histoire d’Europe dans une continuité de deux siècles, en prenant pour double pivot deux écrivains allemands, nés jour pour jour à cent ans de distance (31 décembre 1819 pour l’un ; 31 décembre 1919 pour l’autre) et en suivant le cours – historiquement répétitif – de leurs existences particulières et des événements auxquels ils se sont trouvés mêlés.
L’un de ces deux hommes est le très réel Theodor Fontane, écrivain emblématique du XIXe siècle allemand, dont seul notre nombrilisme a fait qu’il soit resté inconnu du grand public francophone, mais dont le roman le plus célèbre fut comparé en son temps à Madame Bovary et méritait de l’être. Un pilier, donc, de la culture germanique.
L’autre, son double, qui s’appelle aussi Theodor, est un écrivain fictif, création pure de Günther Grass, dans lequel on peut se permettre de voir aussi, plus ou moins, l’auteur lui-même.
Sachons seulement que le personnage contemporain ne fait pas que porter le même prénom et qu’être né à cent ans juste de son illustre prédécesseur, mais qu’il lui voue un véritable culte, connaît son œuvre par cœur à la virgule près et finit par s’identifier à lui jusque dans les détails de sa vie personnelle. [Quand on a eu sous les yeux la quasi osmose Blavier-Queneau, on sait que ces choses-là se produisent dans la réalité et qu’elles sont rarement sans conséquences.]
Sur ce clavier, à la fois tempéré et colossal (mot cher à son principal personnage), Grass pratique l’art de la fugue en virtuose.
Qui n’a pas, étant enfant, zieuté avec ravissement, dans un tube en carton appelé kaléidoscope, les images, nées du moindre mouvement, de ces merveilleux petits losanges colorés, multipliés à l’infini par de mystérieux miroirs ?
Je ne suis hélas pas de taille à rendre compte de la forme de ce roman extraordinaire, mais Juan Goytisolo lui a, en orfèvre, consacré une quinzaine de pages (47-62) de ses Cervantiades, que le lecteur curieux trouvera ICI. Pendant que j’y suis, je citerai aussi le bel Avant-Propos de Marie-Hélène Quéval et l’étude de Marie-Sophie Benoît : Réécriture et déconstruction. Entre autres.
Côté « grande presse hexagonale », M. Angelo Rinaldi, pour ne citer que lui, s’est joint à la meute des lyncheurs d’Outre-Rhin et l’a fait avec les armes du parisianisme ordinaire, se contentant de quelques gloussements dédaigneux sur l’inimportance de Fontane, affirmant comme une évidence que le livre de Grass ne valait rien et l’achevant d’un désinvolte « ah, la la, quel ennui ! ». Au service de L’Express, il ne pouvait pas faire moins, et l’essentiel n’était-il pas de dissuader les curieux d’y aller voir ? Mission accomplished. Comme cette haute critique traîne toujours, depuis 1997, sur le net, la voilà.

Cervantès ! Le grand mot est lâché, et pas seulement parce que Grass, qui dessinait lui-même les couvertures de ses livres a illustré celle-ci de son couple de personnages inséparables : un grand homme maigre et droit à moustache et un petit être tout rond qui le suit comme son ombre. Il y a une raison profonde au rapprochement que fait Goytisolo entre l’œuvre de Grass et celle de Cervantès, bien que les Don Quichotte et Sancho modernes soient très différents de leurs prédécesseurs espagnols : ils vivent, eux aussi, une transformation terrible de leur patrie, la fin inéluctable du monde qui leur est connu et l’avènement inimaginabble d’un autre. Sans compter que les deux auteurs sont l’un et l’autre des soldats rescapés d’une guerre mémorable.
L’histoire et les personnages
Le Theodor d’aujourd’hui s’appelle Wuttke, et sa marotte l’a fait surnommer Fonty. Il a fait la guerre dans la Luftwaffe, mais seulement comme journaliste correspondant de guerre, pour devenir, après les hostilités, en RDA, instituteur, puis conférencier littéraire et enfin appariteur-coltineur de dossiers dans les ministères. Mais il est aussi, ne l’oublions pas, la réincarnation de Theodor Fontane.
Tantôt Hoftaller, tantôt Tallhover, son « vieux compagnon », qui l’espionne sans désemparer, est sans âge et aussi vieux que la police politique. Il traquait déjà le jeune Marx et a connu la révolution de 1848, l’unification de 1871, la république de Weimar, le IIIe Reich, la défaite… Imaginé par Metternich et mis en littérature par Schädlich, il a travaillé pour Bismarck, pour la Gestapo, pour la Stasi, aujourd’hui pour l’Ouest – CIA ? MI6 ? SDECE ? allez savoir – « Votre Seigneurie espionnante… Votre Mouchardante Altesse… », éternel Restif de tous les Sartine, que Fonty appelle aussi « mon ombre-diurne-et-nocturne ».
Ce très vieux couple de l’intellectuel progressiste et de son espion permet à Grass de déployer sa vision stéréoscopique de l’histoire, vision qui fait en même temps, de l’Allemagne et de la France, un animal à deux têtes (ou une bête à deux dos c’est selon), non seulement parce qu’elles sont géographiquement accolées, mais pour toutes sortes d’autres raisons dont un certain nombre de guerres et quantité de mouvements de populations, tantôt dans un sens tantôt dans l’autre : invasions, exodes, immigrations économiques et autres, le va et vient remonte aussi loin que la présence humaine en Europe et n’a jamais cessé. D’ailleurs, la France n’est-elle pas franque, donc germanique, au moins depuis Clovis ?
J’ai dit que Wuttke-Fonty se fantasme une ascendance française. C’est que celle de Fontane l’était vraiment : cet auteur qui incarne tellement l’Allemagne descendait d’un Fontaine du Languedoc, chassé de son pays lorsque Louis XIV avait révoqué l’édit de tolérance religieuse de son grand-père Henri IV, et devenu sujet du roi de Prusse en vertu de l’édit de tolérance du joueur de flûte de Sanssouci.
Au moment où déferlent quelques Moyen-Orientaux (1 million en 2015) sur une Europe de 743 millions d’âmes qui fait des manières, Günther Grass rappelle sans en faire un plat qu’au temps du Grand Frédéric Berlin comptait, abstraction faite des juifs et des Polonais, pour dix mille Allemands, cinq mille Français. D’où le nombre d’officiers prussiens de la guerre de 70 qui portaient des noms hexagonaux, d’où Lothar de Maizière, dernier ministre-président de la RDA, qui fut chargé de négocier l’annexion de son pays par la RFA.
« On l’épargne encore pour l’instant, parce que le Chancelier va avoir besoin de lui pour des signatures. » (p.189)
D’où l’actuel ministre de l’Intérieur de l’Allemagne merkelienne, Thomas de Maizière, cousin de l’autre.
Voyez les hasards de la guerre : Wuttke-Fonty, caporal sous Goering et « correspondant de guerre » plus ou moins chargé, par chantage de son ombre, d’espionner les troupes d’occupation en France, noue une idylle avec une jeune Française, fille d’un cafetier de Lyon, dont le frère est dans la Résistance. Parce que cela lui permet de semer à tous vents le verbe de son idole, il se laisse persuader de collaborer aux tentatives de démoralisation des troupes dont il fait partie en lisant quelques-unes de ses pages préférées au micro de leur radio clandestine. Ses interventions sont enregistrées lors de promenades en barque sur le Rhône ou autour de l’Île Barbe, pour éviter les oreilles qui traînent (il y a aussi beaucoup de promenades en barque dans Fontane), précautions qui n’empêchent cependant pas que tout le noyau de résistants se fasse arrêter, torturer et tuer, non par les Allemands déjà en pleine déroute mais par la milice.
Replié avec le reste des troupes, Fonty ignorera toujours que sa Madeleine est enceinte, qu’elle sera tondue à la Libération, peut-être par ceux qui avaient tué son frère, promenée par les rues affublée d’une pancarte « pute à boches », et qu’elle se réfugiera, rompant avec tout et tous, dans une masure en ruines des Cévennes, où elle mettra une petite fille au monde avec la seule aide d’une vieille cueilleuse de champignons, et où elle vivra jusqu’à sa mort dans le souvenir de son amoureux et de son culte de Fontane. Masure où viendra un jour pourtant la rejoindre sa petite-fille, Nathalie, qui voudra porter son nom à elle - Madeleine -, apprendra l’allemand, étudiera l’œuvre de Fontane, en fera le sujet de sa thèse de doctorat, et ira jusqu’à profiter du procès Barbie pour faire attribuer à « son grand-papa » une légion d’honneur (pour faits de résistance) qu’on n’ira pas jusqu’à lui remettre officiellement – elle devra s’en charger en privé – et qu’elle lui épinglera, à leur première rencontre, au cours d’une promenade en barque autour de l’île Rousseau. Ah, les promenades en barque chez Grass et chez Fontane ! Mais voilà que j’anticipe encore…
Non seulement Fonty ne se doutera de rien mais il n’essayera pas non plus de s’inquiéter de sa belle. Il faut dire que, rentré dans un Berlin dévasté, après des mois passés dans un camp de prisonniers, il y trouvera son premier fils, mis au monde peu avant sa première fille par une fiancée qui l’attendait et qu’il épouse d’autant plus volontiers qu’elle porte le même prénom que la femme de Fontane et qu’elle vit dans l’appartement d’une sienne tante, miraculeusement resté debout. Ils auront d’autres garçons et une fille. Les garçons, en vacances à l’Ouest au moment de l’érection du mur, choisiront d’y rester et deviendront de parfaits étrangers pour leur père. Pire : des étrangers hostiles. Seule la fille lui restera, qu’il identifiera, bien sûr, à celle de Fontane.
Mais Fonty nourrit encore d’autres fantasmes : parce que le vrai Fontane a vécu une partie de sa vie en Angleterre et s’est un peu voulu le Walter Scott allemand, il ne fait pas que se rêver à Londres ou sur les bords de lochs écossais, il essaie vraiment d’y aller, tentative d’évasion à laquelle son « ombre diurne et nocturne » a tôt fait de mettre un terme et qui n’est pas sans rappeler celle, avortée aussi, du jeune Frédéric II.
Mais les parcours parallèles de Théo Wuttke et de Theodor Fontane ne sont que le moyen par lequel Günther Grass a produit son Nième chef d’œuvre. Ce qu’est en réalité Toute une histoire, c’est LE grand livre qui témoigne pour les siècles futurs de ce que furent la chute du mur de Berlin et la réunification subséquente de l’Allemagne. Il témoigne aussi de l’aversion extrême de l’auteur pour une réunification qui ne fut en réalité qu’une brutale annexion ressemblant bien fort à une colonisation intérieure. La violence du lynchage des « puissances conformes » fut à la mesure de la violence de son rejet.
Treuhand et Paternoster
Le roman de la « réunification » de l’Allemagne est une tragédie en prose. Comme toute tragédie, elle a son chœur grec, à savoir, les narrateurs anonymes …
« Nous autres qui, aux Archives, sommes les survivants parmi les esclaves voués aux notes en bas de page. »
… qui tiennent un discours tantôt collectif tantôt individuel – au masculin ou au féminin –, annoncent l’action, la racontent ou la commentent, tandis que Wuttke-Fonty, qui a été repêché par les nouveaux maîtres (la Treuhand, société fiduciaire chargée de liquider c’est-à-dire de privatiser pour des clopinettes les biens publics de la RDA), monte et descend les dossiers à détruire ou récupérer, à bord du Paternoster.

Autre invention géniale de Grass, cet ascenseur à la fois vertical et circulaire – monte-charge des Archives secrètes – qui tient ici le rôle de la roue de la fortune chère aux artistes du Moyen Âge et de la Renaissance, où Fonty et « Nous des Archives » voient tour à tour monter et descendre les bottes cirées à s’y mirer du Reichsmarschall Hermann Goering, Walter Ulbricht et sa barbichette, et enfin, après une kyrielle d’apparatchiks, le costume trois-pièces made in London du patron occidental de la Treuhand, tous apparaissant et disparaissant par petits bouts, au fur et à mesure que s’élève ou que redescend le Paternoster.
Soit dit en passant…
« … cela [la Treuhand] faisait revenir en grâce un mot qui avait déjà revêtu autrefois une considérable importance – pendant toute la durée du IIIe Reich, qui partout avait mis les biens et la fortune des Juifs d’Allemagne sous Treuhand, sous administration fiduciaire. »
Raccourci saisissant, dit Goytisolo, qui ajoute : « En même temps, il se voyait lui-même atteindre sa cabine ascendante à différentes époques. Il comprenait la mécanique du changement sous la forme d’un ascenseur inlassable toujours prêt à offrir ses services. Tant de grandeur. Tant de descentes. Tant de fins et de commencements. »
Ce « désenchantement lucide » pousse Fonty à exprimer une vue des choses qui semble de plus en plus être celle de son auteur :
« Sept mille privatisations programmées et deux millions et demi de postes de travail menacés […] Ne peut-on pas comparer ce qui se passe aujourd’hui à la terreur, à la guillotine et au vertueux Comité de salut public ? Des millions de travailleurs et d’employés sont soumis à un processus de décapitation en vertu de quoi on ne coupe plus leur tête aux individus, mais leurs ressources, en supprimant leur poste de travail sans lequel ils sont sans tête, du moins dans ce pays. »
On lui pardonnera cette phrase et ce Comité de salut public guillotinant les pauvres comme un vulgaire sommet de Davos, tant il est vrai que nul n’est absolument indemne d’idées reçues, puisque même Kropotkine…
Pourquoi la mariée pleura
Un des moments forts du livre, qui en compte beaucoup, est le mariage de Martha, la fille de Fonty, que son père appelle « Mete », dans le quartier berlinois de Prenzlauer Berg, peu de temps après l’union monétaire, où toute la parenté de l’Est et de l’Ouest est rassemblée. C’est un chapitre d’anthologie.
Cette jeune femme de 38 ans, enseignante à poigne, ex-membre du Parti, a fini par se trouver un mari quand personne n’y croyait plus. Le marié est un homme d’affaires dans la cinquantaine, grand repreneur et promoteur immobilier sous le soleil capitaliste.
Les fils éloignés n’ont pas trouvé d’excuse pour s’abstenir (plus de mur !). Friedel, qui a participé au mouvement estudiantin de 1968, brandi le petit livre rouge de Mao et distribué des posters de Che Guevara avant de se faire une situation comme chef d’une maison d’éditions théologiques, fustige avec énergie « ces criminels » de l’Est qui ont « foutu la jeunesse en l’air », et la responsabilité que portent (suivez mon regard) les écrivains et les intellectuels de la RDA qui ont servi « l’État (stalinien !) de non-droit ». Il s’avèrera par la suite que la seule préoccupation de Friedel, comme il est de règle chez les prédateurs de l’Ouest, est de faire du fric, dans son cas, d’imposer la revendication de sa maison d’édition à la propriété du terrain de l’ancienne maison mère de Magdebourg, c’est-à-dire de renouer avec l’état des choses au temps du IIIe Reich.
La noce est réunie dans un restaurant appelé Les Salons Offenbach, où les murs sont ornés de photos dédicacées de chanteurs connus (d’Allemagne de l’Est) et où les plats portent des noms d’opérettes célèbres (magrets de canard « Belle Hélène », filets « Barbe-Bleue », glaces « Vie parisienne », etc.)
Martha-Mete, quoiqu’élevée dans le matérialisme historique, a exigé de se marier à l’église après s’être convertie au catholicisme, ce dont seuls son père et sa mère ne se sont pas formalisés.
Et voilà que le père Bruno Matull, qui l’a préparée à sa conversion et vient de bénir son mariage, se lève et se lance dans ce qu’il faut bien appeler une confession publique d’un genre qu’on n’a plus vu depuis les débuts du christianisme. Il est malheureux et bourrelé de scrupules, car il n’est même plus sûr de sa propre foi et se demande s’il avait bien le droit d’embarquer une femme sans méfiance sur un terrain qui se dérobe de plus en plus sous ses propres pieds. Il est parti pour des heures et ses voisins de table qui, il faut bien le dire, n’en ont vraiment rien à cirer, forcent physiquement le rabat-joie à s’arrêter : « Maintenant, asseyez-vous monsieur le curé ! » Oui, oui, bien sûr, on a compris, tiens, buvez donc un coup.
Mais voilà que la mariée fond en larmes. Ce n’est pourtant pas son genre. Et, non, elle n’est pas triste, non, elle ne sanglote pas. Ses larmes coulent juste, silencieusement, comme une rivière en dégel, et elle dit :
« Écoutez, vous tous, et toi aussi Friedel. Et ne vous faites surtout pas de souci, je pleure de bonheur. C’est ça que je voulais entendre, et pas un pieux ronron. Ah, comme je suis heureuse que ce soit sorti, au lieu de formules toutes faites. Je vous remercie, père Matull. Je me doutais bien d’avance, en principe, que ça ne se passerait pas tout seul, de sortir du Parti pour entrer dans l’Église. J’ai été assez longtemps convaincue dur comme fer pour ne pas me faire d’illusion là-dessus. Heinz-Martin le sait, que je croyais que notre république était la meilleure des deux. Même nos objectifs révolutionnaires, j’y ai cru assez longtemps… Plate-forme idéologique, discipline… Esprit de parti, évidemment nécessaire… Tu peux me croire, Friedel, il n’était pas question de douter. C’est pour ça que j’ai dit dès le début à Heinz-Martin, dès que c’est devenu sérieux entre nous, quand nous nous sommes revus en Bulgarie, ou ailleurs à l’hôtel : si effectivement je me convertis, ce ne sera pas parce que ta famille y tient absolument, ce sera uniquement parce qu’il faut que j’apprenne enfin à douter de façon positive. Car l’autre truc, hein, cette fichue foi jusqu’au boutiste qui nous a foutus en l’air, jusqu’au moment où notre république n’a plus rien été qu’une garderie, je la connais. Cette sorte de foi, on me l’a inculquée, je la connais par cœur, inutile d’en rajouter. Exactement ! Je la sais comme la table de multiplication que j’apprenais aux gosses année après année. Mais en matière de doute, j’ai besoin de leçons particulières, en principe ; j’ai beaucoup à rattraper, encore aujourd’hui. Et c’est peut-être pour ça que je suis si heureuse maintenant. Car jamais je n’avais entendu dire les choses aussi clairement que monsieur le curé tout à l’heure, même pas quand il m’apprenait le catéchisme. “Dieu n’existe que dans le doute !” Je vous le dis, tous : si nous avions permis à temps quelque chose comme ça à notre socialisme, hein, une bonne dose de doute, eh bien peut-être qu’il en serait tout de même sorti quelque chose. Tu ne penses pas, Friedel ? Toi qui d’habitude es si friand de vérité. Tu ne penses pas, Papa ? Il a bien dit cela, monsieur le curé. Tous tes pasteurs, Niemeyer, le pasteur Petersen et le surintendant Schwarzkoppen, ou encore le pasteur Lorenzen, prétendu socialiste [personnages de Fontane, nda], ils n’auraient pas fait mieux, ils n’auraient su mieux dire. Exactement ! Même Schleppergrell, dans Irréparable encore, et pourtant c’est quelqu’un ! Non ? » (pp. 249-251)
[Évidemment le père Matull n’a pas dû lui parler des dogmes… du « Fils vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père », du « Saint-Esprit consubstantiel aussi », de « Marie Mère de Dieu », de la « Transsubstantiation », de l’« Immaculée Conception de Marie », de son « Assomption » et de l’« Infaillibilité des papes », (je dois en oublier…).]
Il y a là trois pages sur le doute, qui font passer Günter Grass du statut de romancier à celui de philosophe, dans un pays qui en est pourtant déjà riche.
Avant lui, Friedrich Nietsche n’avait-il pas dit : « L’ennemi de la vérité, ce n’est pas le mensonge, ce sont les convictions » ?
.
Bouvard et Pécuchet ?
Grass affirme avoir voulu donner, avec ce livre, une relecture de Bouvard et Pécuchet. Mais on se tromperait je crois très fort en prenant Fonty et son ombre pour une réédition du célèbre duo. C’est bien plutôt dans les deux Allemagnes, ou plus justement encore dans l’Allemagne et la France qu’il faut voir la réincarnation parfaite des deux niquedouilles de Flaubert, elles qui se sont lancées, depuis deux siècles, dans une entreprise catastrophique après l’autre, sans se fatiguer jamais de recommencer à foncer dans les murs. Que ce soit la République fédérale s’engouffrant dans le libéralisme autoritaire à l’exemple de l’oligarchie US ou la République démocratique s’alignant comme un seul homme derrière le collectivisme à poigne du grand voisin soviétique, lequel d’ailleurs s’était lui-même planté en préférant les fantasmes de Babeuf à l’exemple de Robespierre, plus ingrat il est vrai quand on préfère les raccourcis… Mais les deux pays, intérieurement unis ou désunis comme la France du temps de guerre ou l’Allemagne du temps de « paix »…
« Mais les Allemands – dès que quoi que ce soit commence – se divisent toujours en deux parties » [Et les Français, alors !!!]
…n’ont rien fait depuis deux siècles que se prendre des gamelles pour aussitôt se lancer dans une « expérience scientifique » nouvelle. Ne comptons, pour ne pas remonter trop loin, que la coalition germanique contre la Première République, que les deux odyssées napoléoniennes, que l’écrasement sans vergogne de la Commune, que l’unification de 71 sous le signe du militarisme luthérien le plus robotique, que les colonisations en cascades de la IIIe République, que le Front Populaire préférant les congés payés à l’Espagne, que l’illusion du Reich millénaire, etc, etc, jusqu’aux actuelles fredaines otanesques conjointes !
C’est l’honneur de Grass d’avoir mis les pieds dans le plat en retournant deux siècles d’histoire officielle pour plaquer sans pitié leur vrai portrait sous les yeux de ses compatriotes. On comprend qu’ils lui en aient voulu et pas seulement les maîtres du jour !
Goytisolo a cent fois raison de dire que « Décliner son appartenance sur le mode du refus est une entreprise périlleuse et ingrate. Mais l’art ne peut surgir que du refus et de la révolte contre l’histoire officielle, ses institutions et ses mythes protecteurs. »
Ah, la France…
Comme Andreï Makine et pas mal d’autres, Günter Grass a eu de la France une vision idyllique.
C’est que, tout comme l’Allemagne n’en finit pas d’être vouée aux Gémonies pour ses douze ans de nazisme, la France n’en finit pas d’être idéalisée pour ses cinq ans de révolution, qu’elle n’a pourtant eu de cesse, depuis deux cents ans, de renier de toutes les façons.
À l’exemple de Marat, qui couvrait de louanges les hommes publics, pour ne réclamer – opiniâtrement – leur tête que lorsqu’ils s’avéraient irrécupérables, il est peut-être bon que Makine et Grass fassent l’éloge d’une France qui n’existe plus, dans l’espoir insensé – mais qui sait ? – qu’elle se relèvera, comme le mendiant auquel Baudelaire préconisait de donner des coups de pieds pour qu’il ait enfin la dignité d’agresser les passants repus au lieu de les implorer.
Moralité ?
On sait que, déjà dans Rencontre en Westphalie, Grass avait défendu – et fait reconnaître par les personnages concernés – deux points de vue qui semblent avoir été chez lui des convictions :
– Les intellectuels sont tous vendus de manière ou d’autre, sinon ils n’existeraient pas.
– Quoi qu’ils en disent et quoi qu’on en pense, ils ne pèsent jamais sur les événements de leur temps.
Il arrive, cependant, que certains d’entre eux engendrent des oeuvres d’art capables de traverser ces événements et quelquefois de leur survivre, voire de les transcender.
Quoi qu’il en soit, Grass récidive dans Toute une histoire. Ses deux héros, Fontane et Fonty, font eux aussi ces mêmes constatations, quoique non sans amertume.
On peut cependant dire qu’il n’a pas toujours pensé de même, sinon, que signifierait son long parcours politique en compagnie de Willy Brandt, et même, son soutien, encore, en 2003, à propos de la guerre d’Irak, à Gerhard Schröder, qu’il a vraiment cru opposé par principe à toute guerre allemande ? (« Bouleversés, impuissants mais pleins de colère nous sommes témoins du déclin moral de la seule puissance mondiale dominante, conscients que la folie organisée aura une conséquence certaine : l’encouragement de la croissance du terrorisme, d’une nouvelle violence et contre-violence ». Pas mal vu, il y a quatorze ans.)
Faut-il y voir l’influence de Fontane ?
On sait que Fontane, qui était, je l’ai dit, un peu monté sur les barricades de 1848, comme Baudelaire le ferait en France sur celles de 1871, s’était presque aussitôt renié en entrant au service de la presse conservatrice (« Aujourd’hui, je me suis vendu à la réaction pour trente deniers mensuels […] Il est décidément impossible de s’en tirer en restant honnête. »). Et Grass lui-même n’a-t-il pas accepté son prix Nobel ?
Mais il y a plus gros à parier que ces constatations désenchantées n’ont pour origine que le retour d’une partie au moins de l’Allemagne à ses vieux démons, quelles qu’aient pu être les expériences passées et les efforts, justement, des intellectuels, dont il fut avec Arno Schmidt, Heinrich Böll, Anna Seghers, Uwe Johnson et Christa Wolf.
Theodor Fontane

Il n’est pas sans intérêt de savoir que Toute une histoire est dédié par Günter Grass à son épouse Ute, « qui a une passion pour F. » et que par ailleurs :
« Pour ma part, tout au moins, qu’il me soit permis d’avouer qu’aucun écrivain du passé ou du présent n’éveille en moi ce ravissement immédiat et instinctif, cet amusement spontané, cet intérêt chaleureux, cette satisfaction que j’éprouve à chaque vers, à chaque ligne de ses lettres, à chaque bribe de ses dialogues. »
Thomas Mann, « Le vieux Fontane », in Dictionnaire des œuvres
Mais qui était au juste Fontane ?
Un descendant, on l'a vu, d’émigrés huguenots du Languedoc nommés Fontaine. Fils de pharmacien. Pharmacien lui-même à Neuruppin pendant 13 ans, mais sans goût pour la pharmacie. Décidé un beau jour à tout plaquer pour vivre de sa plume, chose plus facile à décider qu’à faire. D’abord poète, membre d’une association d’hommes de lettres appelée le Tunnel sur la Spree, attiré par les idées nouvelles et les mouvements sociaux jusqu’à l’épisode de 1848 (les Lumières et la Révolution française n’étaient pas loin), puis critique, surtout théatral – il occupera, pour le Vossische Zeitung, pendant des décennies, le fauteuil 23 du Théâtre Royal. Il se rendra surtout célèbre par ses Wanderungen durch die Mark Brandenburg (« Promenades dans la Marche de Brandebourg » 1862-1882) et n’entamera son œuvre romanesque qu’arrivé à l’âge de 60 ans.
« Romancier peu lu », dit Grass, et difficilement classable. Bien qu’elle soit morte avant sa naissance, mais sans doute parce que leurs romans se passent dans la bonne société et qu’il y est beaucoup question des relations entre hommes et femmes, on l’a comparé à Jane Austen. On ne peut pas rêver pire hérésie. Si Fontane romancier s’apparente à quelqu’un, c’est plutôt à Marcel Proust, dont toute l’œuvre se déroule également dans une société privilégiée, et qui, lui aussi, la dépasse, en plongeant si profondément dans le comportement humain qu’il en devient universel. Cependant, quand la muse de Fontane quitte l’aristocratie prussienne pour s’aventurer dans la bourgeoisie marchande (Frau Jenny Treibel), on pense à Balzac. Et enfin, ce n’est pas sans raison que son chef d’œuvre, Effi Briest, a été comparé à Madame Bovary. Tout cela est assez loin, on le voit de la spécialiste anglaise des jeunes filles à marier et co-fondatrice de la « Ligue anti-jacobine et contre les partageux » qui applaudit à la persécution et à la déportation des romanciers jacobins anglais, ses confrères, et à la destruction de leurs œuvres, car il n’y a pas qu’Hitler qui ait fait détruire des livres.
Enfin, le fait qu’il ait entamé son œuvre romanesque à soixante ans apparente Fontane – et pas seulement sous ce rapport – à John Cowper Powys, lequel en eût été – en a peut-être été – ravi. D’autant que Fontane nourrissait la plus vive admiration pour Walter Scott et qu’on lui doit un long poème sur l’histoire de l’Écosse : Archibald Douglas, dont pas moins de trois versions circulent sur le net, enregistrées par trois acteurs différents.
À bien y regarder, le fond de l’œuvre de Fontane romancier est la nature humaine aux prises avec la société, se débattant pour échapper à son oppression, seulement pour découvrir en fin de compte qu’il est impossible d’exister en dehors d’elle.
En Allemagne, il est « l’Immortel ».
Bien que ses personnages et, semble-t-il, lui-même, n’aient pas été exempts des travers antisémites chers à la Prusse pure et dure, on a découvert après sa mort qu’il avait entretenu, pendant des décennies, avec l’intellectuel juif Georg Friedlaender, une abondante correspondance, dans laquelle il s’épanche à cœur ouvert et défend des opinions que le reste de son œuvre ne laissait pas soupçonner. Comme, par exemple, cette foi aveugle dans « le quatrième état » dont il ne doutait pas qu’il allait enfin, lui, changer les choses.

Statue de Fontane à Neuruppin
Dans Toute une histoire, Grass brode une très belle variation sur ce thème, en faisant correspondre Wuttke-Fonty avec un certain Freundlich, juif né au Mexique de parents communistes réfugiés et devenu, après la guerre, dans la RDA berceau de sa famille, un juriste de réputation internationale qu’on venait consulter de l’étranger, et qui se voit en butte, du fait de la réunification, à de nouvelles brimades et humiliations, non plus en tant que juif cette fois, mais en tant que citoyen de la République des Ouvriers et des Paysans, car il faut que tout ce qui ait été de l’Est soit décrété nul. Expérience et titres, désormais, ne servent plus à rien : il lui faut repasser des examens comme s’il était encore un jeune blanc-bec étudiant, subir des interrogatoires, passer des tests qui seront négatifs il le sait :
« Évalués pour être dévalués ! Il s’agit qu’il n’y ait plus de traces, que tout n’ait servi à rien ! Tout n’est plus bon que pour la ferraille, comme si on n’avait rien enseigné ni rien vécu. Comme ces petites miettes qui restent sur le papier quand on a passé la gomme ! » (p. 293)
Il a deux filles, jeunes, belles et brillantes, à qui tout le monde, y compris lui-même, conseille d’émigrer… au Canada par exemple. Mais c’est en Israël qu’elles veulent aller. Il sait que c’est une erreur, pire, une faute qui ne peut que finir très mal, mais il sait aussi que, quoi qu’il fasse, il ne les convaincra pas. Ce que sait la vieillesse ne sert pas à la jeunesse.
Il finira par se suicider. Fonty, en rentrant chez lui, trouvera sur la table de la cuisine un télégramme : « Quand la vie se tait, le désir aussi… », et il comprendra tout de suite.
« Ce n’est pas que pour les juifs qu’il n’y a plus de place ici » mais il dit : « Hé bien, le monde est vaste ! »
[…] « La victoire sur le communisme a rendu fou la capitalisme. C’est pourquoi je voulais instamment conseiller à Eckhard Freundlich, peu avant qu’il ne s’ordonne de quitter la vie, de prendre la tangente comme moi : “On ne peut plus rester en Allemagne”. » (pp. 549 et 561).
La philosophie d’Emmi Wuttke
Un des plus beaux personnages de femmes de Grass, toutes œuvres confondues, est celui d’Emmi Wuttke, la femme de Fonty.
Des lecteurs superficiels ou pressés pourraient la prendre pour une grosse berlinoise plutôt accommodante mais sans grand caractère. À mon avis, ils auraient tort. Car ce qui caractérise Emmi Wuttke, c’est qu’elle est un être essentiellement bon, sans la moindre mièvrerie ni le plus léger sentimentalisme. Elle est bonne par nature et même sans le savoir, comme le sont par exemple, chez Fontane, le pharmacien Gieshüber et la servante Roswitha d’Effi Briest.
Emmi Wuttke se plaint tout le temps de choses variées et de maux divers, n’ignorant pas que ses plaintes n’intéressent personne mais sachant d’instinct qu’elles enveloppent les autres d’une chaleur dont ils ont besoin. Elle est sans malice et son intégrité désarme jusqu’aux calculs les plus retors du maître manipulateur Hoftaller. Ainsi, lorsqu’il veut faire chanter sa « cible » en le menaçant de révéler à l’épouse l’existence de la petite-fille de la main gauche née en France dont l’arrivée est imminente, il s’aperçoit qu’Emmi a tout deviné…
« En tout cas mon Wuttke sautillait dans la cuisine en criant : “J’aurais bien envie de faire une promenade en barque ! Tu n’as pas envie Emilie ?” […] Et comme il n’arrêtait pas d’en parler, j’ai fini par faire le rapprochement. Parce que dans les lettres qu’il m’envoyait de France par la poste aux armées, à la fin, il était aussi toujours question de promenades en barque, et comme c’était bien le canotage, et même un poème… Je me suis dit, tiens, tiens, c’est louche, il y a anguille sous roche. »
… selon elle, ce sont des choses qui arrivent dans les guerres – et non seulement elle a deviné, mais elle ne nourrit aucune jalousie rétrospective à l’égard de sa défunte rivale et Madeleine, l’étudiante française si différente de sa propre fille, devient dans l‘instant pour elle « notre Marlène ».
Femme peu intellectuelle, on ne peut pas dire qu’elle soit ou se croie philosophe, mais « prendre ce qui vient et faire pour le mieux » pourrait résumer son comportement tout le long de sa vie. Qui osera dire que ce n’est pas une philosophie et qu’elle n’est pas défendable ? Qui osera dire que ce n’est pas celle qu’a fini par adopter Günter Grass à la fin de son parcours ?
Côté personnage féminin, Madeleine n’est pas mal non plus. Les choix qu’elle a faits prouvent un certain caractère et une bonne dose d’intégrité. Elle a abordé très tôt le problème grand-paternel en s’adressant aux Archives du temps de la République des Ouvriers et des Paysans, pour obtenir d’abord des précisions sur Fontane au prétexte de sa thèse, ensuite sur son spécialiste. Le problème de l’attribution de la légion d’honneur est d’abord débattu en secret – entendez, à la Stasi – jusqu’à ce que la chute du mur finisse par simplifier les choses.
À part cela, elle est un peu trotskiste – personne n’est parfait, surtout à 26 ans – et en train de mettre fin à une relation difficile avec un professeur marié. Si elle est, à propos de l’Immortel, sur la même longueur d’ondes que son grand-père, elle ne comprend pas ses réticences devant la réunification en cours. C’est que « Une et Indivisible » ne sont pas de vains mots pour elle.
Bref, Madeleine est autant qu’on peut l’être l’incarnation de cet « esprit français » si cher à Makine qu’Emmi Wuttke personnifie ce que l’Allemagne a de mieux. Ensemble, ces deux femmes, qui forcent indirectement l’espion bicentenaire à émigrer, représentent ce à quoi aspirait Günter Grass : une union paisible de son pays avec la France plutôt qu’une réunion des deux Allemagnes dans des conditions aussi désastreuses.
Il a pu croire son rêve réalisable lorsque, en 2003, Gerhard Schröder a paru devoir poursuivre avec Dominique de Villepin (et Vladimir Poutine au nom de la Russie) , une politique commune contre la guerre d’Irak. Ses espoirs ont été déçus. Les nôtres aussi. Nous nous sommes tous retrouvés avec des Merkel, des Sarkozy, des Hollande (je vous passe les Belges) et une multiplication de guerres d'agression toutes plus honteuses les unes que les autres.
Imaginez un moment M. Oberlin président de la République et Mme Wagenknecht chancelière… quelles grandes choses ne pourraient envisager les deux pays… quel courage cela n’insufflerait-il pas au quatrième état perdu dans les sables boueux du populisme ou de l’à quoi bonisme ?
Mais pourquoi désespérer ?
« Bon espoir y gist on fond » estimait Rabelais, « comme en la bouteille de Pandora ».
Essayons de le croire. Et vive la méthode Coué !
Du coq à l’âne, vraiment ?
Dans une merveille de petite nouvelle en quatre chapitres intitulée « Les chaussures neuves » Andrea Camilleri vient de réussir, par le moyen d’une famille de paysans siciliens laborieux et honnêtes, donc pauvres, à nous balancer sous le nez le fascisme, le nazisme, les exploits bombardiers collatéraux des Alliés occidentaux dans les pays « libérés », la deuxième Bérézina et les profondes balafres laissées par les guerres dans la chair du quatrième État. Il y prouve en outre, sans se forcer, que si ‘Ngilino Sgargiato et Emmi Wuttke ne sont pas du même sang, ils sont de même étoffe.
NB. Camilleri, qui est de la génération de Günter Grass, fait partie, avec Fontane et Powys, mais aussi Saramago, du cercle très fermé des écrivains qui ont entamé leur oeuvre romanesque à l'âge de la retraite.
La philosophie politique de Grass
On pourrait croire d’abord qu’elle s’identifie à celle de Fontane (« Je sens grandir cette question : À quoi bon ? ») mais la patrie de l’auteur d’aujourd’hui n’est plus, en tout, celle de l’auteur d’hier. Celle de l’auteur d’aujourd’hui, avec ou sans la France, va se trouver, qu’elle le veuille ou non, prise dans les métamorphoses que se prépare à subir tout le continent.
Or, pour Fonty, le sort de Berlin est scellé, elle sera au tiers turque, au tiers juive et au tiers musulmane. Il ne le déplore ni ne s’en réjouit. Il constate. Il y a peu de chances pour que le sort de l’Europe – de l’Atlantique à l’Oural – soit très différent.
Il est de plus en plus courant ces temps-ci de parler de « fin de l’Occident » – dieu me tripote, je l’ai fait moi-même – et, d’en faire un paquet-cadeau avec le « naufrage de l’Europe ». Laissons de côté le déclin de l’Occident, trop vaste sujet. Mais je me demande si des tas de bonnes âmes ne confondraient pas, exprès ou non, l’Europe avec l’Union européenne.
Grass ne peut pas avoir ignoré comment s’est faite l’Europe et combien de fois elle a changé de nature, de forme et de visage. J‘ai parlé, au début de ce papier de « transformation terrible de leur patrie », de « fin inéluctable du monde qui leur est connu » et d’ « avènement inimaginable d’un autre ». Que la fin de notre monde soit inéluctable, seuls les inconscients peuvent encore l’ignorer ou s’obstiner à le refuser. Quant à imaginer ce qui le remplacera, qui le pourrait ? Grass ne le pouvait pas plus en 1995 que nous ne le pouvons aujourd’hui. Quel comportement adopter, face à une pareille inconnue ? Pourquoi pas celui d’Emmi Wuttke « Prendre ce qui vient et faire pour le mieux » ?
Lors d’une de ses nombreuses promenades au Tiergarten, qui l’amènent le plus souvent à s’asseoir sur un banc abrité d’un sureau, face à l’île Rousseau, ainsi nommée en l’honneur de « cet acharné pédagogue et homme des lumières », Fonty médite là-dessus…

L’île Rousseau – Tiergarten, Berlin
« … alentour, tout n’était que verdoiement de mai, des millions de bourgeons s’ouvraient à vue d’œil, et les chants d’oiseaux formaient un mélange si riche que même le merle avait du mal à faire entendre ses strophes. Derrière son dos, le sureau commençait à s’épanouir en éventails. Et comme autour de l’île Rousseau, l’eau était tellement pleine d’une vie stimulante, Fonty se vit tenté de vivre à nouveau le rêve de Lenné en épisodes à suivre, comme si rien ne s’était passé, comme s’il n’y avait eu ni la guerre ni la dévastation, comme si ce parc avec tous ses paysages allait perdurer dans l’intacte beauté qui avait toujours été son régal et son refuge ; mais voici que d’un coup tout lui parut étranger : surgies d’un autre monde, deux enfants, deux petites Turques aux foulards strictement noués, étaient debout devant lui et son banc du Tiergarten, sur lequel il se croyait assis depuis ses premières années de pharmacie.
Les deux petites filles avaient des regards graves. Elles pouvaient avoir dix ans, ou peut-être déjà douze. Même taille et même sérieux, car elles le regardaient sans faire mine d’accepter son sourire. Comme elles ne disaient rien, il ne voulut pas davantage se risquer à prononcer un mot. Rien que des chants d’oiseaux et des appels lointains qui résonnaient sur l’eau. Très loin, la rumeur de la ville. Le face-à-face dura longtemps, entre Fonty et les petites Turques. Leurs foulards encadraient de sombre leurs visages ovales. Quatre yeux restaient fixés sur lui, cillaient lentement. Même le merle finit par se taire. Fonty s’apprêtait à faire une phrase gentiment interrogative, afin de rompre le silence, quand l’une des filles dit, dans un allemand à peine teinté de dialecte berlinois : « Pourriez-vous, je vous prie, nous dire l’heure qu’il est ? »
Tout fut aussitôt moins étrange. Fonty fouilla sous son manteau et tira sa montre de gousset, dont il fit sauter le couvercle d’or ; sans avoir besoin de recourir aux lunettes, il lut l’heure qu’il était et il la dit aux filles, qui remercièrent en esquissant la petite révérence d’usage en Allemagne, puis se retournèrent et s’éloignèrent, ou plutôt, après quelques pas, s’enfuirent comme pour mettre vite en sécurité cette heure qu’on venait de leur donner. (pp. 103-104)
Si profondes que soient les transformations qui l’attendent, un continent qui accouche d’un Günter Grass n’est pas un continent fini.
Deux extraits
L’un tout au début, l’autre tout à la fin du livre
1989. Le mur vient de tomber. Wuttke-Fonty accepte que son ombre-diurne-et-nocturne l’invite au restaurant – à Berlin Ouest ! – pour fêter son 70e anniversaire.
C’est donc ce qu’entendait Fonty par « du genre écossais ». Le McDonald’s était plein comme à l’habitude. Un peu en biais par rapport au long comptoir et aux six caisses, ils trouvèrent cependant une table pour deux d’où l’on pouvait encore apercevoir les autres salles. Ils occupèrent leurs chaises avec leurs chapeaux, Fonty y ajoutant sa canne. Hoftaller ne se séparait jamais de sa serviette.
Ils firent la queue à la caisse cinq et durent se décider rapidement, car le regard interrogateur de la caissière qui, comme tout le personnel, portait casquette verte, cravate verte et chemise vert clair, et qui, d’après le badge accroché au-dessus de son cœur, se nommait Sarah Picht, exigeait qu’on commandât, et immédiatement.
Après un coup d’œil sur ce qui était fort lisiblement offert avec indication des prix, Fonty estima trop coûteux le Super Royal TS à 5,95 marks Ouest et fit choix d’un chesseburger et d’une portion de chicken McNuggets. Hoftaller hésita entre le Evergreen Menu – Hamburger royal TS, portion moyenne de frites, boisson moyenne sans alcool, tout ça pour 7,75 marks seulement – et juste un McRib, mais préféra finalement le hamburger à deux étages appelé BigMac, avec un milk- shake goût fraise ; Fonty prit un gobelet de Coca-Cola. Il choisissait avec l’assurance qu’aurait eue un vieil habitué du McDonald’s. Il conseilla à Hoftlaller, qui après tout payait pour eux deux, un supplément : des frites à la sauce moutarde. Lorsqu’on poussa vers chacun son plateau sur le comptoir, Fonty eut droit à deux sortes de sauce – dont l’une s’appelait barbecue – pour aller avec le chicken McNuggets. Sarah Picht sourit aux clients suivants.
Puis ils s’assirent, et chacun mastiqua pour lui-même. Si l’un se débattait avec son BigMac, l’autre trempait avec aisance son chicken McNuggets tantôt dans une sauce, tantôt dans l’autre. Les frites se répartirent entre les deux. Ils mangeaient sans un mot et, quoique assis face à face, sans se regarder. Le Coca et le milk-shake diminuèrent. Les pailles n’étaient naturellement pas en paille, mais la viande promettait d’être à cent pour cent du bœuf, et les McNuggets panés du poulet. Ne sachant que faire de leurs chapeaux, ils les avaient sur la tête l’un comme l’autre. La canne de Fonty était accrochée au dossier de sa chaise. Ils s’écoutaient manger et écoutaient les autres manger.
La clientèle qui emportait ses commandes, un grand nombre de jeunes, et aussi des trafiquants de devises, voilà ce qui mettait de l’animation ; mais nos deux hommes n’étaient pas les seuls représentants du troisième âge ou des « seniors »e, comme on disait à l’Ouest. On voyait debout ça et là des hommes et des femmes passablement fatigués, appartenant à l’univers de la gare, et qui venaient se chauffer chez McDonald’s ; et parfois, ils avaient même de quoi se payer une portion de frites. Une telle affluence aurait dû être bruyante, néanmoins toutes les salles n’étaient pleines que d’une rumeur assourdie.
Fonty n’attendit pas d’avoir terminé son cheeseburger et ses chicken McNuggets. Entre deux coups de dents, il commentait les lieux tout en mâchant : les lampes en laiton au-dessus du comptoir, la hotte des cuisines rapides dont des panneaux vantaient les offres : un fish mac, 3,30 marks. Et il signalait la présence universelle, jusque sur la casquette verte de la caissière Sarah Picht, de l’emblème doublement ventru de la firme, et bientôt se laissait, par ce nom occidental en train de conquérir le monde et devenu symbole de salut, emporter bien loin dans l’espace et dans le temps.
Lesté par le fardeau de temps qui lui pendait au cou, Fonty remonta d’abord aux MacDonald historiques et à leurs ennemis mortels, les Campbell. Il raconta, comme s’il y avait été, cette matinée glaciale de février 1692 où une bonne centaine de porteurs du kilt Campbell étaient tombés sur les MacDonald encore mal réveillés et avaient presque exterminé ce clan. Et du massacre de Glencoe il passa aux actuels empires économiques de ces deux grandes familles écossaises dont les noms s’inscrivaient sur la terre entière : « Vous ne voudrez pas le croire, Hoftaller, mais aujourd’hui il y a de par le monde à peu près treize millions de Campbell, et tout de même trois bons millions de MacDonald. Vous n’en revenez pas, même vous… »
Et le voilà parti, en commençant par le fief d’origine de la société de fast food, le château d’Armedale. S’aventurant dans les landes écossaises au-delà de la Tweed. Assistant aux rendez-vous des sorcières dans le brouillard. Sur les traces de Marie Stuart, il proposait des excursions d’un château fort en ruine à un autre. Il pouvait désigner chaque clan par son nom et décrire chaque tartan jusque dans ses moindres nuances de couleurs. Aussi, une fois les dernières bribes de poulet nettoyées et rincées d’un fond de Coca, franchit-il la lande fouettée par les vents, longea de profonds lacs bleu nuit et se lança dans les strophes en cascades de ces interminables ballades que l’Immortel avait lues à ses frères du Tunnel sur la Spree, ses lieutenants et assesseurs en poésie : des vers que Fonty dénommait « mes ballades un tantinet poussiéreuses » et que parfois il évoquait en disant « nos ballades » comme si c’étaient des œuvres collectives.
À la lutte meurtrière des MacDonald et des Campbell succéda sans transition la longue querelle entre les frères Douglas et le roi Jacques. Comme cherchant son élan, Fonty cita d’abord les chants des jacobites – « Les Duncan arrivent, les Donald arrivent… » – puis fit une incursion dans le cycle de romances tournant autour de Marie Stuart – « Le château d’Holyrood est silencieux et vide/Seul le vent de la nuit siffle entre ses murailles… » –, se retrouva soudain près des savetiers de Selkirk, et puis encore à Melrose Abbey pour convoquer une fois encore les Pherson, Kenzie, Lean et Menzie des chants des jacobites – « Et Jack et Tom et Bobby arrivent. Ils ont pris la fleur bleue… » Mais ensuite, lorsque la belle fille d’Inverness l’eut entraîné dans la sanglante lande de Drummossie et que le comte Bothwell eut abattu le roi, Fonty se dressa soudain comme à l’appel. Droit comme un i, il ôta son chapeau et le tint de côté, écarta de la main gauche les boîtes, les coupelles de sauce et le gobelet de carton avec sa paille, prit sa respiration et, d’une voix claire qui, en dépit de quelques tremblements, couvrait tout autre bruit, récita son Archibald Douglas. Les strophes se suivirent, les rimes s’enchaînèrent. Depuis l’attaque célèbre – « Je l’ai souffert sept ans, je ne le souffre plus… » – en passant par la prière du vieux comte – « Sire Jacques, un regard de clémence… » – « Un Douglas devant moi serait homme perdu… » – jusqu’à la perspective finale d’apaisement qui touche toujours le cœur même si elle falsifie l’histoire – « À cheval, partons pour Linlithgow, chevauche à mon côté ! Et nous y chasserons et pêcherons aussi joyeusement qu’au bon vieux temps… », il dit toute cette ballade qui figure dans chaque manuel scolaire ou presque : vingt-trois strophes sans se tromper une fois, sans trébucher et en mettant le ton. Même au moment le plus dramatique – « Dégaine donc et ne me rate pas, fais-moi mourir ici… » – il sut donner tout son effet poignant. Et pourtant ce n’était pas un comédien qui déclamait, non, c’était l’Immortel qui parlait.
Rien d’étonnant à ce qu’on eût fait silence à toutes les tables. Personne n’osait mordre dans son cheeseburger ou son MigMac. Fonty fut ovationné. Jeunes et vieux applaudirent à tout rompre. De derrière le comptoir, la caissière Sarah Picht lança : « Super ! C’était super ! »
Son numéro avait tellement enthousiasmé que deux filles plutôt tape-à-l’œil assises non loin de là s’élancèrent vers lui d’un pas sautillant, le serrèrent dans leurs bras et le couvrirent de baisers, comme en transe. Et un crâne rasé gonflé de bière et péniblement sanglé dans beaucoup de cuir à rivets, lui flanqua un grand coup sur l’épaule : « Ça décoiffait, p’tit père ! »
Personnel et habitués n’en revenaient pas : on n’avait jamais vu ça chez McDonald’s. (pp. 29-32)
Theodor Fontane
Ballade d’Archibald Douglas
par Fritz Stavenhagen
(en allemand non sous-titré)
Chose que la plupart d’entre nous ignorent parce que nous ne sommes pas curieux de l’histoire des autres : la jeunesse de Frédéric le Grand a été marquée par une tragédie. Le gros roi-sergent son père, homme de casernes, méprisait le goût de son héritier pour les livres, le latin, la flûte et les autres hommes. Il faisait peser sur lui une main de fer si insupportable qu’un jour le Kronprinz résolut de s’enfuir… chez son oncle George, à la cour d’Angleterre. Crime de haute-trahison, qu’on le prenne comme on voudra. Le projet fut éventé, l’héritier jeté dans une forteresse et son complice, le sous-lieutenant du régiment Gendarmes von Katte, déféré devant une cour martiale qui le condamna à la réclusion à perpétuité. Cette sentence ne fut pas du goût du monarque, qui la cassa et décréta que le coupable aurait la tête tranchée dans la cour de la prison où était enfermé le prince-héritier et sous ses yeux.
La tradition dit que, de la fenêtre de son cachot, lorsqu’il vit son ami amené devant le billot, le futur Grand Frédéric lui cria en français « Veuillez pardonner mon cher Katte, au nom de Dieu, pardonne-moi ! » et que Katte lui répondit en français aussi, « Il n'y a rien à pardonner, je meurs pour vous la joie dans le cœur ! », tandis que Frédéric envoyait un baiser à la tête qui tombait. Il devint plus tard le roi qu’on sait mais préféra toujours aux autres humains ses chiens, au point de vouloir être enterré avec eux. Sa volonté testamentaire ne fut pas respectée et les restes des deux monarques reposèrent, mais pas en paix, dans l’église de la Garnison de Potsdam, où Napoléon, en route pour Moscou, les alla voir…

La crypte des deux rois en 1939. Le cercueil de Frédéric II à gauche, celui de Frédéric Ier à droite.
… jusqu’au jour où le chancelier Hitler, voyant l’Allemagne perdue, les fît transférer au fond d’une mine de sel pour qu’ils échappassent à la profanation des vainqueurs. Endroit d’où le chancelier Kohl les fit retirer en 1991, pour leur redonner des sépultures plus dignes, et respectueuses cette fois des volontés testamentaires, c’est-à-dire séparées.
Grande opération de comm' à laquelle assistent, de loin car il pleut, nos héros Wuttke-Fonty, sa petite-fille française et son ombre-diurne-et-nocturne « Monsieur Oftalère ». Cérémonie, disons-le, qui ressemble beaucoup plus au troisième enterrement de Descartes qu’au retour des cendres de Sainte Hélène. Avec déchaînement météorologique, grand concours de peuple et manifestations en sens divers selon les orientations politiques.
Fonty, Madeleine et Hoftaller ont donc vu la réinhumation en grande pompe de Frédéric Ier et ne verront pas celle de Frédéric II, puisqu’elle aura lieu « à Sanssouci, sans splendeur, sans pompe, de nuit », donc sans témoins, au son des tambours voilés. Et ils s’en retournent à leur Trabant (la pluie a cessé) à travers une Potsdam croulant sous les échafaudages, prise en mains occidentale oblige…
Et devant l’un de ces échafaudages, il se passait quelque chose. Des comédiens, des mimes visiblement, étaient en train de représenter une pièce : on ne savait pas encore très bien si c’était une comédie ou une tragédie. Seuls quelques spectateurs, dont faisait maintenant partie le trio, formaient un demi-cercle plutôt clairsemé autour d’une estrade faite de barils métalliques recouverts de planches d’échafaudage. L’inscription qui figurait sur un petit bus Volkswagen garé sur le côté montrait qu’il s’agissait d’étudiants venus de Küstrin, qui depuis la fin de la guerre s’appelait Kostrzyn, pour célébrer à leur manière, en collants noirs et le visage blanc, le retour des ossements royaux. Pour l’instant, il ne se passait rien, seul un tambour résonnait, tantôt triomphal, tantôt traînant. Il devait suivre le déroulement du jeu. Plus tard vinrent s’ajouter des roulements et des coups isolés marquant la succession des scènes. Tout le reste devait être muet.
Comme si c’était Fonty qui avait pris sous contrat cette troupe de comédiens polonais, ils donnèrent la tragédie du sous-lieutenant du régiment Gendarmes Hans Hermann von Katte. C’est ce qui était inscrit en lettres rouges sur une banderole blanche qui fut déployée entre les montants de l’échafaudage. Comme tous les acteurs avaient le même maquillage et le même costume – les yeux entourés de noir dans le blanc crayeux des visages, les bouches rouge fraise et élargies –, il fallait d’abord deviner avant de comprendre : voilà le gros roi-sergent brisant la flûte de son fils qui ne cesse d’en jouer, déchirant ses livres et les jetant au feu ; car c’est celui-ci ou celle-ci – le rôle était visiblement tenu par une femme – qui est le prince héritier que son père, en fureur, passe à tabac avec une telle violence que la phrase de Frédéric transmise par la tradition, « Vous ne m’avez pas traité comme votre fils, mais comme un vulgaire esclave », aurait pu servir de motivation supplémentaire à la représentation de la tentative de fuite. Mais le geste et la mimique en disaient suffisamment, et même davantage. Ni la flûte, ni le livre, ni la canne n’avaient besoin d’être là sous forme d’accessoires.
C’est alors seulement qu’apparut Katte, qu’une lettre mal aiguillée avait trahi et qui, devant les cafouillages du prince héritier, se tordait les mains parce que son rôle de complice était découvert ; mais il ne voulait pas prendre la fuite tout seul et laisser tomber le prince.
Le père faisait d’abord saisir son fils, puis on voyait Katte arrêté : la phrase transmise par l’Immortel dans son récit de la tragédie « Katte remit son épée sans changer de couleur », nécessitait dans la pantomime une expression toute spéciale.
Après un roulement de tambour étouffé, la princesse Wilhelmine, qui vouait une grande tendresse au prince héritier, son frère, fit son apparition. Elle souffrait de l’arrestation de Katte, car lorsque celui-ci était conduit devant le roi, le mime qui jouait son personnage illustra la phrase qu’elle aurait prononcée : « Il était pâle, défiguré. » On eut à nouveau un Frédéric-Guillaume en fureur. Il arracha quelque chose de la poitrine du prisonnier – c’était une décoration, la croix des chevaliers de Malte – et tabassa le malheureux qui était à terre. Il le bourra aussi de coups de pied, tandis que sa victime tremblait sous les violences qui n’étaient que simulées.
Roulement et grand coup de tambour : un groupe plus nombreux de mimes – têtes rassemblées – figurait maintenant la cour martiale, dont la sentence était cependant déchirée par le roi. Ce n’était pas la réclusion perpétuelle, mais la mort par l’épée. Et de même que l’Immortel, au cours des travaux préparatoires pour son essai sur Küstrin, a demandé par lettre à une parente du sous-lieutenant, Marie von Katte : « Surtout, comment cela s’est-il passé avec l’épée ? », de même la question se posait-elle maintenant pour les mimes : un geste sec suffirait-il, ou fallait-il un accessoire pour séparer la tête du tronc ? Quand le trio, au milieu d’un public maintenant plus nombreux, assista à l’exécution de Katte, l’échafaudage du quartier hollandais de Potsdam était chargé de représenter le château de Küstrin et le mime Katte, agenouillé sur l’estrade, fut décapité d’un geste précis de la main, d’une façon si impressionnante que, dans le silence respecté par les tambours, on crut entendre rouler la tête.
Auparavant, on avait forcé le prince héritier à grimper sur l’échafaudage, afin qu’il vît ce qui se passait. Il trouvait tout juste le temps d’envoyer à son pauvre ami le célèbre baiser, que Katte recevait dans un dernier regard. Puis Frédéric, auprès de qui se tenait Wilhelmine, s’effondra pour n’être plus qu’une petite boule de désespoir tremblant.
Le tambour retentit à un rythme funèbre. Madeleine pleurait. Fonty déclara : « C’est à peu près ainsi que ça s’est passé, d’une manière colossalement émouvante, et avec autant de justice que d’injustice. » Aux yeux de Hoftaller, il manquait dans le déroulement de la tragédie l’effet pédagogique de cette raison d’État. Mais après un bref roulemlent de tambour martial et crescendo, la représentatkion continuait.
Pendant qu’on étendait un drap blanc sur le corps de Katte, le prince héritier qui, à l’instant encore , était replié sur le sol, le coeur brisé, se leva et se fit plus grand que nature. La jeune fille qui le jouait se complut à des exercices acrobatiques de jeune homme dans l’entrelacs de l’échafaudage. Elle fit des clowneries, bondit sur l’estrade en suggérant le vol d’un aigle, sauta par-dessus le cadavre de l’ami, marcha sur les mains, brilla par des sauts périlleux en série, en avant et en arrière, déclara symboliquement quelques guerres pour un oui, pour un non, déchira des traités, vola des provinces, livra des dizaines de batailles, passa par-dessus des cadavres avec une compétence maintenant bien acquise, chassa d’un côté, puis de l’autre le chœur des mimes – fut chassée à son tour mais ne s’avoua pas vaincue, jouant bien plutôt le rôle du roi exactement comme l’avait voulu son père dont il avait bien compris la leçon, régnant d’une main de fer, mais donnant à la fin, malgré son sourire silencieusement cynique, l’image d’un héros solitaire et triste jusqu’à la mort que ses expéditions conquérantes ne rendaient pas heureux, qui méprisait les hommes et ne faisait plus, tremblant et déformé par la goutte, que jouer avec ses chiens.
Le tambour souligna macabrement l’attaque cardiaque tardive et se tut. Quand les mimes vinrent saluer, quelques-uns des rares spectateurs étaient déjà partis. Fonty, qui, entraîné par Madeleine, avait applaudi, déclara par-dessus la tête de Hoftaller, qui n’avait pas bougé le petit doigt : « Je n’en démords pas. Mon héros s’appelle Katte. » Lorsque le trio quitta le théâtre de la tragédie en même temps que le quartier hollandais de Potsdam, Fonty chercha à nouveau et trouva la main de sa petite-fille. (pp.611-613)

Terrasse de Sanssouci – Tombe de Frédéric le Grand
À gauche : celle d’un de ses chiens. Dans le carré d’herbe du haut : deux autres.
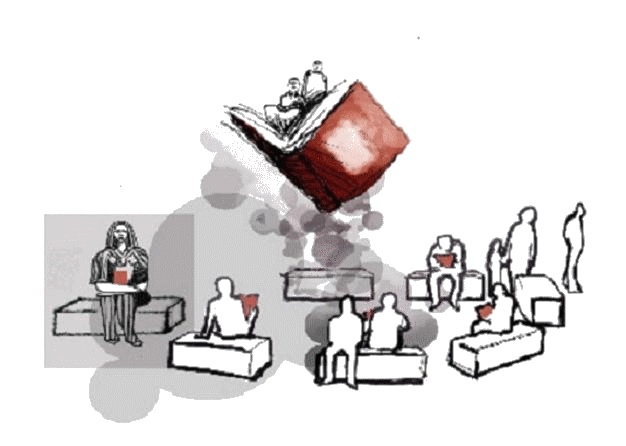
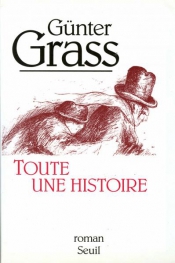
Günter GRASS
Toute une histoire
Traduction Claude Porcell et Bernard Lortholary
Seuil, 1997
708 p.
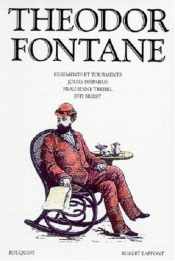
Theodor FONTANE
Errements et tourments – Jours disparus –
Frau Jenny Treibel – Effi Briest
Robert Laffont (1992)
Collection Bouquins
903 pages
On ne saurait trop conseiller au lecteur francophone non averti, avant de se lancer dans le livre de Grass, de lire au moins la très belle préface de Claude David à ces quatre romans de Fontane.
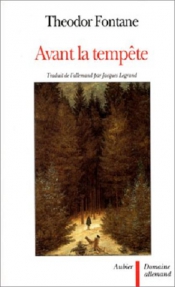
Theodor FONTANE
Avant la tempête : Scènes de l’hiver 1812-1813
Traduction : Jacques Legrand
Aubier, 1992
Collection Bouquins
995 pages
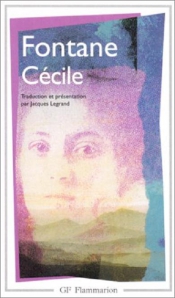
Theodor Fontane
Cécile
Flammarion, 1998.
Collection GF Littérature étrangère
223 pages

Theodor FONTANE
Le Stechlin
Traduction : Jacques Legrand
Livre de Poche, 1998
Collection Pochothèque
441 pages

Theodor FONTANE
Mes années d'enfance
Traduction : Jacques Legrand
Aubier, 1993.
216 p
À défaut de Promenades dans la Marche de Brandebourg qui semble inédit en français, on pourra lire :
La minorité sorbe du Brandebourg vue par l’écrivain prussien Theodor Fontane (1819-1898)
par Isabelle Solères
Les « Pérégrinations à travers la Marche de Brandebourg » de Thepodor Fontane : Pélerinages aux sources de la culture et de l’histoire prusso-brandebourgeoises.
Thèse de doctorat de SOLERES Isabelle – Réf. ANRT 43359
ANRT – Atelier National de Reproduction des Thèses
Identifiant BU : 03TOU20076 - 606 pages - Disponible au format microfiche - Contactez-nous

Marc THURET
Theodor Fontane : Un promeneur dans le siècle
Presses Sorbonne Nouvelle (1999)
324 pages
Considéré par les meilleurs écrivains de ce siècle comme un des pionniers du roman moderne, Theodor Fontane est aussi devenu le plus populaire des classiques allemands du XIXe siècle. Il est urgent de le redécouvrir aussi en France.
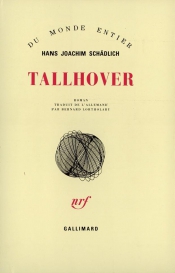
Hans Joachim SCHÄDLICH
Tallhover
Traduction : Bernard Lortholary
Gallimard, 1988
Collection : Du monde entier
312 p.
Tallhover naît en 1819, quand s'instaure le fameux « système » de Metternich : la répression policière de toutes les libertés. Doué dès l'enfance pour le mouchardage et le voyeurisme, Tallhover entre bientôt dans la police politique, où il fait une carrière aussi longue qu'obscure : elle dure cent dix ans ! Sous le roi de Prusse, l'empereur d'Allemagne, la république de Weimar, dans le Reich hitlérien et enfin en R.D.A., Tallhover est toujours à Berlin, faisant le même métier, parlant le même langage et servant la même idée : celle de l'Ordre. Féru de basse police et de haute sécurité, Tallhover met la même passion froide à surveiller Marx en 1842, ou Lénine en 1917 ou, en 1954, l'opposition à l'État allemand qui se réclame d'eux. Ce roman policier et politique est plus qu'une coupe à travers l'histoire allemande et européenne : c'est le procès (verbal) de l'étatisme totalitaire, rédigé dans sa propre langue de bois, savamment parodiée par le plus terriblement précis des écrivains allemands actuels.

Hans Joachim SCHÄDLICH
BERLINESTOUEST et autres récits
Traduction : Bernard Lortholary
Gallimard, 1990
180 p.
Ces nouvelles sont le fruit de dix années d'exil, de malaise et de travail. Elles constituent, sur l'histoire récente de l'Allemagne, un témoignage d'une exceptionnelle acuité, et d'une originalité totale dans l'expression. Leurs sujets sont très divers, depuis une querelle d'académiciens jusqu'au vertige d'un funambule, en passant par les euthanasies hitlériennes, l'internement psychiatrique ou les rafles de la Stasi, mais il s'agit toujours de formes d'oppression institutionnelle. Et toujours celle-ci se marque et peut s'analyser dans le langage de ses agents ou de ses victimes, et dans le discours du narrateur lui-même. Jusqu'au mur de Berlin, qui n'était pas seulement une construction de béton et de métal, mais aussi une maladie du langage, et auquel Schädlich dresse pour finir un monument d'un humour terrible, inoubliable.

Juan GOYTISOLO
Les Cervantiades
Conférences et Études
Traduction : Abdelatif Ben Salem
Bibliothèque Nationale de France (BNF), 2000
72 pages
« Si Cervantes est l’écrivain dont je me sens le plus proche, cela tient à sa qualité de précurseur de toutes les aventures : si sa familiarité avec la vie musulmane donne à son œuvre une indéniable dimension mudéjar, l’invention romanesque, à travers laquelle il assume la totalité de ses expériences et de ses rêves, fait de lui le meilleur exemple de l’attitude illustrée par le dicton : humani nihil a me alienum puto. Trois siècles et demi plus tard, les romanciers font encore du “cervantisme” sans le savoir : en composant nos œuvres, nous écrivons à partir de Cervantes et pour Cervantes ; en écrivant sur Cervantes, nous écrivons sur nous-mêmes, que sa ferveur islamique nous soit étrangère ou familière. Cervantes reste le point vers lequel toujours convergeront nos regards. » Juan Goytisolo, extrait de « Vicissitudes du mudéjarisme », in Chroniques sarrasines, Paris, Fayard, 1985.
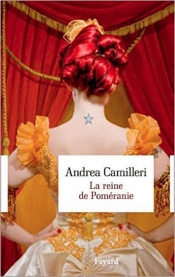
Andrea CAMILLERI
LA REINE DE POMÉRANIE et autres histoires de Vigáta - (Huit nouvelles dont « Les chaussures neuves »)
Traduction : Dominique Vittoz
Fayard, 2015
Collection : Littérature étrangère
320 p.
Que se passe-t-il, dans la bourgade sicilienne de Vigàta, quand deux marchands de glace aussi imaginatifs qu’obstinés sont rivaux en amour et en affaires ? Ou qu’en plein fascisme un brave maraîcher hérite d’un âne particulièrement têtu baptisé Mussolini ? Ou que, la démocratie revenue, les Vigatais s’adonnent au petit jeu risqué de la lettre anonyme ? Le bal de la roublardise est ouvert. L'ingénuité s'y invite. Et le gagnant est rarement celui qu’on croit
Trouvaille :
Samuel Beckett, extrait de La Dernière bande :
« Me suis crevé les yeux à lire Effi, encore, une page par jour, avec des larmes encore. Effi... aurais pu être heureux avec elle, là-haut, sur la Baltique, et les pins, et les dunes.
Non ? - Et elle ? Pah ! »
Mis en ligne le 9 février 2017.
19:48 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs, Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |
Facebook |















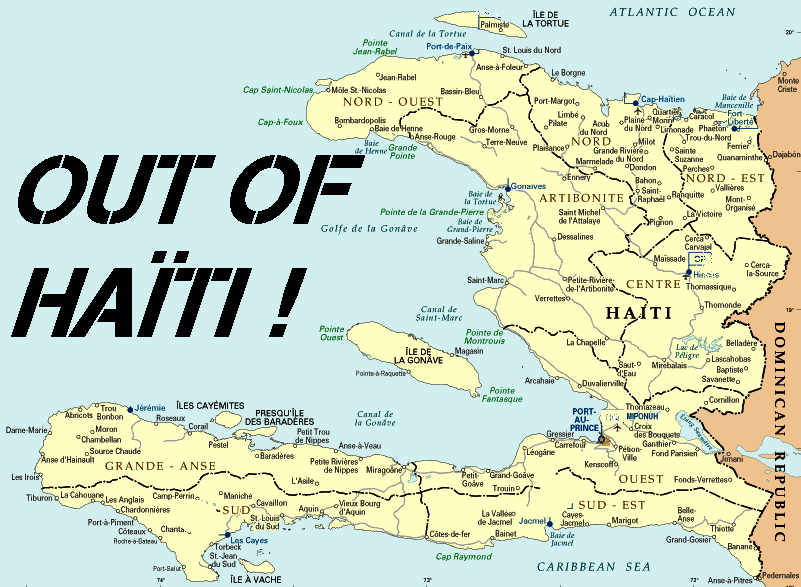







Commentaires
Quel ensemble passionnant. On ne vous sera jamais assez reconnaissant pour avoir lu pour nous, résumé, annoté et commenté d'une manière minutieuse et pleine de finesse et d'esprit une pléiade d'ouvrages - notamment Makine , Gunter Grass, Fontane, etc. Il faut d'urgence conserver ces pages dans ses favoris .
Écrit par : sémimi | 11/02/2017
Les commentaires sont fermés.