09/12/2017
ANNEXE (à JERUSALEM ET FEU D'ORMESSON)
ANNEXE
à Jérusalem et feu d’Ormesson

SODOME et GOMORRHE
(sans oublier Jéricho)
… et Déclaration Balfour
En guise d’anniversaire…
(Extraits)
Les revisitations littéraires des Grosses Orchades
 Une fois au moins au cours de la vie, les trompettes de Jéricho sonnent haut et de bon matin, dans le cœur de tous les hommes. Lorsque j’étais enfant, en Toscane, il m’arrivait souvent de me réveiller brusquement, dans les nuits de printemps, entendant, en rêve, un bruit de trompettes dans la vallée du Bisenzio. La nuit était douce, et le silence était profond et clair comme un lac.
Une fois au moins au cours de la vie, les trompettes de Jéricho sonnent haut et de bon matin, dans le cœur de tous les hommes. Lorsque j’étais enfant, en Toscane, il m’arrivait souvent de me réveiller brusquement, dans les nuits de printemps, entendant, en rêve, un bruit de trompettes dans la vallée du Bisenzio. La nuit était douce, et le silence était profond et clair comme un lac.
Récemment, à Paris, salle Gaveau, deux nègres d’Amérique, brillants et protestants, chantaient un spiritual devant un public malade de spleen et de regrets érotiques : l’un d’eux, le plus noir, avait une voix de basse, noyée dans le ventre, profonde et vindicative, l’autre, une voix de contralto, passionnée et mourante, la voix d’Andromède enchaînée à son récif.
Les paroles du spiritual célébraient les vertus de Josué et de ses trompettes sous les murs de Jéricho. Les deux nègres chantaient les yeux au ciel et les mains jointes, comme les bergers de Bethléem, agenouillés sous la queue de la comète ; leurs ongles pâles, au bout de leurs doigts de charbon, semblaient des flammèches de gaz, des feux de Saint-Elme. Quand elles priaient, sainte Thérèse et sainte Catherine devaient avoir ces mêmes flammèches au bout des doigts. Les deux chanteurs suivaient, sans aucun doute, de leurs yeux blancs, un vol d’anges noirs aux cheveux crépus et aux lèvres saillantes, planant sur le nuage de poussière qui montait de la chute des murs de Jéricho. Les nègres voient les anges à leur façon : la madone des nègres est comme la vierge polonaise de Czestochowa, enfumée par les incendies du siège suédois.
L’écho de ce spiritual m’accompagne ce matin, tandis que je chevauche sur la route de Jérusalem, vers les rives de la mer Morte. Le ciel de mars, inquiet sur le mont des Oliviers, et strié de courants clairs, comme le miroir d’un golfe marin, devient d’un bleu profond au sommet de l’arc, là-bas, où le cercle de l’horizon s’incline sinueux sur les montagnes de Moab, des nuages gonflés de vent et de pollen réfléchissent le ton jaune des prés brûlés et des solitudes pierreuses de la terre de Loth. Tout autour, le paysage varie avec ses cyprès et ses oliviers : par moments, la ligne douce d’une colline fait penser au paysage toscan peint par Giotto. C’est ainsi que je regarde et que je pense, ayant lâché les rênes, quand un bruit de trompettes vient me surprendre par-derrière.
J’avais passé la nuit à l’auberge du Bon Samaritain, sur une natte étendue par terre, dans une chambre encombrée de selles et de corbeilles vides, amoncelées, pêle-mêle, le long des murs. J’étais parti de Jérusalem, à l’aube, remontant à cheval les coteaux herbeux qui se brisent tout à coup et tombent rapidement dans la vallée profonde du Jourdain. La saison était chaude, le vent de printemps apportait au désert le présage des premiers nuages de sauterelles. Après avoir parcouru pendant le jour les collines et les vallées qui, à l’est du mont des Oliviers, se prolongent jusqu’au mont de la Quarantaine, dominant Jéricho, où Jésus fit pénitence et fut tenté par le démon, et après m’être reposé quelques heures au couvent grec de Koziba, suspendu comme une cage au flanc rocheux de la montagne au-dessus de l’abîme d’El Kelt, je m’étais acheminé vers le Nébi Musa, où les musulmans prétendent que Moïse est enseveli.. Il faisait déjà sombre, le cheval était fatigué, et il me sembla prudent de m’arrêter à mi-route pour passer la nuit à l’auberge du Bon Samaritain. Devant la porte de l’auberge, célèbre dans les chroniques par le geste de miséricorde que tout le monde connaît, une petite Ford était arrêtée, toute grise de poussière et chargée de valises en cuir. Pendant que je descendais de selle, voici sortir de l’auberge et venir à ma rencontre, avec l’air de quelqu’un déjà las de m’attendre, un petit vieillard, maigre et agile, aux jambes courtes, à la tête petite, et aux lèvres minces et souriants dans un visage spirituel, nu et ridé. Il me serra la main avec la cordialité d’un vieil ami et, prenant mon bras :

Excusez-moi, dit-il, si je me présente de cette façon : je suis François-Marie Arouet, seigneur de Voltaire.
– En personne, m’écriai-je.
– En personne, le Patriarche de Ferney, le Voltaire de Candide, du Sottisier, des Lettres philosophiques et de bien d’autres choses.
– C’est une véritable chance, dis-je, que je dois certainement beaucoup plus au hasard qu’à ma prévoyance ; et j’ajoutai les phrases habituelles de courtoisie qui sont d’usage lors de pareilles rencontres. Rencontres extraordinaires, qui auraient l’air de miracles dans n’importe quel pays, sauf en Palestine, sur les bords du Jourdain, où les miracles, conformément à une tradition ancienne, sont des faits qui ne sortent pas de l’ordinaire et auxquels personne ne prête attention. Cependant, un Arabe s’était occupé de mon cheval et le débarrassait de la selle et du mors.
– Je suis vraiment content, répondit Voltaire en m’accompagnant bras dessus, bras dessous, vers l’entrée de l’auberge, de rencontrer un homme civilisé qui ne soit ni Juif, ni Arabe, ni Anglais. Et il eut un geste de joyeux étonnement quand il apprit que j’étais italien, que je voyageais pour mon plaisir, et surtout, que je n’étais pas un pèlerin. Je suis désormais persuadé, poursuivit-il, qu’il faut préférer la foi qui déplace les montagnes à celle qui déplace les hommes. Et il ajouta qu’après une expérience de tant d’années, après toutes les déceptions auxquelles sa philosophie l’avait conduit, surtout en ce début de siècle, après toutes les désillusions dont il était redevable à la morale européenne, à cette morale moderne dont il se considérait justement, non sans un orgueil paternel, comme l’unique juge et l’unique responsable (et là, il me dit à voix basse qu’il ne savait pas toutefois renoncer à la fierté des erreurs du prochain pas plus qu’à celles de ses propres raisons), il avait choisi, pour vivre, une profession que le préjugé des temps lui faisait apparaître beaucoup plus noble que celle de philosophe. De mes amis d’Amérique, conclut-il, auprès desquels mon ancienne bienveillance pour le bon Huron de l’Ingénu me permet de jouir d’encore un peu de crédit, j’ai accepté la représentation générale, pour la France et pour les colonies, mandats et protectorats français, des voitures Ford, dont j’espère réussir à deviner un jour le fonctionnement un peu mieux qu’Algarotti n’a réussi à deviner le mécanisme de ma philosophie.
Personne à Paris, l’interrompis-je, ne peut certes se vanter d’avoir eu un destin meilleur que le vôtre ; n’êtes-vous donc pas devenu, en quelque sorte, le représentant de la philosophie américaine, c’est-à-dire de la philosophie la moins voltairienne du monde, dans le pays le plus voltairien de la terre ?
– Et qui vous dit, répliqua le Patriarche de Ferney, que l’Amérique de Ford est moins voltairienne que la France ? Comment pensez-vous donc que c’est justement à Ford qu’est revenu d’accomplir le miracle de conduite Voltaire en terre Sainte ?
– Voilà un miracle, dis-je, que Moïse lui-même n’eût point rêvé d’accomplir, même s’il avait reçu une éducation bourgeoise.
À ces mots, Voltaire se retourna, me regardant en souriant et :
– Quant à Moïse…, commença-t-il à dire.
Mais à ce moment-là, l’aubergiste, un Arabe barbu en galabia courte et jambes nues, s’approcha de la table qui était au milieu de la pièce, attendit que nous fussions assis, posa assiettes et verres, un carafon de vin, des victuailles dans une sorte de plateau en terre cuite, et sortit en nous regardant de travers.
– Maintenant, je comprends, dit Voltaire en riant, pourquoi l’auberge du Bon Samaritain s’appelle aussi Khan el Hatrour, ce qui signifie Auberge des Voleurs. Et il me raconta qu’il avait rencontré de nombreuses auberges de ce genre, sinon du même nom, dans toute la Syrie, que pendant près d’un mois il n’avait fait que parcourir, de long en large, pour étudier les conditions de ce marché et se rendre compte de près des possibilités de conciliation entre la philosophie de Ford et la paresse des Syriens. Un bon marché, ajouta-t-il, pour les voitures à bas prix : mais la politique française en Syrie n’est certes pas favorable à la bonne marche des affaires. Et là, me voyant sourire : qui aurait pu s’imaginer, s’écria-t-il, que l’on pourrait un jour, rencontrer l’auteur de Candide, au volant d’une Ford, sur le chemin de Damas ?
De la politique des Français en Syrie, la conversation passa à celle des Anglais en Palestine. Voltaire ne pouvait se résigner à la pensée que c’était justement aux Anglais qu’on avait confié la garde des lieux saints et l’administration d’un territoire si fertile en miracles.
– Le peuple britannique ne sait pas administrer les miracles ; dans toute l’histoire de l’Angleterre, il ne s’en trouve pas un seul. Je ne veux pas dire qu’il n’y a pas de gens qui essaient d’en faire de temps à autre et, qu’éventuellement, ils ne sauraient en faire ; mais pour l’instant, je n’en connais pas, et les saints anglais, bien rares, dont les noms se transmettent dans les calendriers, sont trop gentlemen pour être saints et pour faire des miracles. Quant à moi… – il voulait peut-être ajouter que lui-même ne croyait pas aux miracles – mais je le prévins par un sourire discret :
– Il est évident, dis-je que vous ne croyez pas aux miracles parce que vous ne savez pas en faire.
– Je n’ai jamais essayé, répliqua Voltaire, mais je ne crois pas à la nature, comme Rousseau, ou aux machines, comme Ford, au point de me juger absolument incapable pour cet art. Un Français de notre temps ne peut pas faire des miracles. Et nous nous mîmes à parler de toutes sortes de choses miraculeuses, des mystères de la magie, des anciens Égyptiens et des légendes qui entourent la civilisation de ce peuple. J’étais venu à Jérusalem après un long séjour dans la vallée du Nil, que j’avais parcourue en tout sens, d’Alexandrie à Assouan, et la désillusion dont je garderai toujours à l’Égypte la plus noire ingratitude était en moi encore très vive. Voilà un pays qui, à mes yeux, n’a rien de mystérieux ni de magique ; une civilisation dont les tombes sont l’unique témoignage ne peut susciter qu’une impression de sombre ennui. Heureusement, mon esprit s’égayait au souvenir des momies, que les anciens Égyptiens bourraient d’oignons, pour les conserver. Voltaire était de mon avis. N’avait-il pas écrit dans la Princesse de Babylone, que les Égyptiens « si fameux par des monceaux de pierres, se sont abrutis et déshonorés par leurs superstitions barbares » ? L’auteur de Candide ne se lassait pas de rire, à la pensée que les momies de ces reines, au visage serein, aux yeux doux, aux lèvres fines et souriantes, de ces rois, à l’aspect noble et fier, gisaient dans des sarcophages d’or, l’estomac et le ventre remplis d’oignons. Et que dire des crocodiles, des rats, des chiens, des serpents, des chats embaumés, qui tenaient compagnie dans leurs tombes, aux reines et aux rois.
Le vin était clair et doux, et le sang en bouillonnait agréablement. Nous parlâmes ainsi longuement des Égyptiens et de leurs « monceaux de pierres » (même les pyramides n’étaient pour Voltaire que des monceaux de pierres), des Anglais modernes, de leur patience devant l’immortalité et de leur liberté devant le ciel. (Voltaire n’avait-il pas écrit, dans ses lettres sur les Quakers, que tout Anglais, « comme homme libre, va au ciel par le chemin qu’il lui plaît » ?) Et petit à petit, la conversation glissant sur les raisons de mon voyage en Terre sainte, l’auteur du Sottisier me demanda si je comptais m’arrêter à Jéricho, ou si j’avais l’intention de poursuivre au-delà du Jourdain, et il me proposa de m’accompagner en voiture jusqu’à Sodome.
– Le patriarche latin de Jérusalem, qui est Italien, ajouta-t-il, m’a appris que l’on a découvert les ruines de cette ville, si importante dans l’histoire des peuples civilisés ; Je ne voudrais pas rentrer à Paris sans pouvoir dire que j’ai passé une nuit à Sodome.
Je lui répondis que je tenais à terminer mon voyage en Palestine comme je l’avais commencé, c’est-à-dire à cheval, que j’acceptais volontiers sa compagnie, mais que nous nous donnerions rendez-vous à Jéricho et à Sodome où je le rejoindrais au plus tôt.
– Je vous préviens cependant, dis-je pour conclure, qu’il n’est pas prudent de passer la nuit à Sodome : c’est une ville où il convient de garder l’œil ouvert.
Les autorités anglaises de Jérusalem m’avaient, en effet, conseillé de ne pas me fier aux Arabes qui campaient sur les rives de la mer Morte. La vallée du Jourdain était encore en effervescence et le danger d’une nouvelle révolte contre le Juifs ne pouvait être considéré comme conjuré.
– Nous surveillerons réciproquement nos épaules, dit Voltaire en riant. Et après bien d’autres propos du même goût, nous nous quittâmes pour aller nous coucher. Je devais partir dès l’aube, à cheval, et l’auteur du Dictionnaire philosophique devait, avec sa Ford, me rejoindre à Jéricho.
[…]
Voltaire arrêta la voiture :
– Si je ne me trompe pas, s’écria-t-il, nous sommes presque arrivés.
Pas tout à fait arrivés mais pas très loin : là-bas, Jéricho, à deux milles environ, avec ses maisons blanches, ses jardins, ses bosquets de palmiers et de sycomores.
– Qui sait, dis-je, si le sycomore, auquel grimpa Zachée le publicain pour voir passer Jésus , n’est pas encore vivant et vert.
– Et qui sait, ajouta le patriarche de Ferney, si, à la fenêtre de Rahab la Courtisane, n’est pas toujours suspendu le chiffon rouge qui la sauva du massacre.
Je mis mon cheval au pas près de la Ford, qui avançait lentement, et devisant ainsi, nous poursuivîmes vers Jéricho.
Il fut question d’anges et de miracles. Tout est possible à Jéricho, et l’on peut croire que les miracles sont toujours la seule monnaie qui ait cours légal dans l’histoire de cette contrée. Ce n’est plus l’époque de Josué et d’Élisée, où les anges se promenaient à travers le pays, vêtus de lin blanc, anges aux longs cheveux dénoués sur les épaules et aux mains lumineuses, argentées et frétillantes comme de poissons. Mais certes, cette espèce rare d’hommes ailés ne s‘est point perdue et survit aujourd’hui, cachée dans les vallées et dans les cavernes, descend de temps en temps frapper à la porte des couvents et des maisons de paysans, se désaltérer à la fontaine d’Élisée, se baigner dans le Jourdain, échanger quelques mots avec les mendiants et les pèlerins qui, à certaines époques, se rencontrent en foule sur la route de Jérusalem. Voir un ange, lui parler, a toujours été mon rêve, depuis mon enfance. Je me rappelle avoir lu un jour, quelques mois avant la guerre, qu’un ange était apparu soudain sur la petite place d’un village de Russie, pour avertir les paysans qu’ils devraient se garder de manger les pigeons, par respect pour le Saint Esprit. Les moujiks avaient été étonnés de cet avertissement car, de mémoire d’homme, dans toute la Russie et surtout dans ce village, on n’avait jamais mangé de chair de pigeon, justement pour éviter de mordre dans le Saint Esprit. Mais il semble que l’ange était mieux informé qu’eux, tant il est vrai qu’il en parla, entre quatre yeux, avec le starosta, sur un ton plutôt brusque, et il s’en alla à pied, remuant tout doucement les ailes et secouant la tête en signe de menace. Quelques mois plus tard, en effet, la guerre éclata comme punition de ce sacrilège. J’ai toujours cru à la réalité de cette apparition de l’ange dans le village russe, et très souvent, depuis, je me suis trouvé sur le point de reconnaître, en telle ou telle personne, parmi toutes celles que j’ai eu l’occasion de rencontrer dans ma vie, un ange, oui, un ange avec des ailes ; mais, chaque fois, j’ai cru m’être trompé.
[…]
Mes fantaisies faisaient sourire Voltaire. Les anges ne lui inspiraient pas confiance, et il n’estimait que les prophètes pour leur rude humanité et leurs humeurs implacables.
- Voilà des hommes ! disait-il. Et cependant, il admettait que l’époque des prophètes est passée, et qu’aujourd’hui, pour notre bonheur, il est plus facile de rencontrer un ange qu’un prophète. Des hommes qui gouvernaient les peuples par la menace, et la nature par le miracle.
[…]
Cependant, nous étions arrivés à Jéricho, et nous nous arrêtâmes près de la fontaine d’Élisée, au pied de ce petit coteau où l’on voit affleurer, ça et là, les restes des murs que Josué fit crouler au son de ses trompettes. Ce coteau est une sorte de Testaccio, et les tessons y abondent ; mais comme ruines véritables, seules apparaissent les fondations du double cercle de murs, dont la base est faite de pierres grossièrement équarries. Cité minuscule que cette fameuse Jéricho d’il y a trois mille ans, grande comme l’Acropole d’Alatri en Ciociaria, ou comme la piazza Colonna. Le géant Goliath l’aurait tenue dans sa main. En voyant ces petits morceaux de brique, ce terreau rouge, ces pavés de terre battue, pavés de masures et non de palais, on comprend que quelque trompettes aient pu provoquer un tel désastre : une flûte aurait suffi. L’endroit est triste, et ces restes de murs semblent plus misérables encore si l’on contemple le décor biblique des montagnes de Moab, la vallée du Jourdain, le mont de la Quarantaine, l’étendue bleue de la mer Morte et l’arc immense du lointain horizon.
Le jeune archéologue américain au nez crochu et aux oreilles saillantes, qui fouille parmi les ruines de l’antique Jéricho pour le compte d’un comité sioniste de Philadelphie, ne pardonnera jamais aux soldats turcs campant en 1917 près de la fontaine d’Élisée, d’avoir fait crouler les quelques murs que Josué n’avait pas réussi à abattre tout à fait, et que le professeur Sellin, de Vienne, avait découverts en 1909, il est plein d’admiration pour le sérieux historique de la Bible.
– Pensez, dit-il, que cette fontaine est précisément celle qu’Élisée purifia par le sel ; les potagers, les vignes, les jardins fleuris de roses, les célèbres roses de Jéricho, se désaltèrent depuis des milliers d’années à cette fontaine qui, aujourd’hui encore, comme au temps d’Élisée, arrose les champs autour de la ville maudite. À propos de malédictions, je vous dirai que la Bible est d’une exactitude miraculeuse. Quand Josué eut accompli avec les trompettes les prouesses dont nous voyons les signes, il réunit le peuple et fit faire un serment, disant : Maudit soit quiconque essayera de reconstruire Jéricho ; il la bâtira sur son fils aîné et posera ses portes sur son fils cadet ; voulant indiquer par là que les enfants mourraient et qu’il reconstruirait la ville sur leurs tombes. Quelques temps après, raconte le livre des Rois, un certain Hiel, de Betel, reconstruisit Jéricho et la bâtit sur Abiram, son fils aîné, et posa les portes sur Segub, son fils cadet. Eh bien ! conclut l’archéologue, les fouilles du professeur Sellin ont mis en lumière, sous les pavements des maisons, un grand nombre de tombes d’enfants. Cette impressionnante découverte a été illustrée par Sellin lui-même, dans la Revue biblique de juillet 1910.
– Et les anges ? demandai-je, en rencontre-t-on encore ?
– Selon les époques, répondit l’archéologue, les Anglais font aux anges une chasse impitoyable, et ce derniers temps, ils en ont tué un grand nombre. Désormais, ils se sont faits plus rares, mais cette année, peut-être, en raison de l’exceptionnelle douceur de l’hiver, il s’en trouve beaucoup dans toute la région.
Cependant, nous avions fait le tour des murs et rejoint la route près de la fontaine d’Élisée :
– Je vous conseille, dit l’archéologue à Voltaire, après nous avoir salués et souhaité un bon voyage, de ne pas passer la nuit à Sodome ; ce n’est pas prudent. Vous pourriez rencontrer… – mais le bruit du moteur couvrit ses paroles.
M’étant tourné sur la selle pour mieux entendre (j’étais déjà monté à cheval, précédant la Ford), je vis l’archéologue américain se mettre à courir en direction d’une bande de gamins qui venaient en gambadant à notre rencontre : c’étaient des petits Juifs polonais et hongrois de la colonie sioniste de Jéricho, aux yeux noirs, aux cheveux brillante et crépus, aux visages cuits par le soleil.
En tête marchait un marmot haut comme trois pommes, fier et raide comme un Josué, soufflant à pleines joues dans une trompette en fer blanc, dont le son était fort et strident au point de crever les tympans. En quelques bonds, l’archéologue rejoignit ce Jéricho inattendu, lui arracha la trompette de la bouche et la jeta dans la fontaine d’Élisée.
– Sage précaution, observa Voltaire, on ne peut jamais savoir le mal que peut encore faire une trompette.
Désormais, il n’est pas besoin de miracles pour passer le Jourdain.
– Je ne comprends pas, dit Voltaire quand nous fûmes au milieu du pont, pourquoi dans toute la Bible, il n’y a aucune trace du moindre petit pont en bois. Le Dieu de Moïse recourait plus volontiers aux miracle qu’aux ingénieurs. Pour le passage de la mer Rouge, ou pour le premier gué du Jourdain, il est clair que le miracle fut réalisé à bon escient, puisqu’il s’agissait de transporter sur l’autre rive une multitude immense de gens et de chars ; mais pour le prophète Élie et pour son disciple Élisée, une passerelle aurait suffi. Il est bien vrai que les miracles ne coûtent rien à celui qui sait les faire.
Moi, je ne partageais pas l’avis de l’auteur de Candide. Dans un pays comme celui-là, il est plus facile de faire un miracle que de construire un pont, et il n’est pas dit qu’il déplaise au Dieu de Moïse d’épargner temps et fatigue. Et puis, si nous avions tenté nous aussi de passer à gué le Jourdain, qui sait si l’eau ne se serait pas retirée devant nous, comme devant les prophètes Élie et Élisée.
- Si vous voulez, proposa Voltaire, nous pouvons essayer.
Mais nous étions déjà sur l’autre rive, et nous fumes d’accord pour faire l’essai au retour.
- Je ne veux pas vous donner tort, poursuivit le Patriarche de Ferney, mais il me semble que vous faites trop confiance aux miracles. Vous êtes Italien et ceci explique cela. Vous autres Italiens, vous croyez aisément aux choses miraculeuses, l’histoire de vos faits et de vos fortunes en souffre. Grâce à Dieu, nous, Français, nous sommes plus prudents, plus attachés au solide, au concret. Nous sommes habitués nous aussi à être trahis, mais nous nous appuyons sur la raison plutôt que sur la fantaisie. Il s’interrompît et tourna les yeux vers la mer Morte, qui s’étendit maintenant devant nous, opaque et bleue sous le soleil oblique. La route tournait sur notre gauche, vers l’orient, entre la mer et le bord d’une plaine désolée, couverte de broussailles, et parsemée ça et là de plaques sablonneuses et de pierres blanches, pareille à une immense tête teigneuse.
– Seriez-vous fâché, reprit Voltaire, si je vous disais que les Italiens sont tous comme le capitaine de la mer Morte ?
Peu de temps avant d’emprunter le pont sur le Jourdain, dans l’auberge de Spîriotikès, cafetier grec aux grosses moustaches noires cosmétiquées et aux yeux de pierre à fusil, d’où le soleil faisait jaillir des étincelles à chaque mouvement de la tête, nous avions rencontré un personnage à l’air important, pansu et barbu, occupé à déguster un café dans une minuscule tasse de cuivre. C’était le célèbre capitaine de la mer Morte, le Christophe Colomb du paquebot rouillé qui fait le service régulier entre l’embouchure du Jourdain et la côte de Kerak, où un château construit par les croisés rappelle les exploits de Renaud de Châtillon : depuis des siècles, les ronces et le sable assiègent les murs garnis de tours, et les rats les rongent. Assis près du loup de mer, sous la tonnelle, Spiriotikès nous écoutait sans ciller. L’ombre de la tonnelle se brisait à quelques pas de nous, sur la berge du Jourdain, en une frange bleue et or qui jouait avec l’eau boueuse. C’est là le lieu précis où Jean baptisa Jésus-Christ : le cafetier grec y fait bonne garde, et aucun Josué, aucun Élie ne pourrait passer à gué sans lui donner un pourboire.
Quand Spiriotikès nous avait conseillé de revenir en arrière, ou de passer la nuit chez lui, si nous ne voulions pas aller au-devant de l’orage qui s’annonçait sur les montagnes de Moab, du côté de Sodome, « eau, feu, ou cendre, à Sodome il pleut toujours quelque chose », le capitaine de la mer Morte avait levé la tête brusquement, criant d’une voix tonitruante :
– Il ne pleut jamais, ici, il ne pleut jamais ! Et se calmant soudain : il ne faut pas, ajouta-t-il d’une voix douce, effrayer ces messieurs. On le sait bien, les orages sont des orages : mais il m’appartient de vous dire qu’il est inutile de redouter les tempêtes. Moi, je n’ai peur de rien, et il y a quarante ans que je flotte sur cette mer. Il n’est pas de meilleur marin que moi dans toute la mer Morte.
– D’autant plus, avait interrompu Voltaire, qu’il ne doit pas y en avoir d’autres : n’êtes-vous pas le seul marin des environs ?
– Le seul et le meilleur ! avait répondu le capitaine, que toute la terre se noie, je ne me noierai pas ! Puis d’une voix plus douce : pourtant, c’est un miracle, un vrai miracle, si je flotte encore, pensez donc, en quarante années, il ne m’est jamais arrivé de couler.
Et c’est à ce loup de mer que Voltaire comparait les Italiens.
– Pourquoi devrais-je m’offenser ? répondis-je, ce brave capitaine m’a tout l’air d’un galant homme.
– Sans aucun doute, repartit l’auteur du Sottisier, mais d’un galant homme qui croit aux miracles. Sa foi est si aveugle et sa conscience si tranquille qu’il fait beaucoup plus confiance aux vertus miraculeuses de son navire, qu’à la composition chimique de l’eau de la mer Morte. Le fait que son navire ne puisse pas couler ne doit pas être attribué à un miracle, mais à l’extraordinaire densité de cette eau. L’analyse du docteur Lortet nous révèle la présence d’une telle quantité de chlorures et de bromures de magnésium, qu’aucun organisme ne peut y vivre. Pensez que dans soixante parties d’eau se trouvent dissoutes au moins trente parties de chlorure de sodium, de calcium, de magnésium, de potasse, de bromure de magnésium et de sulfate de calcium. Essayez d’y jeter un enfant de quelques mois : il ne pourra pas couler. C’est une mer sur laquelle tout flotte, où un naufrage est impossible. Le capitaine de la mer Morte, malgré tous ses efforts, ne peut pas couler à pic ; son paquebot ne peut pas faire naufrage. Voilà un marin qui ne doit pas crier au miracle parce qu’il flotte, le miracle serait qu’il coulât.
– Je ne comprends pas, dis-je en souriant, pourquoi les Italiens ressembleraient à ce brave capitaine…
Mais un grand vent se leva, un nuage vert, suspendu au-dessus de nos têtes et dans lequel le soleil allumait par moments d’étranges reflets d’argent tout comme s’il était plein de poissons frétillants, s’abaissa tout à coup et il se mit à pleuvoir d’innombrables sauterelles crépitantes. Aussitôt un tourbillon de poussière rougeâtre monta de la plaine teigneuse, et nous nous trouvâmes rapidement comme dans un ouragan ; la tempête de sauterelles s’abattait sur les broussailles, sur les taches de sable et sur la mer avec un bruit de feuilles sèches frappée par la grêle. Ces terribles dévoreuses s’accrochaient à nos cheveux, à nos visages, à nos vêtements, le sol en était couvert sur plusieurs milles à l’entour, l’air scintillait et bruissait d’ailes d’argent que le soleil oblique frappait de ses glaives poudreux, et la mer sombre bouillonnait. Je ne pouvais plus respirer, mes yeux brûlaient ; sur la croupe de mon cheval grouillaient de petits monstres jaunes et verts aux mandibules féroces, un relent de sueur, une odeur âcre de fourmis, pleuvaient de ce nuage vivant et bourdonnant.
J’éperonnai mon cheval, qui se mit à galoper, suivi de la Ford.
– Arrête ! Arrête ! criait Voltaire, agrippé à son volant, la tête basse, et aveuglé par cette pluie extraordinaire qui frappait violemment son visage en le piquant jusqu’au sang : une sorte de roi Lear dévoré par les remords et par les sauterelles. Enfin, nous réussîmes à sortir de ce nuage, et revenus à l’air libre, nous regardâmes autour de nous essoufflés et contents. Assis sur le bord de la route, deux hommes, vêtus à la façon des Arabes, semblaient attendre quelqu’un. Ils levèrent la tête et nous saluèrent en anglais.
– Bonjour, dit Voltaire, et il demanda si Sodome était encore loin.
– Sodome est là, dit un des deux hommes, tendant le bras d’un geste solennel en direction d’une colline qio surgissait à peu de distance : au pied de la colline, on voyait des tentes, quelques masures, et un peu de fumée qui montait d’un repli du terrain.
Les deux hommes ne semblaient pas dépasser la trentaine, et quoique grands et forts, avec des épaules larges et un cou musclé, ils avaient des mains petites et blanches et des visages d’enfants, presque de fillettes, encadrés par deux bandeaux de cheveux blonds qui, partagés sur le milieu du front, retombaient sur leurs épaules comme chez les anges de Benozzo Gozzoli.
– Si vous allez aussi dans cette direction, poursuivit l’inconnu après nous avoir fixés longuement dans les yeux, nous pouvons faire ce dernier bout de chemin ensemble.
– Montez donc, proposa gentiment Voltaire, je ne sais si vous serez à votre aise, mais je ne puis vous offrir mieux.
– Cela suffit, dit celui des deux qui n’avait pas encore ouvert la bouche, pour vous faire considérer comme un galant homme, même à un mille de Sodome.
Chemin faisant, les inconnus demandèrent au Patriarche de Ferney si nous n’avions pas rencontré, un peu avant le pont sur le Jourdain, les ingénieurs du Commissariat anglais de Jérusalem ; et ils ajoutèrent qu’ils appartenaient à la police de la route, qu’ils avaient reçu l’ordre de se rendre à Sodome pour y faire une enquête sur les douloureux événements de la veille, et qu’ils s’étonnaient de nous voir seuls et désarmés, dans un pays aussi peu sûr. Le soir précédent, à Sodome, un archéologue américain, venu de Boston pour rechercher les ruines de la maison de Loth, avait été assailli, par quelques Arabes, qui campaient dans les environs, et soigneusement rossé : il s’était sauvé par miracle, et justement comme Loth.
–Je n’ai aucune intention, dit Voltaire, de subir le sort de cet archéologue, et j’espère qu’à l’occasion, vous défendrez mes arrières contre les Sodomites. Et il se mit à fredonner entre les dents, avec un malicieux sourire, ces vers à la mémoire de Loth :
Loth but
Et devint tendre
Et puis il fut
Son gendre
– Vous autres, Anglais, dit-il, lorsqu’il eut terminé le quatrain, vous n’êtes pas très forts en histoire ancienne, et pour l’histoire sainte, votre ignorance est plus classique que celle de Rousseau.
– Je vous approuverais, repartit celui des deux inconnus qui semblait avoir le plus d’autorité, si nous étions Anglais comme vous dites ; mais nous sommes d’ici, et l’histoire sainte est un peu la chronique de notre famille.
– Vous êtes donc Juifs ? demanda le Patriarche de Ferney.
– Ni Juifs , ni Arabes, répondit l’autre, nous sommes des anges.
– Je m’y attendais, dit Voltaire d’un air pacifique, quoique, jusqu’à ce jour, j’aie toujours douté de votre existence. Mais dans ce pays, tout est possible, et votre Dieu a toujours été un faiseur d’anges. Toutefois, j’espère que pour me convaincre de votre existence, vous ne voudrez pas me contraindre à lutter avec vous, comme fit certain ange avec Jacob.
– Nous ne sommes pas ici pour attaquer les gens, répondit l’autre, mais pour les protéger, et soulevant les pans de son grand manteau blanc, il nous montra son uniforme anglais couleur tabac. Puis il se mit à nous raconter son histoire et celle de son camarade, qui est un peu celle de tous les anges de Palestine. Après avoir chassé les Turcs, les Anglais s’étaient établis en maîtres dans tout le pays et ils avaient commencé, dès les derniers mois de 1918, à recruter des soldats et des employés parmi les gens de l’endroit : Arabes, Grecs, Juifs, Anges, soit moyennant argent et promesses, soit par la force. Un véritable racolage. Ces quelques anges échappés aux guerres, aux persécutions religieuses, aux famines et aux épidémies, qui ont affligé pendant plusieurs siècles la Terre sainte, s’étaient vus tout à coup contraints d’abandonner, en toute hâte, leur champs et leurs maisons, pour faire place aux Juifs, que la politique de Balfour acheminait de tous les coins du monde vers la Palestine, ou de subir la volonté des nouveaux maîtres. Mais ils n’avaient pas tous réussi à passer la frontière en temps voulu, pour chercher refuge en Syrie et en Turquie : plusieurs d’entre eux avaient été saisis par les plumes à mi-route ; ou rejoints en vol par les escadrilles du camp d’aviation de Jérusalem, ou bien encore, dénichés dans les grottes des montagnes du Moab et, pour les empêcher de s’enfuir, on avait rogné les ailes aux anges prisonniers. Nos deux compères avaient dû subir le sort commun, et s’étaient vus obligés d’endosser l’uniforme anglais, d’accepter une solde, et de prendre du service dans la police de la route de Sa Majesté britannique. Tout le monde sait que, dans l’administration coloniale anglaise, les anges abondent depuis l’époque de Gladstone, qui se disait inspiré par Dieu.
– Il est vraiment dommage, dit Voltaire, que nous ne puissions plus vous voir planer avec vos grandes ailes d’argent ouvertes. Mais je suis sûr qu’à Paris, vous auriez du succès même comme cela.
– Si au moins on nous avait laissé un petit bout d’aile, s’écria l’ange, ne fût-ce que pour nous élever d’une palme au-dessus de la terre.
– Les Anglais, remarquai-je, n’admettent pas que les hommes et les peuples assujettis puissent se consoler, d’une certaine façon, de la politique britannique.
– C’est à juste titre qu’ils se vantent d’être philanthropes, dit l’ange en souriant, seule la philanthropie peut conserver les empires.
Nous étions arrivés au pied de la colline. Quelques Arabes sommeillaient, couchés devant les tentes et les masures de roseaux et de boue, éparpillés sur la pente herbeuse où broutait un troupeau de brebis décharnées. Plus loin, vers la mer Morte, on découvrait, à ras de terre, quelques restes de murs, étouffés par le sable et par les broussailles.
– Voici les ruines de Sodome, dit l’ange, et plus loin celles de Gomorrhe. La colline devant nous, que les Arabes d’ici appellent Djebel Usdum ou Montagne de Sel, est la statue de l’épouse de Loth.
– Si je ne craignais pas de devenir moi aussi une statue de sel, observa l’auteur de Candide, je reviendrais en arrière avant qu’il ne fasse nuit. En y pensant bien, il ne me semble pas prudent de passer la nuit dans ces lieux.
– Et qui pourrait donc vous toucher, si vous restez avec nous ? dit l’ange. Je m’appelle Artaxerxes, et dans la vallée du Jourdain, même les pierres me connaissent. Tout le monde sait qu’avec moi on ne plaisante pas. Puis, regardant autour de lui : À quelques pas d’ici, ajouta-t-il, se trouve une vieille tour en ruines, où les Turcs, pendant la guerre, avaient installé un poste de garde : nous y serons à l’abri et en sécurité. Craignez-vous peut-être que les habitants de Sodome soient aujourd’hui comme ceux d’autrefois ?
– On ne sait jamais, répondit Voltaire, en tout cas, il vaut mieux avoir les épaules contre le mur.
– Si vous avez peur de rester à Sodome, proposa Artaxerxes, nous pouvons aller à Gomorrhe, qui se trouve à deux milles d’ici.
– Je préfère passer la nuit parmi les Sodomites, dit Voltaire, je connais leurs habitudes et je peux me défendre, car nous savons ce que l’on faisait à Sodome, mais à Gomorrhe ? Que diable faisait-on à Gomorrhe ?
– C’est ce que je me demande, moi aussi, répondit Artaxerxes.
Entre-temps, nus étions arrivés à la tour, et l’ange n’ajouta rien.
Assis, les bras autour des genoux, dans la tour en ruine, deux anges chantaient : les voix étaient lasses et douces, les paroles suaves, l’air triste et monotone, comme les airs des forçats de Volterra. Ils chantaient dans une langue inconnue, harmonieuse comme le frôlement d’une aile. J’ai essayé ensuite, avec l’aide d’Artaxerxes, de traduire ces paroles si bleues, si aérienne, mais le bleu est devenu gris et sombre, tout plein d’ombres terrestres :
L’ange Anadyomène
à la bouche douce encore
de sommeil, sort au-devant de l’aurore.
Son aile à peine le soutient.
Artaxerxes chantait les yeux fermés, la tête renversée : l’autre semblait dormir, le visage sur la poitrine, et chantait du bout des lèvres comme dans un rêve.
Il remue chastement les hanches
L’ange hermaphrodite
Au regard assoupi,
Vidage candide, mains blanches.
Attaché par le licou à un piquet derrière la tour, près de la Ford, mon cheval hennissait de temps en temps et frappait le sol de son sabot, inquiet et impatient. Un vent chaud et lourd soufflait de la mer, le vent huileux de la mer Morte qui sent l’eau saumâtre et le bitume.
– Si les Anglais comprenaient le langage des anges, dit Voltaire quand Artaxerxes et son compagnon eurent cessé de chanter, je pense qu’ils pourraient dormir en Palestine, les yeux fermés.
– Et pas seulement en Palestine, remarquai-je, la raison de la crise, dont souffre depuis quelque temps la politique impériale britannique, réside dans le fait que les Anglais, comme les anciens Romains, n’arrivent pas à comprendre le langage des anges.
– L’Angleterre, dit Artaxerxes, est tombée dans la même erreur que les historiens reprochent à Rome : il ne suffit pas de s’approprier la Palestine, ombilic de la terre et du ciel, pour pouvoir dominer le monde, il faut apprendre le langage des anges pour comprendre celui des hommes et pour connaître leurs secrets, c’est-à-dire pour dominer les peuples. À Rome aussi, comme on ne parvenait pas à comprendre le sens de nos paroles, on se vengeait en rognant les ailes des anges , on les asservissait à la politique nationale, en les réduisant à l’état d’esclaves et en les utilisant comme instruments pour les plus bas services. Ce Judas qui trahit Jésus était un ange abruti par l’esclavage et son métier : en effet, Judas faisait partie de l’Intelligence Service d’alors, un agent provocateur, comme on dirait aujourd’hui. Mais tout cela a porté malheur aux Romains, et ne peut, certes, porter bonheur aux Anglais.
– Maigre consolation, s’écria le compagnon d’Artaxerxes.
– Toi, Lucie, il est inutile que tu parles de consolation, répondit Artaxerxes, tu as un caractère trop fier, et tu ne te consolerais même pas si tes ailes repoussaient et si Londres était rongée par les rats.
– Votre compagnon, demanda Voltaire, est donc une ange puisqu’il s’appelle Lucie ?
– Pour nous, répondit Artaxerxes, les noms ne comptent pas = mon compagnon a un nom féminin, mais c’est un ange.
– La question n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire, dit Lucie, tous les anges sont hermaphrodites, mais ont soin de cacher, peut-être par pudeur, leur sexe féminin. En effet, les peintres les représentent toujours comme des êtres appartenant au sexe masculin : pourtant, à Rome, dans une église, exception unique, une fresque célèbre les représente comme des êtres appartenant au sexe féminin. Ce sont là les seuls anges féminins dont les profanes aient connaissance.
[…]
Source : Curzio Malaparte, Sodoma e Gomorra, Milano, Treves, 1931.
[Ce texte a probablement paru, au cours des années 1920, dans Strapaese, organe du fascio des campagnes, ou dans Stracitta, son mortel adversaire des villes (Malaparte écrivait dans les deux). NdGO]
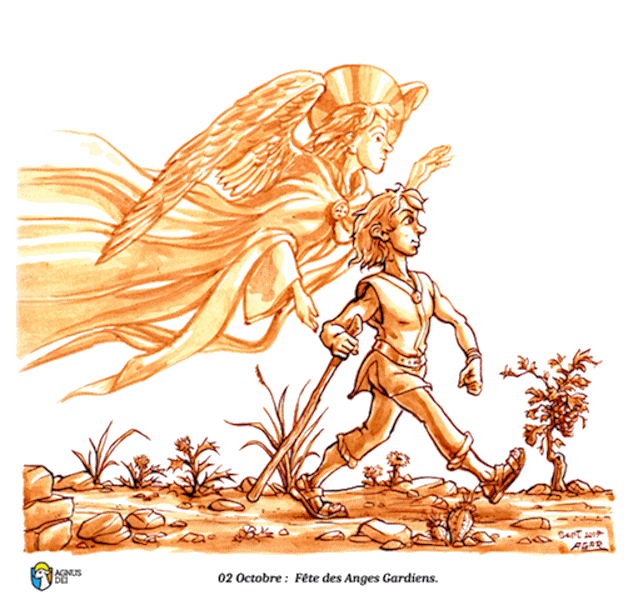
Ah, le sexe des anges !...
Nous ne vous dirons pas comment se termine, pour l’illustre François-Marie, cette édifiante histoire, d’abord pour l’amour du suspense, mais aussi pour ne pas nous attirer les foudres de ses éditeurs. Il existe plusieurs publications de Sodome et Gomorrhe en français. Libre à vous d’y aller voir :
- in Sang (avec d’autres nouvelles), aux éditions du Rocher, Monaco, 1982 ; puis en édition de Poche séparée, collection Alphée (160 pages) 1989.
- en Presse-Pocket, collection Blanche (138 pages) 1992
- avec La tête en fuite, aux Belles Lettres (302 pages) 2014

Mis en ligne le 9 décembre 2017.
23:43 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook |
Facebook |















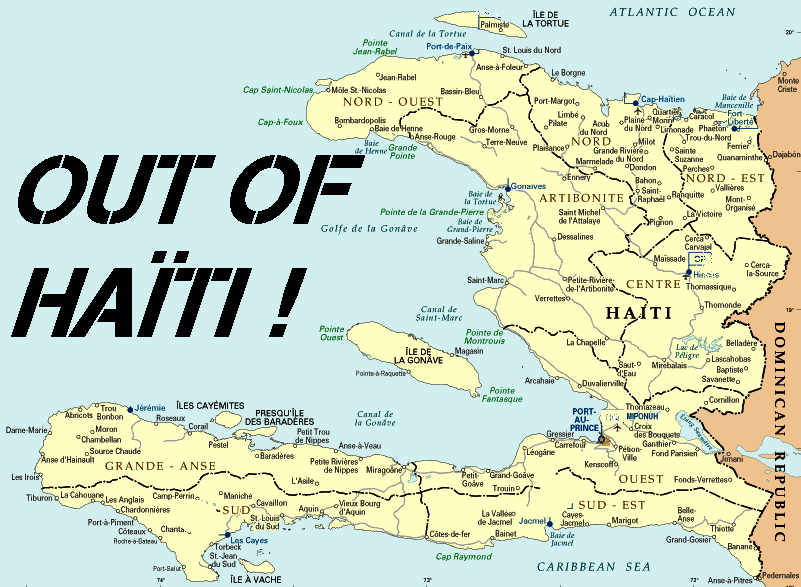







Commentaires
Grâces soient rendues à la webmistresse du site qui suscite chez des béotiens ignorants l' envie de découvrir des oeuvres auxquelles ils ne pensaient pas au premier abord.
Écrit par : Sémimi | 10/12/2017
Les commentaires sont fermés.