18/10/2016
LIVRES ENCORE... ET POURQUOI PAS
Livres encore… et pourquoi pas.
ou
Du bon usage des personnages historiques dans la littérature policière
1/4
par Théroigne
Doit-on se justifier de consacrer un post – plusieurs, au train où vont les choses… – à des livres, quand tout va si mal dans le monde ? Question oiseuse : cela fait partie de nos obligations. Voyez notre en-tête et « Qui nous sommes ».
Mais surtout…
Essayez d’imaginer un monde sans livres. Cela vaudrait-il encore la peine de se battre pour l’aménager ? De temps en temps, nous avons besoin de nous en persuader, voilà.
« …que de livres il a cessé de lire voire jetés au loin, parce qu’il y avait trouvé des noms trop vrais ou trop faux… »
Alberto Ongaro
La taverne du doge Loredan
Où les Grands-Bretons, malgré le Brexit, la décadence de l’empire, la crise et le carnaval de Notting Hill, trouvent le moyen de se payer une mini-bataille d’Hernani
Peut-on faire parler un personnage historique dans une œuvre de fiction ? Shakespeare a, pour sa part, depuis longtemps tranché la question. Il a même abusé de cette liberté en en faisant mentir certains dans des œuvres de propagande. Après lui les mouches, Alexandre Dumas et beaucoup d’autres.
Pourtant, la question a été récemment re-posée et débattue en Angleterre, avec des conclusions antagoniques et des adversaires qui ne se sont pas réconciliés. Disons que les « contre » étaient surtout historiens et les « pour » surtout auteurs de fiction. Dans l’ensemble.
À propos de quoi ?
À propos de Mrs. Hilary Mantel et de ses récents romans historiques tournant autour de la personne du roi Henry VIII. D’aucuns ont estimé qu’elle avait pris, avec le Barbe-Bleue roux des Tudors, des libertés qui ont choqué.
Paraphrasant sans le savoir Coluche (« Comment veux-tu qu’un con sache qu’il est con, puisque c’ est avec son esprit qu’il juge »), leur argument principal, pas si faux que cela, est qu’on ne peut pas faire parler juste quelqu’un qu’on n’est pas, qu’on n’a pas inventé puisqu’il a existé, et qu’on n’est probablement même pas capable de comprendre, car si on l’était, on ferait comme lui (ou elle) une grande carrière au sommet – politique, artistique, philosophique ou autre – au lieu de scribouiller des romans pour distraire ses contemporains.
C’est déjà le reproche que faisait Robert Graves à ceux qui ont usé de la matière sacrée de nos ancêtres comme d’un matériau anodin – prosaïque - pour en faire, au Moyen-Âge, les tout premiers romans de notre littérature.
Et le nœud de l’affaire est bien là : par « personnages historiques », on sous-entend « personnages sacrés ». Mais le sont-ils tous ? Dans quelle mesure ? À quel titre ? Aux yeux de qui ? C’est dire si la question est loin d’être vidée.
Il n’en fallait pas plus pour nous persuader qu’il n’était peut-être pas inutile, et, qui sait, peut-être même opportun, de jeter un coup d’œil sur ceux qui n’ont pas craint de relever le défi. Et de les chercher plus particulièrement dans le roman à énigme, dit « policier » ou polar.
Pourquoi ?
Parce qu’il sera impossible à notre descendance (à supposer que nous en ayons une) de connaître l’histoire des XXe et XXIe siècles sans passer par cette frange de la littérature, et parce qu’en se jetant avec un tel enthousiasme sur ce matériau – l’Histoire – les auteurs de polars se sont volontairement ou non donné pour tâche de combler le vide énorme provoqué par les (dés)éducations nationales, quand elles ont supprimé l’enseignement, si biaisé fût-il, de l’Histoire aux jeunes couches ignorantes de tout ce qui les a précédées Que les imposteurs se faisant passer pour des responsables de l’enseignement public voient leurs efforts de lobotomisation des masses battues en brèche par ce qui se vend le mieux en matière de chose écrite nous paraît relever d’une justice immanente particulièrement morale. Ce post en quatre parties va donc se vautrer sans vergogne dans le « polar historique ».
La pomme de discorde
Et seulement au titre d’objets du litige, puisque simples romans historiques sans assassins ni voleurs particuliers qu’un limier rechercherait pour les punir.
Hilary Mantel

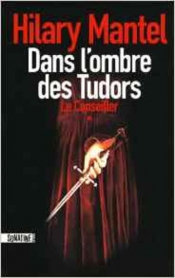
Hilary Mantel
Dans l’ombre des Tudors – Le conseiller
Paris – Sonatine – 2013
816 pages

Hilary Mantel
Dans l’ombre des Tudors – Le pouvoir
Paris – Sonatine – 2014
480 pages
Un 3e tome est prévu.
À noter que l’auteur est la seule femme à avoir reçu deux fois le Booker Prize : précisément pour ces deux livres.
Curieuse, d’ailleurs, cette levée de boucliers contre Mrs. Mantel, parce que, des années avant elle, un autre écrivain anglais avait mis les pieds dans le plat non pas à propos de la vie du monarque en général mais de ses principaux crimes, qui ne furent pas quelques épouses décapitées.
Il avait même fait observer en outre qu’il ne s’était pas trouvé, jusqu’à lui, un seul historien pour aborder ce sujet (en gros depuis la fin de la dernière guerre, soit pendant un bon demi-siècle). Se sentant morveux sans doute, les doctes n’avaient pas relevé. Ils se sont rattrapé sur Mrs. Mantel.
Je ne vais pas m’étendre ici sur ses deux best sellers – c’est peut-être aussi cela qu’« on » ne lui pardonne pas – puisqu’ils ne relèvent pas du genre policier, étant bien entendu que, comme l’a écrit Simenon, il n’existe pas à proprement parler de « romans policiers », de « romans à énigme », de « thrillers » ou de « romans populaires », mais des bons et des mauvais romans.
Qu’est-ce alors que j’appelle « polar » ? Cette sorte de livre où un auteur, en se servant du parti pris d’un ou de plusieurs crimes à élucider et d’un ou de plusieurs coupables à identifier et quelquefois même à mettre hors d’état de nuire, parle de son époque ou d’une autre qui l’intéresse et de ce qui s’y passe ou s’y est passé, bref, de tout sujet qui lui tient à cœur. Le genre est vaste et les variantes infinies.
C.J. SANSOM

C.J. Sansom, puisque c’est de lui qu’il était question plus haut, est le tout premier, en Angleterre, qui se soit servi d’un roman policier pour mettre sous une lumière crue les énormes crimes du roi Henry VIII. C’était son coup d’essai. Ce fut un coup de maître. Le titre de cette première oeuvre : Dissolution.
Le sujet apparent de son livre, bien entendu, est un crime, commis dans un monastère de province, crime de sang dont il faut découvrir et faire châtier l’auteur. Le sujet réel est un crime de masse commis sur tout le territoire du pays, dont l’auteur ne sera ni recherché ni puni.
L’enquêteur de génie (ils le sont tous) de M. Sansom s’appelle Matthew Shardlake. C’est un avocat londonien, plus ou moins du camp des réformés, et bossu. Il est ici envoyé par le vicaire-général du Royaume et bras droit d’Henry VIII, Thomas Cromwell (l’évêque, pas le chef des Têtes Rondes), au monastère de Scarnsea, pour tenter de découvrir qui y a décapité son prédécesseur et pourquoi. Toutes choses qu’il sait déjà, probablement, et que découvrira Shardlake en même temps que nous.
Ce que découvrira en outre cet avocat intègre, et contre quoi il ne pourra rien, sera l’étendue du crime en train de se commettre à l’encontre de l’Église catholique d’une part, et de la population laborieuse anglaise par ricochet, crime connu sous le nom de « Dissolution des monastères ».
Vais-je vous résumer en trois lignes ce que même Wikipedia ne fait pas ? Essayons :
Les guerres coûtent cher. Elles furent pendant des siècles l’occupation des têtes couronnées d’Europe et le resteront jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus (de têtes à couronnes ou d’équivalentes). Au cours des siècles, l’Église a accumulé de fabuleuses richesses, rien qu’en prélevant l’impôt sur toutes les populations productives de la chrétienté, déjà saignées à blanc par leurs bergers autoproclamés.
Or, quoi de plus naturel, quand on n’a pas de quoi se payer des troupes et des canons pour étendre sa puissance et sa richesse, que de lorgner vers les coffres ruisselants d’or du Vatican et de se demander comment faire pour mettre la main dessus ? C’est humain.
Au XVIIIe siècle par exemple, TOUS les monarques d’Europe en rêvaient. Seule, la République française l’a fait, hélas contrainte et forcée et dans des conditions catastrophiques, parce qu’en prenant le relais de la royauté à la tête de la France, elle s’était (bien inconsidérément) engagée à honorer les dettes de la couronne. Qui étaient immenses. Exorbitantes. Qui ne pouvaient PAS être remboursées.
Ces amateurs (avocats, oui, eux aussi) pensèrent qu’en nationalisant les biens de l’Église, ceux–ci permettraient à « la France » de rembourser les emprunts pharamineux qu’avait faits la famille de Bourbon, pour – entre autres – aller tailler des croupières aux Anglais dans leurs colonies, en soutenant les indépendantistes yankees. Passons.
Pour que les « biens du clergé » remplissent la fonction qu’on entendait leur assigner, il eût fallu pouvoir les exploiter comme lui-même l’avait fait, c’est-à-dire, en faisant par cette voie cracher le peuple au bassinet, chose hélas contraire aux très transitoires principes de ces inconséquents disciples de Rousseau. Paniqués, les nouveaux timoniers du navire les vendirent, et qui plus est dans l’urgence, nourrissant le fol espoir que le produit de la vente calmerait les appétits du FMI d’époque. (en gros : les banques, qui avaient mis le bon Louis XVI en faillite en refusant de lui prêter un sou de plus).
Vendre des propriétés dans l’urgence, c’est les vendre à perte et à n’importe qui. Tout ce qui avait les dents longues et peu de scrupules se jeta sur l’aubaine et s’enrichit en quelques mois de la plus honteuse manière, mais les actes honteux sont ceux qui ont les conséquences les plus durables. De cette horde d’acquéreurs à bon compte, dont allait sortie la grande bourgeoisie française du XIXe siècle, fut Georges Danton, qui, certes ne conserva pas longtemps ses biens mal acquis, mais sa famille oui, merci. Petit exemple entre tant d’autres. Fermons la parenthèse.
Tous les couronnés d’Europe regardèrent avec envie cette jeune république qui venait d’oser. Pourtant, deux siècles et demi avant elle, un des leurs l’avait fait, bien plus efficacement et plus brutalement qu’elle. Vous l’avez deviné : Henry VIII
On a, pendant des siècles, enseigné aux enfants des écoles (et pas qu’en Angleterre) que le pauvre roi était marié à une sœur du roi d’Espagne, laquelle, hélas pour lui, n’avait pas été capable de lui donner d’enfant mâle, dont il lui fallait absolument un pour lui succéder sur le trône. Las, la reine, et surtout son puissant frère, étaient catholiques (Henry VIII aussi, remarquez) et l’Église catholique n’admettait pas qu’on divorce. Si votre épouse ne pondait que des filles, c’est que Dieu l’avait voulu et il vous fallait la garder. Henry, indigné (nous apprit-on) avait préféré sortir de l’Église et la remplacer par une à lui : l’anglicane, répudier sa reine espagnole et en épouser d’autres, qu’il se mit à décapiter jusqu’à ce qu’il y en eût une qui réussît à lui donner un fils.
Mais tout cela bien sûr n’était que fariboles de forme. La preuve, c’est que ses deux filles lui ont succédé et que la seconde a gouverné l’Angleterre pendant presque un demi-siècle.
Alors, pourquoi ?
Henry VIII voulait faire la guerre. À son beau-frère d’abord, qui croulait sous les richesses venues du continent sud-américain, si riche que le pillage n’en est même pas terminé comme on va le voir dans les mois qui viennent. À la France ensuite, s’il pouvait, et à n’importe qui d’autre qui lui eût permis d’accroître sa puissance et ses richesses. Mais comment faire pour solder ses soudards ? En mettant la main sur les biens de l’Église dans son pays, certes, mais comment ? À ces choses-là, il faut des prétextes. Il en trouva. Comme cela se fait encore couramment de nos jours, il lança une campagne de calomnies contre les membres du clergé rétifs à ses racketteurs. Les abbés, prêtres, évêques et moines-en-chef furent accusés de tout et de n’importe quoi : de sodomie, de pédérastie, de simonie, de sorcellerie, de pactes avec le diable, etc. La condamnation était toujours à mort et les biens des condamnés évidemment saisis par la couronne. Thomas Cromwell, nommé « justicier » suprême, fut chargé de débarrasser son maître de tout ce qui faisait obstacle à ses besoins. L’Église d’Angleterre fut décimée, ses biens séquestrés jusqu’au dernier penny et ses immeubles – églises, monastères, abbayes – rasés jusqu’au sol. C’est une des plus grandes catastrophes architecturales de l’Histoire.
Cependant, il y avait, autour de ces gras établissements qui rapportaient tant à Rome, un nombre infini de villages remplis de paysans et d’artisans qui, certes, payaient la dîme au clergé, mais que celui-ci, en retour, faisait vivre en leur procurant du travail. Ces populations – on peut employer le mot au pluriel – se retrouvèrent, du jour au lendemain, non seulement ruinées mais sans la moindre possibilité de gagner leur vie. Taux de chômage : 100%. Des centaines de milliers de paysans, d’ouvriers agricoles et d’artisans furent sans pitié jetés sur les routes avec la chemise qu’ils avaient sur le dos et affluèrent naturellement dans les grands centres urbains – pas nombreux - où, justement, on allait avoir besoin de main d’œuvre à bon marché, gratuite si possible, pour s’enrichir.
L’Angleterre bourgeoise et commerçante - qui avait, en 1400, rayé de la carte l’Angleterre agricole, lorsque Henry IV Bolingbroke avait fait assassiner Richard II pour lui ravir sa couronne et changer le cours des choses – passait tout simplement, avec Henry VIII, à la vitesse supérieure. Avec une brutalité inouïe mais souvent égalée par la suite et ce n’est pas fini. Ce sont ces populations « déplacées » par la dissolution, qui allaient faire de Londres la ville terrible que décriraient au XIXe siècle Charles Dickens et Gustave Doré.
Le roi Henry VIII remercierait son complice Thomas Cromwell des crimes commis à son bénéfice en lui faisant couper la tête, comme il est de règle dans ces milieux.
C’est ce que rappelle, sans en avoir l'air, le « petit polar » de M. Sansom. Et c’est sur cette infamie que les historiens patentés font si complaisamment silence depuis si longtemps. On ne perd donc pas toujours son temps à lire des romans policiers historiques.
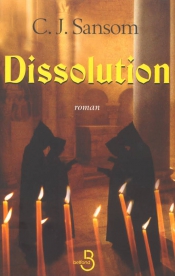
C.J. Sansom
Dissolution
Belfond, 2004 Pocket, 2005.
544 pages
Autres titres du même auteur :
Les larmes du diable, Belfond, 2005
Sang royal, Belfond, 2007
Prophétie, Belfond, 2009
Corruption, Belfond, 20011
Lamentation, Belfond, 2016
Site officiel de C.J. Sansom (en anglais)
http://www.cjsansom.com/Homepage
Fred VARGAS

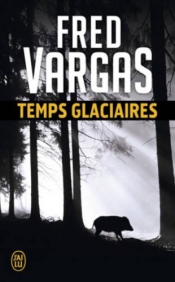
Fred Vargas
Temps glaciaires
Editions 84 – 2016-08-14
475 pages
À l’inverse, Temps glaciaires de Fred Vargas est loin d’être un coup d’essai, et plus loin encore d’être un coup de maître. Disons-le tout net : c’est un coup raté. Mais raté pourquoi et comment ?
Commençons par le « comment ».
Ce livre ni fait ni à faire (mais presque aussi massivement marchandisé que le Da Vinci Code, pas de souci à se faire pour l’auteur) n’a pas de véritable sujet, pas de véritable intrigue, pas d’énigme, pas de suspense et aucun personnage consistant, en ce compris les membres récurrents de la pittoresque brigade criminelle du XVIIIe arrondissement, auxquels on s’était pourtant habitués, contents de retrouver en eux le sentiment de sécurité que procurent à tout aficionado les moustaches et la manie du rangement d’Hercule Poirot ou le pardessus à col de velours et les pipes de Maigret, voire le fricandeau à l’oseille de Madame. Cette fois, les absences d’Adamsberg, la marmaille et le QI de Danglard et la grâce mastodontique du lieutenant Violette sonnent creux. Pire : ils pédalent dans le vide.
« Pourquoi » ?
C’est que Fred Vargas a voulu se mêler de quelque chose qui n’était pas à sa portée et qu’elle a ainsi imprudemment révélé ses limites. C’est que s’attaquer à un personnage réel, historique, c’est s’attaquer à l’Histoire et que, dans ces matières, l’aplomb décomplexé de l’ignorance ne remplace pas tout.
Fred Vargas, polardeuse historique sans expérience et ne doutant de rien a tout de suite visé à la tête : Robespierre. Pas au point d’oser en faire un personnage actif – l’action est contemporaine – mais en y allant par la bande, en crabe, par un tour de passe-passe qui, justement, ne passe pas. En outre, Temps glaciaires, hélas, se prend au sérieux – pas la peine d’y chercher la joyeuse iconoclastie de Liberté, Égalité, Choucroute…– et c’est le plantage en beauté. Car si c’est raté du point de vue historique, ce l’est aussi du point de vue « roman policier » qui aurait pu être dissocié.
Excès d’ambition ? Elle nous vend même deux « intrigues » pour le prix d’une, les deux étant inexistantes et leur addition ne faisant quand même que zéro.
L’« action », commencée à Paris par une mort suspecte, se poursuit en Islande, avec un tueur en série (dont on ne connaîtra jamais ni les motivations ni l’hypothétique trauma) qui fait des témoins forcés de ses forfaits des cannibales pour les empêcher de le dénoncer, et continue, rentré à Paris, de les tenir à sa merci pendant 25 ans au moyen d’une secte de son invention, à laquelle il les force d’appartenir. Secte qui communie dans le culte (version Vargas) de Robespierre, c’est-à-dire qui passe son temps à rejouer, régulièrement, les moindres événements de la Révolution, chacun incarnant, costumé et maquillé, l’un ou l’autre de ses nombreux participants. Jeu de rôles à durée illimitée en somme.
Ainsi, le mystérieux tueur du froid a dû, pour continuer à couvrir ses crimes, recruter quelque six cents personnes, les réunir ad vitam aeternam à dates fixes, les persuader de se ruiner en costumes d’époque pointilleusement reconstitués, et d’apprendre par cœur les tirades, généralement longues, de ceux qu’ils sont censés réincarner – La Fayette, Mirabeau, Pétion, Louvet, Roland, Brissot, Louis XVI, etc. – tous y passent, y compris les presque lampistes. Astuce suprême : le suspect n°1 est celui qui se prend pour Robespierre et qui, même, en descend peut-être, car Fred Vargas, à l’instar des plus atteints de ses prédécesseurs, fait de l’Incorruptible un impuissant qui sème des bâtards partout, n’ayant pas réussi à se décider entre les deux vices, duquel était le plus infamant.
Qu’est-ce qui a poussé un honnête – jusqu’à présent – auteur de romans policiers à se lancer dans cette bizarre entreprise ? On dirait qu’elle a commencé une histoire – le voyage en Islande – qu’elle n’a pas su comment la continuer, qu’à ce moment, l’actualité merdiatique (des particuliers se cotisant pour racheter des documents historiques d’importance nationale à la place de l’État français déficient) lui a donné l’idée – eurêka ! - de sauter à pieds joints dans une autre histoire, au prix de faire admettre par ses enquêteurs qu’ils se sont plantés et qu’ils ont tout faux – retour à la case départ – sans toutefois se résigner à flanquer à la poubelle ce qu’elle avait déjà écrit. Raccrocher ensuite les wagons des deux trains exigeait, c’est évident, quelque virtuosité dans la cabriole qui a fait défaut. Car essayer de fondre, en fin de parcours, deux histoires qui, déjà séparément, n’ont ni queue ni tête, est mission carrément impossible. Personne n’aurait pu la mener à bien. Personne d’ailleurs ne s’y est essayé. Si : Vargas.
Il est clair que l’(absence d’)intrigue policière n’est là que pour la frime et que le but réel de l’entreprise était de flinguer Robespierre, qu’il s’agit ici non pas même d’un règlement de comptes idéologiques qu’aurait pu assumer un honnête pamphlet osant dire son nom, mais d’un lynchage. On dirait du Michel Onfray, mâtiné de BHL.
C’en est. La dame est de la bande. On se rend compte alors – bon sang, mais c’est bien sûr ! – que Temps glaciaires est une caricature. À la Charlie. Avec Robespierre dans le rôle du Prophète et la guillotine en sautoir en guise de bombe dans le turban.
Seulement… un crobar de 580 pages, c’est un peu lourd à digérer.
Impossible de croire une seconde, même en y mettant du sien, à cette histoire-qui-n’en-est-pas-une, car la forme littéraire, outrée d’être ainsi utilisée comme faire-valoir, se venge. On doit relire plusieurs fois les mêmes passages pour essayer de s’y retrouver, d’avancer un peu… Quand Adamsberg retire de sa poche de poitrine, pour la sixième fois en quelques pages, une cigarette pliée fauchée à son fils, on fatigue. Et tout le reste est à l’avenant. Le dernier personnage intéressant imaginé par Vargas était un pigeon. Elle retente le coup avec, cette fois, un sanglier, qu’elle fait sauver, lui aussi, in extremis par sa fine équipe, mais c’est raté. Marc le sanglier couineur ne passe pas. Il n’arrive pas à exister.
Ceux qui ont lu quelques-uns des centaines de livres de tous bords consacrés au Conventionnel croiront reconnaître, dans les évocations fantasmées de Vargas, des copié-collé de Ratineau. Banzaï ! C’est lui qu’elle cite en tête de ses (très peu nombreuses) sources. Bref, le lynchage dont bénéficie actuellement Vladimir Poutine est pipi de sansonnet comparé à ce qu’il promet d’être dans deux siècles, pour peu qu’il suive les traces de Robespierre.
Pourquoi tant de haine ?
N’est-ce pas déjà la question qui se posait à propos des caricatures de naguère ?
Un des personnages de Vargas dit d’un autre « il est schizophrène ». Hélas, non. C’est l’auteur qui l’est. Comment cela se soigne-t-il ? De plus savants que moi le savent peut-être. Une chose dont je suis sûre, c’est que schizophrènes aussi sont ceux qui gavent de force le bon peuple à Dan Brown et à Vargas par matraquage commercial jusque dans les épiceries.
Bref, si vous tenez absolument à lire du Vargas, lisez des vieux.
Pauvre Ava Gardner si belle ! Finir comme ça…
Autres titres de cet auteur :
Série Commissaire Jean-Baptiste Adamsberg :
L’Homme aux cercles bleus, Hermé, 1991
L’Homme à l’envers, Viviane Hamy, 1999
Pars vite et reviens tard, Viviane Hamy, 2001
Sous les vents de Neptune, Viviane Hamy, 2004
Dans les bois éternels, Viviane Hamy, 2006
Un lieu incertain, Viviane Hamy, 2008
L’Armée furieuse, Viviane Hamy, 2011
Série Les Évangélistes
Debout les morts, Viviane Hamy, 1995
Un peu plus loin sur la droite, Viviane Hamy, 1996
Sans feu ni lieu, Viviane Hamy, 1997
Nicholas MEYER

M. Meyer se donne beaucoup de mal pour nous convaincre de l’existence de manuscrits inconnus du Dr. Watson et nous apprendre comment il se fait qu’ils soient demeurés cachés pendant si longtemps. Témoignage écrit de Watson… Témoignages écrits de ses héritiers… etc. C’est la seule partie un peu laborieuse de ses livres : quelques pages d’avant-propos qu’on peut parfaitement sauter.
Il nous offre ensuite trois aventures de Sherlock Holmes et Watson, qu’il aurait pu prétendre sorties de la plume de Conan Doyle sans que personne s’enhardisse à le contredire.
Il a la coquetterie, cependant, de mêler aux personnages littéraires, quelques personnages historiques, peut-être croisés dans la vie réelle par Doyle, qu’il met, lui, en présence de Holmes et Watson.
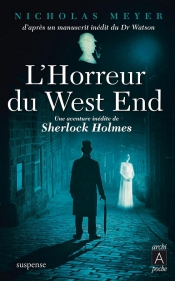
Nicholas MEYER
L’horreur du West End
Archipoche 2015
240 pages
À Londres, en mars 1895, des événements plus étranges les uns que les autres se succèdent : le critique théâtral Jonathan McCarthy est assassiné ; on intente un procès pour diffamation à la marquise de Queensberry ; une jeune ingénue est découverte la gorge tranchée ; enfin, un médecin de la police disparaît, emportant deux corps avec lui. Plusieurs personnalités influentes du milieu dramatique se trouvent impliquées : les auteurs d’opérettes à succès Gilbert & Sullivan, un écrivain-critique sans le sou et végétarien nommé George Bernard Shaw ; Ellen Terry, célèbre actrice admirée tant pour sa beauté que pour son talent ; un guichetier suspect du nom de Bram Stoker, qui se cache dans une mansarde pour écrire des choses bizarres ; le grand acteur Sir Henry Irving; un éditeur sans scrupule qui se fait appeler Frank Harris ; ainsi qu’un homme d’esprit, provocateur et controversé : Oscar Wilde.
Scotland Yard, dérouté, ne sait à quel saint se vouer. Pour Sherlock Holmes, c’est élémentaire : un maniaque rôde. Et son nom est Jack.
Contrairement à Fred Vargas, Meyer connaît admirablement et même intimement l’œuvre du personnage historique qu’il a choisi de ressusciter. Il n’est pas exagéré de parler d’identification. On pourrait presque dire d’osmose. Mais il ne s’en tient pas là, car le lecteur un peu averti s’aperçoit vite qu’il connaît aussi profondément la vie et l’œuvre des autres… ceux, contemporains de l’auteur, qu’il introduit dans le canon des aventures Watson-Holmes. Les esquisses de Shaw et Wilde pour être brèves, n’en sont pas moins frappantes. Ils ne font que passer, mais tout entiers.
Extrait. C’est évidemment Watson qui raconte :
Holmes resta un moment à contempler Wilde, le visage dépourvu de toute expression, puis se leva brusquement. Je l’imitai.
– Merci de nous avoir accordé votre temps, monsieur Wilde, dit-il. Vous êtes assurément une mine de renseignements.
Le poète leva les yeux vers lui. Il y avait quelque chose de si ingénu, de si plaisant dans son expression, que je me sentis charmé malgré tout ce qu’il venait de dire.
– Nous sommes ce que Dieu nous a faits, monsieur Holmes, et, pour beaucoup, pires que cela.
– Est-ce de vous ? demandai-je.
– Non, docteur…
Il eut un léger sourire.
– … Mais ce le sera.
Il se retourna vers le détective.
– Je crains de ne pas avoir gagné votre estime.
– Pas entièrement.
Wilde riva son regard dans celui du détective.
– Je le regrette… Profondément.
– Un jour peut-être, monsieur Wilde. » (p. 80)
Facile, quand on connaît la suite…

Nicholas MEYER
Sherlock Holmes et le Fantôme de l’Opéra
Archipoche, 2010
248 pages
1891. Alors que toute l'Angleterre le croit mort à Reichenbach, Sherlock Holmes, fin mélomane, vivote à Paris en donnant des cours de musique sous un nom d'emprunt. Apprenant que le prestigieux orchestre de l'Opéra recrute un violoniste, il parvient à se faire engager. Or, qui est le directeur de l’Opéra ? Un certain Gaston Leroux. Et Sherlock ne tarde pas à découvrir que le Palais Garnier abrite un fantôme qui lui donne du fil à retordre.
Ce ne sont pas des personnages historiques qui sont ici ranimés, ce sont des personnages littéraires non moins historiques : Christine Daaé, Raoul de Chagny, Mme Giry et le compositeur fantôme reprennent du service. Meyer, lui, s’amuse beaucoup à conjuguer deux auteurs mythiques
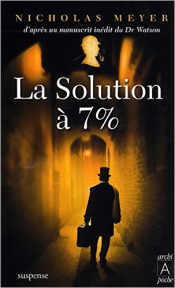
Nicholas MEYER
La solution à 7%
Archipoche 2014
300 pages
Un beau jour, l’agitation de Holmes, ses propos incohérents font redouter le pire à Watson : le détective s’est drogué au-delà de toute mesure. Sa vie est en danger. Avec le concours de Mycroft Holmes - le frère - Watson décide d’emmener Sherlock se faire soigner à Vienne par un certain Sigmund Freud, qui s’y connaît en drogues… Ils devront se faire aider par le Pr. Moriarty.
Ce « manuscrit retrouvé du Dr Watson », La Solution à 7 % (adapté au cinéma en 1976, avec Laurence Olivier dans le rôle de Freud) présente la théorie d’un « Napoléon du crime » inexistant, pur produit du cerveau drogué de Holmes, cause de sa névrose, et d’un Pr. Moriarty, bénin professeur de Sherlock et Mycroft enfants…
Dans La solution à 7%, l’auteur enrichit donc d’une autre enquête l’opus de Conan Doyle, et bien malin serait celui qui pourrait prouver qu’elle n’est pas de sa plume. Meyer y ajoute cependant sa marque en donnant à Holmes d’excellentes raisons de rencontrer un ou plusieurs de ses contemporains célèbres… qu’il s’agit de faire vivre de façon crédible sans altérer le caractère du personnage littéraire. Et ce n’est ici rien moins que Sigmund Freud.
La « trouvaille » de Meyer, c’est que Moriarty… n’existe pas. Ou plutôt qu’il existe mais n’est autre qu’un paisible enseignant que les deux frères Holmes ont eu pour prof de maths dans leur enfance. C’est la cocaïne, que Sherlock s’injecte à la dose mortelle de solution à 7% et dont il est devenu dépendant, qui fait de leur ancien tuteur « le Napoléon du crime » (pléonasme s’il en fut).
Sur les traces de son implacable ennemi, à qui on a demandé son aide pour l’amener jusque là, Holmes arrive à Vienne, où l’attend un jeune médecin, lui-même ex-cocaïnomane, qui l’admire et a accepté de le soigner.
Mais la psychanalyse mise en roman se double évidemment d’une véritable enquête de Sherlock, le cahier des charges l’exige, et M. Meyer de plonger son lecteur dans une sombre histoire austro-allemande, avec secret de famille à implications politiques, détournement d’héritage, enlèvement, séquestration à rebondissements et haletante course-poursuite entre deux trains (sur la même voie !) dans la plus pure tradition 1900, Holmes et Freud pelletant à tour de bras le charbon dans la locomotive, à la suite de quoi Holmes prédira la Grande Guerre mais ne pourra l’éviter, car à l’impossible nul n’est tenu et même les plus fiers génies parfois…
Extrait (Watson encore, comme il se doit) :
– Je vais vous dire ce que j’aimerais, dit enfin le docteur Freud en posant son cigare et en regardant Holmes droit dans les yeux. J’aimerais vous hypnotiser une fois de plus.
Je n’avais aucune idée de ce qu’il souhaitait demander (j’avais plus ou moins cru qu’il repousserait entièrement la proposition de Holmes), mais je ne m’attendais certes pas à cela. Non plus que Holmes, qui cligna des yeux sous l’effet de la surprise et qui toussota avant de répondre :
– Vous souhaitez m’hypnotiser ? Dans quel but ?
Freud haussa les épaules et continua de le regarder avec un sourire tranquille :
– Vous venez de parler de l’affliction humaine, dit-il. J’avoue que c’est pour moi un sujet d’intérêt primordial. Et comme on a remarqué que la meilleure façon d’étudier l’humanité consiste à étudier l’homme, j’ai pensé que vous m’autoriseriez peut-être à examiner une fois encore votre cerveau.
Holmes réfléchit un instant à cette requête.
– Très bien. Je suis à votre disposition.
– Voulez-vous que je sorte ? demandai-je en me levant, prêt à quitter la pièce si Freud estimait que ma présence risquait d’entraver le déroulement de l’expérience.
– Je préférerais que vous restiez, dit-il en allant fermer les rideaux, puis en sortant sa chaîne de montre.
Il était plus facile d’hypnotiser le détective à présent que par le passé où nous avions placé nos derniers espoirs dans le système de Freud pour l’amener à se délivrer de la cocaïne. Maintenant que des rapports normaux s’étaient établis entre eux, il n’y avait plus rien pour troubler leur esprit, plus rien pour nous presser. Holmes ferma les yeux en moins de trois minutes et resta immobile en attendant les instructions du docteur Freud.
– Je vais vous poser des questions, déclara celui-ci d’une voix basse et douce, et vous y répondrez. Quand nous aurons terminé, je ferai claquer mes doigts et vous vous réveillerez. À ce moment-là, vous ne vous rappellerez rien de ce qui s’est passé pendant que vous dormiez. Vous comprenez ?
– Parfaitement.
– Très bien. (Freud respira profondément.) À quand remonte votre première prise de cocaïne ?
– À l’âge de vingt ans.
– Où l’avez-vous fait ?
– À l’université.
– Pourquoi ?
– Parce que j’étais malheureux.
– Pourquoi êtes-vous devenu détective ?
– Pour punir les méchants et m’assurer que justice était faite.
– Avez-vous été témoin d’une injustice ?
Il y eut un silence.
– Avez-vous été témoin d’une injustice ? répéta Freud en humectant ses lèvres avec sa langue et en me jetant un rapide coup d’œil.
– Oui.
Je m’étais rassi et j’écoutais cette conversation avec une fascination et une attention extrêmes, les mains posées sur les genoux, le buste penché en avant pour ne rien perdre des réponses faites d’une voix faible.
– Avez-vous personnellement connu la méchanceté ?
– Oui.
– En quoi consistait cette méchanceté ?
À nouveau, le sujet de l’interrogatoire hésita et, à nouveau, il fut encouragé à répondre.
– En quoi consistai(t cette méchanceté ?
– Ma mère trompait mon père.
– Elle avait un amant ?
– Oui.
– Et en quoi consistait l’injustice ?
– Mon père l’a tuée.
Sigmund Freud sursauta et se redressa ; un instant, son regard égaré parcourut la pièce ; il était tout aussi bouleversé que moi qui avais automatiquement réagi en me mettant debout, puis m’étais pétrifié, les membres paralysés, bien que mes yeux et mes oreilles continuassent à fonctionner. Freud se remit cependant plus vite que moi et se pencha de nouveau vers Holmes.
– Votre père a assassiné votre mère ?
– Oui.
La voix refoula un sanglot qui me fendit le cœur. Freud insista, mais ses yeux s’étaient mis à ciller.
– Et son amant ? demanda-t-il.
– Oui.
Freud marqua une pause afin de se ressaisir avant de poursuivre.
– Qui était…
Je lui coupai la parole :
– Docteur !
Il me regarda.
– Qu’y a-t-il ?
– Ne le… ne lui demandez pas de révéler le nom de cet homme, je vous en supplie. Cela n’a désormais plus de sens pour quiconque.
Freud hésita un instant, puis il hocha la tête.
– Merci.
À nouveau, il hocha la tête, puis il reporta son attention sur Holmes qui était resté assis là, immobile, les yeux fermés, pendant toute la durée de cette digression. Seule l’apparition de gouttes de transpiration sur son front indiquait son tourment intérieur.
– Dites-moi, reprit Freud, comment avez-vous appris ce que votre père avait fait ?
– Mon tuteur m’en a informé.
– Le professeur Moriarty ?
– Oui.
– Je vois. (Freud sortit sa chaîne de montre, la regarda un instant fixement, puis la remit en place.) Très bien, dormez maintenant, Herr Holmes. Dormez. Dormez. Je vous réveillerai dans un moment et vous ne vous rappellerez rien, rien de cet interrogatoire. Avez-vous compris ?
– Je vous ai déjà dit que oui.
Très bien. Dormez maintenant.
Après avoir surveillé Holmes et s’être assuré qu’il ne bougeait pas, Freud à nouveau se leva, traversa la pièce et attira un siège près du mien. Son regard était encore plus triste que d’habitude. Il ne dit rien pendant qu’il coupait, puis allumait, un autre cigare. Je m’étais quant à moi rencogné dans mon fauteuil car j’avais reçu un tel choc que la tête me tournait et mes oreilles bourdonnaient.
– Un homme ne s’adonne pas aux stupéfiants sous prétexte que c’est la mode ou qu’il aime ça, déclara-t-il enfin en plissant les yeux pour me regarder à travers la fumée de son cigare. Souvenez-vous : je vous ai un jour demandé si vous saviez comment il en était venu à user de la cocaïne et, non content d’être incapable de me fournir une réponse, vous n’avez pas compris l’importance de ma question. Pourtant, dès le début, j’ai compris que quelque chose avait provoqué cette dangereuse manie.
– Mais… (Je tournai les yeux vers Holmes.)… auriez-vous pu imaginer… ?
– Non, certes pas. Je n’aurais jamais pu imaginer ce que nous venons d’entendre. Cependant, comme il le ferait lui-même remarquer, voyez tous ce que ces faits expliquent. Maintenant, nous connaissons l’origine de sa toxicomanie et la raison pour laquelle il a choisi sa profession ; nous savons d’où vient son antipathie pour les femmes et la difficulté qu’il a de communiquer avec elles. Cela explique en outre son aversion pour Moriarty. Comme les messagers perses qui, jadis, apportaient les mauvaises nouvelles, Moriarty est puni pour son rôle dans cette affaire, bien que ce rôle paraisse avoir été insignifiant. Dans l’esprit de votre ami, sous l’influence enivrante de la cocaïne, Moriarty devient un participant à cette liaison illicite, et coupable par association. Non seulement coupable (là, il se pencha en avant et brandit son cigare pour souligner ses paroles), mais suprêmement coupable ! Ne disposant pas d’un véritable bouc émissaire sur qui décharger sa douleur, Herr Holmes attribue le forfait à l’homme qui l’a révélé. Bien sûr, il enfouit toutes ces conclusions dans le plus profond de son âme – dans une zone que j’ai, pour le moment, appelée « inconscient » – sans jamais s’avouer à lui-même ces pensées, qu’il extériorise néanmoins par le choix de sa profession, par son indifférence envers les femmes (que vous avez si bien relatée, docteur !) et, finalement, par ses recours à la drogue sous l’influence de laquelle ses sentiments profonds et véritables sur le sujet sont enfin révélés.
En moins de temps qu’il ne faut pour le rapporter, je compris la justesse stupéfiante de l’affirmation de Freud. Son raisonnement expliquait également le comportement tout aussi excentrique de Mycroft Holmes, qui se retirait du monde en un lieu où même la parole était interdite, et le fait que les deux frères s’étaient définitivement voués au célibat. De toute évidence, le professeur Moriarty avait, dans cette affaire, joué un rôle plus important que celui que lui attribuait Holmes (ce qui expliquait que Mycroft Holmes eût prise sur lui), mais je savais que, dans l’ensemble, le docteur Freud avait raison.
– Vous êtes le plus grand de tous les détectives.
Ce fut tout ce que je trouvai à lui dire.
– Je ne suis pas un détective, dit Freud en secouant la tête et en souriant de son air sage et triste. Je suis un médecin spécialiste des esprits tourmentés.
Je songeai qu’il n’y avait pas beaucoup de différence.
– Et que pourrons-nous faire pour mon ami ?
Il soupira et à nouveau secoua la tête :
– Rien.
– Rien ?
J’étais abasourdi. M’avait-il fait parcourir tout ce chemin pour refuser d’aller plus loin ?
– Rien. Je ne sais comment atteindre ces sentiments autrement que par le moyen maladroit et inefficace de l’hypnose.
Je protestai en le saisissant par la manche.
– Pourquoi dites-vous qui’il est inefficace ? Il est sûr que…
– Parce que, dans le cas présent, le malade à l’état conscient ne voudrait pas – ne pourrait pas – accepter le témoignage fourni sous hypnose. Il refuserait de me croire. Il refuserait de nous croire. Il nous accuserait de mentir.
– Mais…
– Voyons, Docteur. Si vous n’aviez pas été là et si vous ne l’aviez pas entendu de vos propres oreilles, est-ce que vous l’auriez cru ?
Je lui avouai que je ne l’aurais pas cru.
– Eh bien, tout le problème est là. De toute façon, il n’est guère probable qu’il accepterait de rester ici le temps qu’il nous faudrait pour nous frayer, autrement, un chemin jusqu’au tréfonds de son être.
Nous discutâmes ainsi pendant plusieurs minutes mais, dès l’abord, je savais qu’il avait raison. Quels que fussent les procédés qui permettraient de secourir Holmes, ils n’avaient pas encore été inventés.
– Prenez courage, m’enjoignit Freud. Après tout, votre ami est un être humain qui accomplit de nobles tâches et les accomplit à merveille. Son malheur ne l’empêche pas de réussir et même d’être aimé.
- Un jour, peut-être, la science parviendra-t-elle à pénétrer les mystères de l’esprit humain, conclut-il, et quand ce jour viendra, je ne doute point que Sherlock Holmes aura contribué à le faire arriver – même si son propre esprit n’est jamais soulagé de son fardeau terrible.» (pp. 257-263).
Mis en ligne le 18 octobre 2016.
14:35 Écrit par Theroigne dans Actualité, Général, Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |















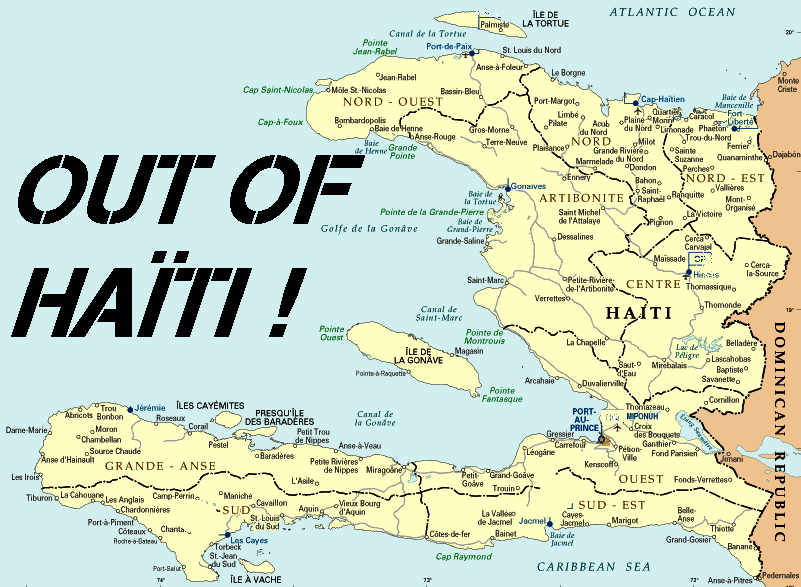







Commentaires
Pauvre polars, historiques, idéologiques ou autres....
Cher Theroigne, je vous invite à créer le polar félin. Je suppose que vous en connaissez déjà un bout, sinon je vous inviterais à visiter notre petite communauté miaulante, pour approfondir le sujet (ici, ce sont de vrais sauvages, mais je crains qu'ils soient pareils partout).
Il y avait bien eu des romans anglais à intrigues 'Le chat qui...", etc. Très british campagnard et bobo combinés.
"Le ... qui...": voilà un bon plan pour un éditeur (voir Jonas Jonasson, qui n'est que du sous Arto Paasilinna, à enfiler des choses invraisemblables les unes derrière les autres).
Les séries en abécédaire (a comme ceci, b comme cela, c comme cadavre, etc), c'est déjà pris.
C'est distrayant, tout ça, mais ça ne vaut pas les discours de Robespierre, ni les textes, parfois inégaux, ou vieillis, de Chandler ou Hammet. Je remercie la vieille copine qui m'a permis de découvrir tout cela, puis d'en juger à ma manière. Remercie aussi le vieux copain qui m'a fait découvrir Schopenhauer (pas triste non plus, celui-là) et les Simonin.
Quant aux suites, amplifications, etc de Sherlock Holmes, c'est souvent très érudit, et parfaitement illisible!
Je ne suis peut-être pas à la hauteur de votre blog!
Écrit par : devine! | 18/10/2016
Cher(e?) Devine,
Que répondre à votre commentaire ?
Plutôt que la vieille copine ou le vieux copain, pourquoi ne pas consulter vos nombreux chats ?
Ce sont des créatures d'excellent conseil. En matière de lecture en tout cas.
En matière d'écriture aussi, mais moins.
Écrit par : Theroigne | 19/10/2016
Les commentaires sont fermés.