23/09/2010
Ces pauvres gueux pleins de bonadventures
Ces pauvres gueux pleins de bonadventures
Ne portent rien que des choses futures.
J’aimerais à présent vous parler d’un livre. Il ne vient pas de sortir, ceci n’est pas une promotion. Vous aurez même, si vous le cherchez, du mal à le trouver. Car il est épuisé chez l’éditeur français et ceux qui ont la chance de le posséder ne semblent pas vouloir s’en séparer. R.A.S. même sur Internet. Inconnu aussi dans la plupart des bibliothèques publiques. Sauf une. Il m’a fallu, pour l’emprunter, faire le voyage jusqu’au village le plus proche où passe le bibliobus de ma province. Chic !... c’est justement un livre de voyage. Mais commençons par l’auteur. Il est anglais et s’appelle Jason GOODWIN. Ne voilà-t-il pas un nom prédestiné, pour un voyageur ! Il circule actuellement de lui quelques polars en édition de poche, dont Istanboul au XIXe siècle est le théâtre et dont un eunuque est le détective. Je vous en reparlerai plus loin s’il me reste de la place et à vous de la curiosité.
Mais commençons par l’auteur. Il est anglais et s’appelle Jason GOODWIN. Ne voilà-t-il pas un nom prédestiné, pour un voyageur ! Il circule actuellement de lui quelques polars en édition de poche, dont Istanboul au XIXe siècle est le théâtre et dont un eunuque est le détective. Je vous en reparlerai plus loin s’il me reste de la place et à vous de la curiosité.
Adonc le Jason anglais du XXIe siècle, né en 1964 (2e moitié du XXe) est tombé sous le charme d’Istanboul en étudiant, à l’Université de Cambridge, l’Histoire de Byzance.
Byzance... ancienne capitale de la Thrace (l’autre Jason y est passé en allant chercher la Toison d’Or et sa Médée en Colchide), d’abord cité grecque, puis romaine, rebaptisée Constantinople en 330 par l’inénarrable Constantin et sa digne (de lui) mère Hélène (sainte pour les cathos), elle est devenue Istanboul le 29 mai 1453, à l’occasion de sa conquête par les Turcs ottomans. Toujours à cheval sur le Bosphore – un pied en Europe, un pied en Asie - elle est aujourd’hui la capitale de la Turquie.
Le premier voyage de notre auteur, pourtant, ne l’emmènera pas là, mais en Inde et en Chine, sur les traces du thé. Il en tirera, en 1988, un livre que les scribes de chez Phébus (qui ne l’ont pas publié !) qualifient de « promenade érudite et humoresque à travers l’Inde et la Chine ». C’est The Gunpowder Gardens : Travels in China and in India in Search of Tea.
Après le succès de ce premier livre, qui lui a valu le Prix du Meilleur Jeune écrivain, il se décide – on est au printemps de 1990 – à donner corps à son rêve : partir à la découverte d’Istanbul. Mais il le fera sur les traces du grand écrivain-marcheur Patrick Leigh Fermor, dont il a lu le mythique Temps des offrandes (A Time of Gifts). Ce voyage à pied, cinquante -sept ans après l'autre, en compagnie de celle qui a déjà refusé trois fois de l’épouser, il va le faire de Dantzig au Bosphore, à travers l’Europe de l’Est, peu après la chute du mur de Berlin. Car, outre la ville de ses rêves, il veut encore voir ce qui reste, dans cette Europe des confins, de la longue présence ottomane, après une deuxième guerre mondiale et une contre-révolution victorieuse à l’échelle d’un continent. Il en rapportera ce livre : On foot to Golden Horn. En français : Chemins de traverse. Lentement, à pied, de la Baltique au Bosphore, qui lui vaut, en 1993, un autre prix littéraire et la traduction en plusieurs langues, dont la nôtre.
Espérant que l’auteur et l’éditeur me pardonneront un emprunt qui ne peut leur porter préjudice, je vous en propose un extrait. Nous sommes en Transylvanie, patrie bien connue des vampires, peu après l’exécution de Nicolau et d’Elena Ceaucescu. Ion Iliescu assure l’interrègne et a bien l’intention d’être le successeur du Conducator défunt. Ceux qui n’ont pas la mémoire trop courte se rappelleront qu’il y eut en Roumanie, en ce mois de mai 1990, du sang tiré autrement que par succion.

Déjeunant une fois de plus au Transylvania, nous partageâmes notre table avec un jeune Hongrois qui, pour son anniversaire, sortait sa petite amie. Tous deux parlaient parfaitement l’anglais.
Il travaillait comme ambulancier, bien que son ambition fût de devenir dentiste. Avant toute chose, il était capital qu’il se rendît en Hongrie pour récupérer un tableau de famille qui lui rapporterait beaucoup d’argent.
— C’est impossible de prendre ses dispositions d’ici, expliqua-t-il. La Transylvanie n’est pas une bonne adresse pour traiter avec l’Ouest.
— Non, reconnus-je. Tout le monde penserait à Dracula !
Notre nouvel ami fixa le fond de son verre, puis détourna le regard.
— Excusez-moi, dit-il avec un petit rire solennel, mais, en réalité, je suis... ah ! au village, c’est ce qu’on dit... un vampire. J’ai la marque.
Il leva le menton et montra sur son cou blanc une tache grosse comme une prune de la couleur du sang séché.
— Il y a aussi d’autres signes, ajouta-t-il avec un rire bref, couvrant sa bouche de sa main.
Sa petite amie hocha la tête.
— Mes parents n’aiment pas ça, renchérit-elle. On dit strigoi... c’est... comment dites-vous... vampire ?
Et elle mima un coup de griffe au-dessus de la table.
Nous organisâmes leur passage à l’Ouest avec des gars charitables du Yorkshire de notre connaissance qui se préparaient à ramener en Angleterre leur camion de secours vide. Nous n’entendîmes plus reparler du couple. Ambulancier. Dentiste. Je me sens bizarrement responsable. Enfermé derrière le rideau de fer pendant cinquante ans, parodié dans les films d’horreur, le comte Dracula peut désormais aller et venir librement, et même se rendre à Whitby, si ça lui chante...
Créée au XVIIIe siècle par un ministre des Habsbourg, la bibliothèque Teleky du centre ville représentait tout ce qui nous avait manqué : pouvoir humer de vieilles reliures et fourrer notre nez dans des textes anciens, dans la longue et frâche salle de lecture voûtée, avec sa galerie et ses hautes vitrines de livres.
En fouillant pour trouver des cartes, nous fîmes la connaissance de Milhály Spielmann, le bibliothécaire en chef. En tant qu’intellectuel roumain d’origine juive hongroise, il était trois fois minoritaire. Deux fois si l’on admettait que juif et intellectuel étaient, en pratique, synonymes en Europe orientale.
Milhály nous avait emmenés nous asseoir sur un banc, sous un arbre au milieu de la cour, plus par habitude, je pense, que par prudence. On y était à l’abri des oreilles indiscrètes ; il était difficile de s’approcher sans être vu.
— Ce qui me contrarie, c’est l’idée que Petru Roman soit juif, déclara-t-il.
— Le premier ministre ?
— Roman, pour l’amour de Dieu ! On n’a pas un nom comme celui-là par hasard. C’est son grand-père qui a dû le changer. Dans les années 30, beaucoup de Juifs voulaient paraître plus roumains que les Roumains. Roman, comme patronyme, est aussi juif que le mien.
— Vous n’aimez pas avoir un premier ministre juif...
— Parce qu’une gaffe... et il n’est plus ministre d’Iliescu. C’est le Juif !
Un soir, Milhály nous invita chez lui et nous parlâmes des Tsiganes. Depuis Cluj, les gens avaient fait de leur mieux pour nous mettre en garde contre les villages tsiganes, sur la route entre Tirgu-Mures et Segesvár. Si nous devions disparaître, c’était là. (Beaucoup plus tard, nous découvrîmes que nos parents croyaient vraiment que nous avions disparu en Roumanie : il y eut des séries de coups de téléphone angoissés, des démarches à un haut niveau auprès du Foreign Office et – pour des raisons que je n’ai jamais bien comprises ! – un diplomate suédois fut associé aux recherches. On envisagea même une mission de sauvetage... avant que nous ne gâchions tout en téléphonant de Bulgarie.) Seul Milhály était entièrement certain que nos inquiétudes étaient hors de propos.
La peur des bohémiens, fit-il observer, était un préjugé entretenu par les autorités. Ceaucescu lui-même avait prétendu que les Tsiganes n’existaient pas : le résultat, c’est que personne ne savait combien d’entre eux vivaient en Roumanie. Certaines estimations donnaient le chiffre de quatre millions, soit un cinquième de la population roumaine.
Pour un peuple qui avait toujours esquivé les ingérences et les règlements imposés d’en haut, leur exclusion des archives officielles était une ironie du sort. La dernière chose qu’ils voulaient, d’après Milhály, c’était être mis en carte, en rangs et commandés. Ils pensaient que le monde « normal » de la bureaucratie et du gouvernement transformait les hommes en pantins, et s’efforçaient d’y échapper. Ce qui ne faisait pas nécessairement d’eux des coupe-jarrets.
— La majorité des gens échangeraient certaines de leurs libertés contre la sécurité, poursuivit Milhály. Dans cette partie de l’Europe, c’est une vieille tradition. L’empire des Habsbourg est un exemple extrême du contrôle bureaucratique. Les Tsiganes qui vivaient aussi dans cet empire, incarnaient l’excès inverse. Aux yeux de beaucoup, ils ont l’air oisifs. C’est plus facile de croire qu’ils survivent en volant et en fraudant que de chercher à voir ce qu’il en est réellement...
Milhály avait fait une découverte.
— Les Tsiganes travaillent tout le temps. Ils traînent dans les rues pour troquer des informations, échanger des renseignements. Voyez-vous des ordures et des détritus dans la rue ? Ce sont les Tsiganes, ces prétendus fainéants, qui ramassent les vieux journaux, les tickets, les emballages...
Il prit un livre. Nous étions chez lui à présent, dans une pièce encombrée de livres.
— Savez-vous comment il est possible d’acheter ceci ? Parce que les Tsiganes rapportent tout le papier dans les usines de papeterie. Personne d’autre ne penserait à s’en charger, car cela prendrait trop de temps. Mais les Tsiganes, eux, insèrent cela dans leur activité normale. Il recyclent tout.
« Les Tsiganes sont les seuls commerçants et artisans de ce pays. Dans un village tsigane, le forgeron fabriquera des bijoux et sa femme des vêtements. Et leurs enfants trieront les chiffons, le caoutchouc, le verre et le papier. L’un d’eux va à la ville vendre leur production. En réglant ses affaires, il tend l’oreille pour connaître les besoins des autres. Ce qu’on appelle l’économie roumaine – aciéries, construction navale, industrie minière, etc. -, c’est de la foutaise. L’économie réelle tourne grâce aux Tsiganes.
« Au fil des ans, les Tsiganes ont mis au point des moyens d’éviter la main de fer que les autorités font peser sur la majorité. En se tenant à l’écart de notre monde de « rouages », ils échappent à toute prévision. Le gouvernement n’a pour ainsi dire aucune prise sur eux. Ils brûlent les maisons qu’on leur attribue. Ils se servent de dix noms différents. En retour, la police les jette en prison au moindre prétexte. Les prisons sont encombrées de bohémiens pour la plupart innocents. Leur présence en ce lieu renforce le mythe.
Mais malgré la finesse de toutes ses observations, Milhály n’avait pas remarqué que les Tsiganes portaient leur costume traditionnel.
— Ils sont habillés normalement, aujourd’hui. L’ancien costume est réservé aux fêtes et aux rassemblements, nous assura-t-il, alors que sous notre nez, les Tsiganes arboraient quotidiennement les motifs et les coloris chatoyants de l’Orient, des jupes, des corselets, des gilets et des chapeaux taillés sur des modèles d’un autre siècle.
Des chapelets de saucissons pendaient des étagères de la bibliothèque : comme tous les Hongrois que nous avions rencontrés, Milhály tuait son cochon chaque année et confectionnait pâtés, saucissons, graisse fumée et porc salé en pleine ville.
À neuf heures, ses enfants entrèrent pour regarder Das Erbe Von Gulenbergs à la télévision : une saga allemande tentaculaire mettant en scène une famille de brasseurs de bière et focalisée sur les voitures que conduisaient les protagonistes pour se rendre à leurs somptueuses résidences ou aux batailles de salles de conseil d’administration.
— Le programme national de la Roumanie, commenta Milhály. Voilà la vie que nous concocte notre président...
Et, sur cette indispensable ironie, ayant dit ce qu’il avait sur le coeur, il s’installa pour suivre la série aussi passionnément que ses enfants.
Deux mois auparavant, à Tirgu-Mures, des affrontements avaient opposé Roumains et Hongrois. Même si nous en avions entendu parler en Pologne – Andrzej alléguait que c’était une raison pour éviter la Roumanie ! -, nous rencontrions à présent des témoins de première main. Nul ne croyait que ces événements s’étaient produits spontanément.
Un écrivain de Budapest, Erno Suto, devait prendre la parole devant le parti parlementaire hongrois, dans un bâtiment que celui-ci partageait avec divers partis d’opposition roumains. Une foule d’agriculteurs roumains, armés de fourches et de faux, prirent le bâtiment d’assaut. Suto et les autres se barricadèrent dans les combles en coinçant un réservoir d’eau en travers de l’escalier, obligeant les attaquants à entrer un par un.
Au bout de deux heures, un escadron de l’armée arriva pour proposer des sauf-counduits aux Hongrois assiégés, et les défenseurs commencèrent à sortir. En chemin, ils furent bousculés et reçurent des coups de pied. Ils montèrent dans un camion fermé par une bâche tendue sur des cerceaux d’acier. Une fois la plupart d’entre eux à bord, la bâche s’envola comme une voile dans un typhon. Les Hongrois furent tirés à bas du camion par la populace et sauvagement rossés. Suto lui-même perdit un oeil. La bibliothèque Teleky fut attaquée, mais ses grilles anciennes se révélèrent imprenables.
Plusieurs questions demeurèrent sans réponse. Apparemment, les Roumains étaient persuadés que la réunion devait se clore sur une déclaration d’indépendance de la Transylvanie et coïncider avec une invasion militaire hongroise. D’autre part, à un moment où le fuel et les moyens de transport étaient rares, un nombre étonnant de paysans avaient débarqué en ville en même temps. Enfin, la milice était arrivée sur les lieux des heures après que le bâtiment eût été pris d’assaut. Par conséquent, l’opération entière avait été préméditée.
Le jour suivant, une manifestation hongroise se heurta dans l’avenue à une foule roumaine armée d’outils agricoles. Un maigre cordon de troupes fut déployé au milieu. Comme la tension montait, les Hongrois renvoyèrent les femmes et les enfants à la maison. Les Roumains les conspuaient aux cris de « Nous les maîtres ! Vous les squatters ! » et scandaient «Vatra ! Vatra ! », ce qui veut dire la «terre des ancêtres».
Après les insultes, les jets de pierre. Des combats au corps à corps éclatèrent dans l’après-midi. Un camion surgit à toute allure dans l’avenue du côté roumain, et la troupe fléchit avant de reculer. Les échauffourées étaient vives, la rue jonchée de blessés et de morts.
Vers six heures, une bande d’hommes apparut dans le jour déclinant. Ils portaient des gilets et des chapeaux noirs, et débouchèrent d’une rue latérale dans l’avenue. Les combattants les regardèrent avec incertitude. Personne ne savait ce que pensaient les Tsiganes.
— Ne vous en faites pas, Hongrois ! clamèrent-ils. C’est nous, les Gitans !
Leur attaque fut brutale. Les Roumains qui remontaient dans leurs cars en chancelant virent ceux-ci incendiés : quand ils tentaient de ressauter à terre, ils se faisaient tabasser. Les couteaux étaient sortis, ainsi que les fourches et les fléaux, jusqu’à la tombée de la nuit ils piquèrent et cognèrent tandis que couraient des ombres à la lueur tremblotante des autocars en feu.
Dans leurs casernes, les troupes attendaient un ordre qui ne vint jamais.
Jason GOODWIN
Chemins de traverse. Lentement, à pied, de la Baltique au Bosphore
Oh, et puis, au diable l’avarice, en voici un autre :

Le ciel matinal était froissé comme un lit défait. Derrière la bibliothèque Teleky, des tours encrassées avançaient de front avec nous, puis disparurent brusquement sur le côté, tandis que commençait la campagne. Une cinquantaine de voitures faisaient la queue le long de l’accotement pour prendre de l’essence.
Une heure après, un chien nous attaquait.
Kate l’avait repéré à un bon demi-kilomètre de distance, là où les arbres butaient sur un champ en pente, près d’une petite construction grillagée ressemblant à un transformateur électrique.. Le bruit des aboiements ne voulait rien dire : on nous avait aboyé après à travers la moitié de l’Europe. Les chiens étaient toujours attachés.
— Il vient vers nous, dit soudain Kate.
— Je me retournai. Un petit point blanchâtre dévalait le coteau. Mais il était encore très loin.
— Il chasse les lapins, affirmai-je.
— Je ne crois pas.
— Kate se mit à presser le pas. On distinguait presque le chien; il arrivait à fond de train.
— D’accord, il n’y a qu’à continuer à marcher, dis-je de manière superfétatoire. Tentons d’atteindre les arbres.
La forêt commençait deux cent mètres plus loin. Ici, on était à découvert, avec un fossé de chaque côté. Les champs étaient vides, la route déserte depuis une heure. Le chien décrivait une courbe à travers le champ le plus proche de nous. Il aboyait à pleine gorge.
Jusqu’au moment où le chien sauta le fossé et où j’entendis ses ongles griffer le goudron, je n’avais pas pris sa menace au sérieux. C’était le chien le plus laid et le plus féroce que j’avais jamais vu. Un poil jaunâtre hérissait son échine. Son cou massif s’effilait vers une gueule pleine de crocs et des yeux fauves qui louchaient. L’animal étendit ses antérieurs sur le sol et raidit son arrière-train, pendant que nous reculions sur la route. Je brandis ma canne et criai :
— Bas les pattes ! Bas les pattes !
Les babines du chien se retroussèrent avec un son qui évoquait une scie attaquant du bois dur.
— Pas bouger !
Le chien agita la tête et aboya en même temps. Son aboiement se termina par un bruit d’eau aspiré par une bonde. De la bave gargouilla à travers ses crocs.
Très lentement, nous battîmes en retraite vers les arbres. Le chien tour à tour grondait, montrait ses dents, découvrait ses gencives noires et baissait la tête, pendant que nous mettions deux mètres de plus entre lui et nous, et puis il faisait un écart dans notre direction. Parfois, il se ruait en avant et s’immobilisait, les yeux à deux centimètres du bout de ma canne, les babines rabattues.
Le seul conseil que je connaisse à propos de chiens sort d’un livre consacré aux cyclistes. À mon sens, un cycliste, même effrayé, doit battre un chien à la course ! Il y avait plein de choses qu’on pouvait faire si le chien était très petit. Sinon, il fallait viser pour lui planter la pompe à vélo dans la gueule et l’étouffer jusqu’à ce que mort s’ensuive. Quand on n’avait pas de pompe, lisait-on dans ce livre, on pouvait se servir de son bras. Cela me paraissait à présent un moyen rapide de perdre mon bras. Si le chien bondissait, j’étais évidemment prêt à lui ficher ma canne dans la gueule. Mais il semblait y avoir peu de chances pour qu’il jouât correctement son rôle et bondît sur sa pointe, les mâchoires ouvertes. Il déboulerait probablement en faisant un crochet, puis attaquerait de côté. Une fois hors de portée de ma canne, il était bien mieux armé que nous. La canne serait inutile. Déjà, il devenait plus hardi. Il chercha soudain à mordre le bout de ma canne, et ses crocs cliquetèrent quand j’écartai celle-ci. Trop loin. Maintenant, il allait bondir.
Je ramenai la canne devant ses yeux en tremblant un peu. Une autre pensée m’avait traversé l’esprit. Si on se faisait mordre (seulement mordre!), il nous faudrait le vaccin antirabique. On nous avait conseillé d’emporter un stock d’aiguilles pour ne pas risquer de contracter le sida dans un hôpital roumain. Naturellement, on ne s’était pas donné cette peine.
— Arrière, espèce de salaud !
Voix trop tendue.
Avec des gestes précautionneux, nous détachâmes nos sacs à dos afin de les utiliser comme boucliers.
Et, à ce moment-là, grincement d’un changement de vitesse, puis bruit de moteur. Je priai : Écrase-le.
Un autocar penché surgit des arbres. Le chien était en plein milieu de la route.
— Au secours ! criâmes-nous, à l’instant précis où l’autocar nous dépassait à vive allure.
D’un bond, le chien avait regagné le bas-côté opposé. Le car s’éloigna. Une voiture suivit. Nous tentâmes des gestes désespérés mais elle ne s’arrêta pas davantage.
— Fuyons !
La voiture qui passait nous couvrit momentanément. Nous courions à toute vitesse sur la route, la nuque en feu. Arrivé aux arbres, je me retournai vivement avec ma canne.
Trente mètres plus haut, le chien flairait quelque chose dans le fossé.
Là où la route se recourbait pour escalader la colline, il y avait, chose improbable entre toutes, un hôtel qui servait de café. Nos genoux tremblants s’entrechoquaient encore tandis que nous nous shootions à coups de cigarettes. Un tsigane nous adressa un clin d’oeil. Un autre entra et s’attabla avec lui. Un gros homme aux petits yeux porcins se plaignit au patron et ce dernier demanda aux tsiganes de sortir.
En entreprenant l’ascension de la colline, nous chancelions; à deux reprises, nous nous retournâmes. Coupant à travers champs pour éviter un virage en zigzag, nous remplîmes nos mains de pierres. Aucun chien ne montra son nez. Nous fîmes halte à l’ombre d’un arbre noueux, au sommet de la crête, et un cheval sans cavalier passa sur la route au petit galop. En bas s’étendait une large vallée, dont le fond formait un capiton de champs ensemencés et de petits hameaux, éparpillés comme des villes miniatures dans une plaine à échelle réduite.
Le père Barna, notre hôte à Segesvár, avait sa théorie sur le chien.
— Quand vous marcher, demanda-t-il, comment vous habiller ?
— Ma foi, heu... comme ça.
— Ouais. En noir. Et chapeau, ajouta-t-il avec beaucoup d’insistance ?
— Mon chapeau ?
— Chapeau de gitan, non ? Haha !
— Mais le chien était enragé.
— Enragé parce que déteste Gitans. Les Gitans, braves gens, mais...
Il haussa les épaules avec un sourire.
Barna avait sans doute raison : le chien avait été dressé à chasser les Gitans. On lui raconta donc une autre histoire sur ce chapeau.
Idem

Et la Roumanie sous le Grand Turc...
*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LIVRES
Ceux du maître : Patrick Leigh Fermor
Les violons de Saint Jacques, conte antillais (sa seule oeuvre de fiction).
Paris, Albin Michel, 1956. Gallimard, coll. Le Promeneur, 1992

Roumeli : Travels in Northern Greece, Penguin, 1966
Apparemment non traduit en français.
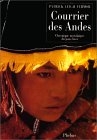
Courrier des Andes : chroniques nostalgiques du pays Inca,
Paris, Phebus, 1991, 1992.

Le Temps des offrandes (première partie du voyage à travers l’Europe),
Paris, Payot, 1992. Petite Bibliothèque Payot, 2003

À pied jusqu’à Constantinople : du Moyen Danube aux Portes de Fer,
(2e partie du voyage à travers l’Europe). Payot 1992. Republié sous le titre :
Entre fleuve et forêt, Paris, Payot, 2003.

Vents alizés : un voyage dans les Caraïbes, Paris, Payot,1993.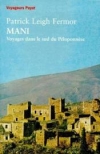
Mani, voyages dans le Sud du Péloponnèse, Paris, Payot, 1999.

In Tearing Haste : Letters between Deborah Devonshire and Patrick Leigh Fermor, ed. Charlotte Mosley, 2008.
Cette correspondance de plus de cinquante ans avec celle des soeurs Mitford qui a épousé un duc est ce qui se rapprochera jamais le plus d'une autobiographie de l'auteur. Inédit en français.
Quelques mots sur le maître lui-même :
Né le 11 février 1915 et autodidacte. À 18 ans, il a traversé l’Europe à pied, alors qu’Hitler venait de prendre le pouvoir en Allemagne : de Rotterdam à Istanbul (comme Childe Harold ? comme Childe Harold). À 25 ans, agent secret britannique parachuté en Crète, il y a kidnappé le général Kreipe, commandant du Reich, « pour relever le moral des troupes». Sexagénaire, il a nagé dans l’Hellespont « en l’honneur de Lord Byron ». À 93 ans (problèmes de vue, écriture devenue illisible) il a appris la dactylo pour faciliter le travail de ses éditeurs.
 Entretemps, il avait fêté son vingt-et-unième anniversaire au Mont Athos, vécu une grande histoire d’amour interrompue par la guerre avec une princesse roumaine, fait retraite dans un couvent de moines trappistes « pour apprendre le silence », participé à une charge de cavalerie, assisté à une cérémonie vaudou en Haïti, arpenté la Grèce, les Cyclades, les Caraïbes et les Andes. Il avait aussi écrit pas mal de livres qui ont fait de lui le plus grand des écrivains-voyageurs de langue anglaise. De sa légendaire traversée de l’Europe en 1933-34 sont nés les deux premiers tomes d’une trilogie, dont le troisième n’est pas encore sorti. Ce sont eux qui l’ont rendu célèbre. Mais il a aussi été journaliste, et scénariste pour Hollywood : c’est à lui qu’on doit le scénario des Racines du Ciel (1958, John Huston, Trevor Howard, Errol Flynn, Orson Welles et Juliette Gréco), d’après le roman de Romain Gary. Il a lui-même été incarné au cinéma par le jeune Dirk Bogarde, dans Ill met by Moonlight (« Intelligence Service »), film tiré du livre éponyme de son camarade de guerre W. Stanley Moss, qui raconte leur capture du général Karl Kreipe en 1944. On le trouve encore, hôte de Lawrence Durrell à Corfou, dans Citrons acides. Etc. etc. etc.
Entretemps, il avait fêté son vingt-et-unième anniversaire au Mont Athos, vécu une grande histoire d’amour interrompue par la guerre avec une princesse roumaine, fait retraite dans un couvent de moines trappistes « pour apprendre le silence », participé à une charge de cavalerie, assisté à une cérémonie vaudou en Haïti, arpenté la Grèce, les Cyclades, les Caraïbes et les Andes. Il avait aussi écrit pas mal de livres qui ont fait de lui le plus grand des écrivains-voyageurs de langue anglaise. De sa légendaire traversée de l’Europe en 1933-34 sont nés les deux premiers tomes d’une trilogie, dont le troisième n’est pas encore sorti. Ce sont eux qui l’ont rendu célèbre. Mais il a aussi été journaliste, et scénariste pour Hollywood : c’est à lui qu’on doit le scénario des Racines du Ciel (1958, John Huston, Trevor Howard, Errol Flynn, Orson Welles et Juliette Gréco), d’après le roman de Romain Gary. Il a lui-même été incarné au cinéma par le jeune Dirk Bogarde, dans Ill met by Moonlight (« Intelligence Service »), film tiré du livre éponyme de son camarade de guerre W. Stanley Moss, qui raconte leur capture du général Karl Kreipe en 1944. On le trouve encore, hôte de Lawrence Durrell à Corfou, dans Citrons acides. Etc. etc. etc.
Aujourd’hui Sir Patrick « Paddy » Leigh Fermor et OBE (Officier de l'Empire Britannique, personne n'est parfait), il vit à Kardamyli, dont il est citoyen d’honneur, dans la maison qu’il s’y est lui-même construite, désormais seul avec ses chats, depuis la mort de sa femme Joan, en 2003. Il a aussi été fait citoyen d’honneur d’Heraklion et de Gytheio. Un autre de ses disciples fut Bruce Chatwin, mort en France, en 1989, mais dont les cendres sont dispersées autour de sa maison. Il a été l’hôte du Festival des Étonnants Voyageurs de Saint-Malo en 1991.
(Photo : Leigh Fermor et Moss en uniformes allemands, juste avant le kidnapping du général Kreipe.)

Patrick Leigh Fermor aujourd'hui
Ceux du disciple : Jason GOODWIN

The Gunpowder Gardens : Travels through India and China in Search of Tea, Londres, Chatto & Windus, 1990. Non traduit en français.

Chemins de traverse : Lentement, à pied, de la Baltique au Bosphore.
Paris, Phebus, 1995.
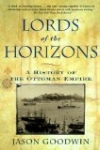
Lords of the Horizons : A History of the Ottoman Empire,
Londres, Chatto & Windus, 1998 – Non traduit en français

GREENBACK : The Almighty Dollar and the Invention of America.
N.Y., Henry Holt & C°, 2003 – Non traduit en français.
Le complot des janissaires
Paris, 10/18, Coll. Grands détectives, 2008.
Le trésor d’Istanboul
Paris, 10/18, Coll. Grands détectives, 2009.
Le mystère Bellini
Paris, 10/18, Coll. Grands détectives, 2010.
Sur les « polars ».
J’ai promis deux mots sur cette série, dont les personnages récurrents vivent à Istanboul dans la première moitié du XIXe siècle. Le héros de ces histoires est un eunuque (fils de noble massacré dans une lutte de clans, lui-même châtré enfant par les vainqueurs). Élevé à l’École des Janissaires, mélange de Compagnie de Jésus et de pépinière à paracommandos. Le sultan Mahmoud II l’a distingué et lui confie les affaires les plus épineuses et les plus secrètes.
Une qui l’a également distingué est la grande favorite, qu’on appelle La Validé, c’est-à-dire la Sultane-Mère, maîtresse toute-puissante du harem et mère de substitution du futur sultan Abd-ul-Medjid, qui a perdu la sienne en bas âge. Figurez-vous qu’elle est française - de son vrai nom Melle de Rivery - ou plutôt créole, puisque née à La Martinique, où sa meilleure amie s’appelait Rose Tascher de la Pagerie (c’est de l’Histoire, tout ceci, pas de la fiction). Expédiée de son île à Paris pour s’y marier le mieux possible, elle est capturée en mer par des pirates, qui la vendent au Dey d’Alger. Elle en devient la favorite, au point de se permettre de lui tirer la barbe. Le fait-elle une fois de trop ? Je l’ignore. Toujours est-il qu’il l’envoie un jour au Sultan : cadeau. L’histoire se répète et la voilà épouse principale, régnant sur le harem impérial comme jamais son amie d’enfance n’a régné sur les Tuileries. Elle adore les romans français – nous sommes à leur grande époque – et en fait bénéficier, après les avoir lus, son protégé, Yashim en anglais, Hashim en français, qui parle des tas de langues dont la sienne.
Yashim-Hashim est fin gourmet, fait lui-même aussi souvent qu’il le peut la cuisine, mais ne dédaigne pas d’arroser ses spécialités stambouliotes de vodka à l’herbe de bison, laquelle lui est fournie par son meilleur et peut-être seul ami Stanislas Paliesky, ambassadeur de Pologne auprès du Divan. Comment peut-on être ambassadeur de Pologne quand la Pologne n’existe plus, partagée entre trois puissances voisines ? Par la grâce du Sultan, qui fait semblant d’ignorer ces péripéties.
Je vous laisse découvrir le reste. Par exemple Venise sous les Habsbourg, où se déroule en grande partie la troisième enquête de cet improbable duo
Ce qu’il convient de savoir encore
sur Jason Goodwin.
J’y ai fait allusion plus haut, notre auteur a aussi un blog :
( http://www.jasongoodwin.net/ ).
On y trouve des gravures du XIXe siècle sur le Bosphore et le Danube, des informations sur ses livres, des vidéos d’interviews et un petit film d’amateur réalisé par lui-même dans la ville qui lui est si chère. On y trouve aussi une rubrique culinaire. Traduction d’un court extrait :
« Ils (les Ottomans) sont arrivés en Turquie en nomades du désert, mais au cours des sept siècles suivants, ils ont sérieusement rattrapé leur retard de civilisation, mélangeant savamment les influences du Moyen-Orient à celles de la Méditerranée. Istanboul reste une Mecque en fait de nourriture. Mon détective ottoman ne pouvait pas ne pas être fin cuisinier. Vous trouverez la plupart de ses recettes dans les livres qui racontent ses aventures. Un jour, un chef de la cour impériale (française) venu visiter les cuisines du palais de Topkapi, armé de ses balances et de son livre de recettes, s’en fit éjecter avec pertes et fracas par le cuisinier du Sultan, pour qui un vrai chef impérial “cuisine avec ses sentiments, avec ses yeux et avec son nez” ! Servez-vous des vôtres. N’usez que des ingrédients les plus frais. Travaillez lentement, avec un couteau bien aiguisé. C’est tout. »
Faut-il préciser que Jason Goodwin lui-même adore faire la cuisine. Il vit dans le Sussex rural, avec Kate, sa compagne d’équipée devenue sa femme et leurs quatre enfants. Ils font pousser leurs propres légumes, élèvent des poules et ont deux chiens de braconniers.
*
23:36 Écrit par Theroigne dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |















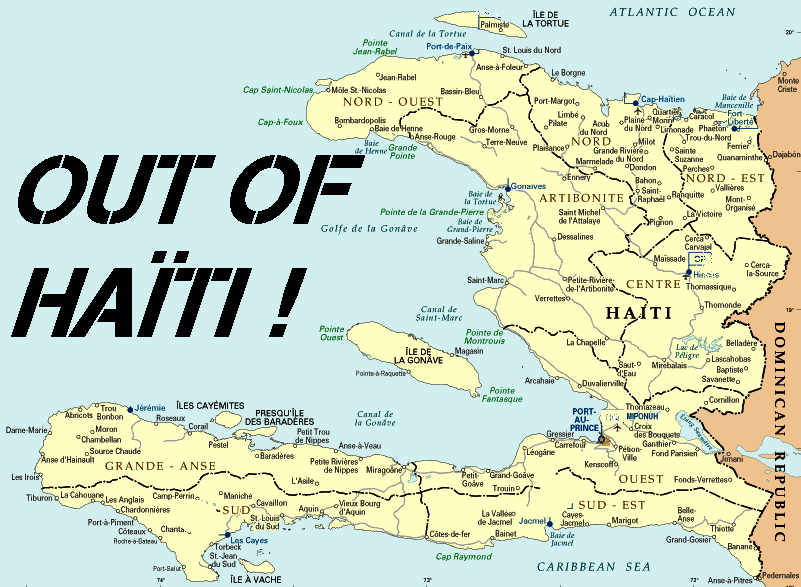







Les commentaires sont fermés.