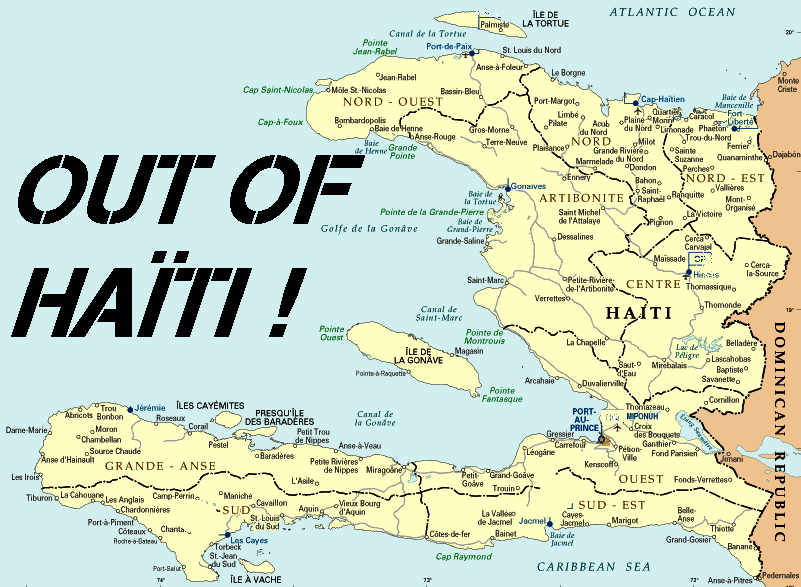07/08/2010
Entr'acte littéraire
Entr’acte littéraire

Un autre auteur de nouvelles...
...car nous en avons deux :
Édouard Le Cèdre
Pour laisser respirer Marie... et vous. Pour interrompre un instant les sinistroses, happer une rapide goulée d’air... aujourd’hui : littérature pure.
Au diable l’avarice, oui, nous en avons deux : un à Liège et l’autre à Paris. L'un, auteur déjà confirmé, l’autre qui fait ses premiers pas dans le bosquet des Muses. Comment, ça, ringard? Moi, j’aimais bien quand on disait ainsi les choses. Bon, puisque nous n’avons pas le même genre de nostalgies, je laisse tomber le bosquet des Muses. Édouard Le Cèdre, d’ailleurs, ne se promène qu’au figuré dans les bois : dans la réalité, il prend le RER deux fois par jour aux heures de pointe et jouit d’une vue imprenable sur un petit parterre au bas de son immeuble.
A-t-il seulement le temps de le regarder ? Car, hormis celui qu’il passe à travailler – eh oui, les fonctionnaires, ça travaille ! N'en déplaise aux parasites politiques – il lit tout le temps, Le Cèdre. Peut-être pas dans le RER à cause de la presse, mais partout ailleurs : dans la rue, au bistrot, chez lui, dans la queue pour aller au cinéma. Il lit de façon compulsive. Des tas de choses, des tas d’auteurs. Boulimique, voilà. Éclectique aussi. Ses préférences vont d’abord aux livres qui sont loués par les critiques de La Quinzaine littéraire, dont il est un inconditionnel, et si Maurice Nadeau n’est pas son dieu, c’est... c’est quoi, juste en dessous ?... pape ?... vicaire du verbe ? Bref, vous voyez. Mais il ne s’en tient pas là. Tous azimuts vous dis-je. Il lit même dans sa cuisine, à haute voix, quand sa jeune épouse lui fait des crêpes : une nouvelle, c’est juste la bonne longueur pour les crêpes. Mais j’anticipe.
Je suis là pour vous raconter comment, un beau jour, il s’est mis aussi à écrire. Juste une fois pour commencer. Dans une circonstance un peu particulière : à la faveur, si j’ose dire, d’un chômage de longue durée, d’une sainte Fauche qui durait depuis des mois et d’une nièce à qui il voulait faire un cadeau pour ses étrennes. « Pourquoi pas un cadeau immatériel ? » se dit-il. Et c’est ce qu’il fit. Sa nièce et lui-même vivaient au milieu de tri-athlètes. Il y avait de temps en temps du jogging de compétition dans l’air. Aussitôt imaginé, aussitôt écrit, ce fut Un doublé magique, onze petites pages en comptant celle du titre, qu’il imprima sur du beau papier acheté tout exprès, et qu’il relia d’un ruban. Très chic. Je le sais parce que, pendant qu’il y était, il m’en a offert, à moi aussi, une copie pour mes étrennes. De l’artisanat comme au Moyen âge ou presque.
Et le temps passa. Et la grande Tyché Sôter se manifesta, et notre nouvelliste en herbe retrouva du travail, se remit à gagner son pain à la sueur de son front, à payer les dettes qu’il venait forcément d’accumuler, bref le parcours habituel du chômeur juste repêché. Pendant qu’il y était, il s’est marié, car on redevient optimiste quand on bosse ( ! ). La jeune mariée planta même un rosier, dans un pot, sur son balcon. C’est lui qui vient d’avoir, cet été, la première rose de sa carrière.  On en était là quand ce blog vit le jour, quand l’amiral de l’escadre lui proposa de monter à bord et de raconter, pour les grosses orchades, ce qu’il voudrait – ses lectures, ses films ou ses pièces de prédilection – et quand il découvrit le Joli coup de Patrick Ledent.
On en était là quand ce blog vit le jour, quand l’amiral de l’escadre lui proposa de monter à bord et de raconter, pour les grosses orchades, ce qu’il voudrait – ses lectures, ses films ou ses pièces de prédilection – et quand il découvrit le Joli coup de Patrick Ledent.
Des nouvelles, il en avait lu des tas, d’auteurs plus prestigieux les uns que les autres, mais jamais de quelqu’un avec qui il aurait pu boire un verre ou bavarder au téléphone. Il dut se dire - ou est-ce moi ? - qu’au fond, puisqu’il en avait déjà écrit une il y a cinq ans, pourquoi pas...
C’est ainsi qu’est née cette autre nouvelle, sur un coup de tête et sur une image mentale qui venait de s’imposer à lui et qu’il s’est mis à décrire sans trop savoir où elle le mènerait. Cela donna, trois jours plus tard, Troubadours de l’imaginaire. Une nouvelle plutôt longue pour le coup : pas loin de trente pages. Et il a dû y prendre goût, car il vient d’en écrire sans désemparer deux autres.
Écrit-on de la même manière quand on est dans une situation précaire ou quand on est délivré de ce genre d’angoisse ? C’est ce dont vous pourrez vous faire une idée par vous-mêmes, amis de ce blog. Et comment écrira-t-on quand la guerre atomique sera là? Écrira-t-on encore, d’ailleurs ? Chut ! Encore un instant, Monsieur le bourreau...
Un doublé magique
I
Elle a longuement et attentivement enregistré les enseignements de son professeur : de longues séances de travail à écouter patiemment, au début sans comprendre, puis petit à petit en commençant à discerner quelques bourgeons de vérités, plutôt devinées, intuitivement pressenties, timidement acceptées et bien vite écloses en fleurs éclatantes d’évidence. Mais cette fois l’enjeu est important. Elle a beau se dire et se répéter qu’elle connaît parfaitement les principes, les conditions de tout cela. Les nombreuses discussions passionnantes ne lui ont-elles pas permis d’être familiarisée avec tout cela !
« Tout cela » reste cependant un monde encore étrange et mystérieux. Les enseignements appris, encore solide granit de certitudes hier, se sont changés aujourd’hui en tas de sable avachis et l’empêchent d’être sereine face à ce défi. Elle ne comprend tout simplement plus du tout ce que tout cela signifie.
Sur le chemin du retour vers son trois pièces quatrième étage, elle est accompagnée d’un cortège de réflexions, plus nombreuses que d’habitude car se sont imposés sans qu’on les invite, les pensées, les rêves, les idéaux, les idées toutes faites, qui entrechoquent les épées de leurs certitudes dans un duel noueux, sans fin, à propos de ce qui se passera demain au petit matin pour ce défi qu’elle s’est lancée et qui l’obsède maintenant. Même l’ignoble arrière cousin Fantasme, gros, encombrant, est là, jouant des coudes pour être au premier rang de la procession. Tout ce monde parle en même temps dans sa tête. Elle se dit que son cerveau est bien trop gentil et qu’il aurait dû établir une sélection ou mettre un gorille à l’entrée pour trier ces importuns. Maintenant c’est trop tard, ils sont tous là, vautrés dans la boîte crânienne à jacasser à qui mieux mieux pour tenter d’avoir raison.
Un élevage de bécasses. Une vraie volière !
Pendant le transit rugissant du métro, l’assemblée crânienne suspend soudainement ses débats et accueille en son sein, telle une reine descendant de son carrosse, Dame Stupeur qui avance chaloupant et s’installe au milieu de la famille. Dame Stupeur a surgi car, au bout de la petite voiture de ce métro, bourrée jusqu’à la gueule, la 5ème symphonie de Beethoven vient d’être attaquée par un accordéon et un tambourin.
Encore plus à son aise maintenant qu’un chant russe éructe un « kalim, kakalim, kakaïa » en version 78 tours, Dame Stupeur s’impose impériale à l’ensemble du cortex. Les pensées, les rêves, les idéaux, les idées toutes faites et consœurs sont béates et muettes. Un monde en chasse un autre.
Les historiens ne sont pas d’accord pour dater exactement le moment du putsch qui mit fin au règne de Dame Stupeur. Certains certifient qu’il eut lieu dès la sortie de la voiture, d’autres confirment que ce fut pendant la montée de l’escalator, des étudiants en histoire, jeunes loups avant-gardistes militent pour dater cet événement lors de la sortie de la station à l’air libre. Toujours est-il qu’après le départ de la chose musicale, l’assaut des bataillons des rêves et des idéaux, de l’infanterie des pensées et de l’artillerie lourde des fantasmes, fut rapidement mené et l’ordre premier fut rétabli.
C’est dans cet état avancé de surdité intérieure, qu’elle rentre chez elle, la tête toujours pleine d’interrogations sur ce qu’elle a résolu de faire demain. Elle pense qu’elle arrivera à relever son défi. Elle le veut. Elle le peut.
Mais c’est la première fois, et à chaque première fois, depuis toute petite, un trouble diffus s’installe en elle. Ce trouble est un compagnon familier, pas facile. Il est d’un caractère taciturne, incertain, gênant. Il est très assidu et n’a jamais loupé les grands instants de doute. Elle n’a jamais su s’il était un vague parent de sa conscience intime ou une sorte de mirage de son esprit. Il s’avère qu’il est aussi encombrant, indésirable et nauséeux que tous les autres.
Sa tête n’en peut plus, trop de monde ! Elle commence alors à policer ce chahut en évinçant une à une les pensées les plus folles, et à en convoquer d’autres plus musclées, plus sérieuses.
Aussi réfléchit-elle au lendemain. Dans quelques dizaines d’heures elle se lèvera, électrique, sautillante et enjouée. Elle imagine ce qu’elle fera, elle rêve éveillée sans s’apercevoir que son visage laisse sa lèvre esquisser un sourire narquois.
Plus calme maintenant, allongée sur son lit, elle peint le plafond de sa chambre d’arabesques de pensées délicates et apaisantes en se remémorant les conseils rassurants de son professeur et fond dans la nuit magique qui libère son esprit de toutes les agitations de l’après midi.
II
Furieuses frappes des timbales métalliques du réveil matin en forme de coq éclatant son chant dans un clairon militaire, tohu-bohu de son fils Léo de trois ans, de sa fille de douze mois et de son compagnon ahuri, en aide de camps affolés au lever des corps à l’aube de ce matin décisif, à l’assaut du bazar à préparer pour la course, sa première course à pied officielle – le célèbre marathon de Paris-, son défi, son rêve et sa folie, bouillonnement des énergies de toute la famille pour ne rien oublier, lui en photo reporter amateur du premier exploit de sa femme, Léo en pile électrique gonflé à bloc des kilohertz de sa mère, la petite dans les vapeurs de ses rêves, tous au service de la cause. Taïaut !
- Vite, nous allons être en retard
- Mais non, je ne suis jamais en retard
- Tu passes par où ?
- Par le plus court
- J’espère qu’il n’y aura pas de bouchons et que nous arriverons à temps
- Téléphone à Bison futé
- Tu crois ? On m’a assurée que tout serait dégagé- Je les connais rien n’est moins sûr - - Tu exagères, ils savent que c’est important. Tout sera prêt, j’en suis sûre
- Téléphone à Bison futé
- Dépêche toi c’est important. La préparation avant le départ est primordiale, mon professeur n’a cessé de me le répéter
- Ne t’en fais pas
- Je m’en fais un peu
- Téléphone à Bison futé
- Bon d’accord je téléphone
- Alors ?
- Comme je te l’avais dit tout est prêt et bien dégagé. Certains coureurs sont déjà arrivés depuis une demi-heure
- Une demi heure ?!
- Une demi heure !
L’ambiance correspond à ce qu’elle avait imaginé, mais le temps est mauvais, un ciel gris fuit de toute part d’une pluie molle et froide.
Des milliers de coureurs groupés en nuage de confettis multicolores transforment ce matin la place de l’Etoile en vaste mosaïque bariolée où les uns étirent langoureusement leur jambes ou déploient leurs bras en éventail céleste ou assouplissent leur dos en mouvement amoureux, et les autres attendent en statue vigilante le moment du départ, tous cousins de ces grands échassiers roses d’Afrique qui s’envoleront tout à l’heure ensemble, mystérieusement unis comme un seul corps.
Cette foule maintenant compacte, un peu tendue, s’organise aux ordres d’un capitaine invisible crachés dans un micro de fête foraine.
Dans une symphonie de barrières disposées en chicanes, comme tout le monde elle attend le moment fatidique, le coup de feu du départ, qui les projettera tous à gros bouillons de paquets distordus sur l’asphalte des Champs Elysées qui maintenant se couvre de jambes, de pieds et de corps, grappe humaine qui s’ébranle maladroitement et finit par s’allonger comme on beurre une tartine sur une langue de pain.
Sa petite famille a établi un plan sophistiqué de contournement et de suivi des troupes, grâce à une carte détaillée que les gentils organisateurs leur ont procurée.
Il s’agit d’être présent à une dizaine d’endroits stratégiques répartis sur tout le circuit afin de la suivre, de l’encourager, de la prendre en photos, de hurler des mots doux.
Mais l’affaire n’est pas aussi simple. Il faut se déplacer rapidement d’un point à un autre en trompant les gardes ennemis, en contournant les nombreux obstacles, enjamber des barrières ou passer en dessous, tracer des Z entre les voitures, traverser des terrains détrempés au risque de s’enliser, parfois courir, ne pas se perdre car ils se rendent compte qu’ils ont été dupés et que le plan a sans doute été dessiné par un artiste fou, Dédale amoureux des labyrinthes. Vite ils arrivent, où ça, là-bas je les vois, traversons ce parking, Léo suis-tu, oui j’ai faim, pas le moment, la vois-tu, elle arrive, oui je la vois dans le viseur de la caméra, allez, allez, zut j’ai laissé mon pouce sur l’objectif, courons au prochain passage là-bas passons par dessus les voitures, les buissons, les arbres et les bosquets, il nous manque un cheval pour aller plus vite !
III
Elle suit la piste et les conseils. Tenir, il faut tenir, ce n’est que le tout début.
Une de ces équipes de club sportif en pelotons serrés débouche soudain, horde sauvage d’étalons impatients bagarreurs, fiers et gorgés de muscles soignés rutilants, mécanique huilée, muscles noueux de cuisses en marteau de métronome tapant la terre à chaque foulée, larges enjambées qui avalent la langue noire sablonneuse de la route, cœurs haletants qui râlent en souffles chauds, puissantes forges époumonées vomissant fumées d’haleine et baves nasales, cheminées humaines exhalant le rance d’une sueur d’effort, odeur d’oignons cuits en semelles de cuir racornis, suint de pieds et d’aisselles mâles, coureurs de fond en troupe serrée qui lui pincent les fesses, qui la doublent dans le premier virage, l’avalent, l’absorbent, la digèrent et l’éjectent à l’arrière, petite crotte continuant de trotter menu, léger, régulièrement.
Son souffle s’est accéléré et elle est prise dans le mouvement de piston d’une machinerie ferroviaire, son cœur lui rappelle la cadence des galériens déployant leurs efforts au rythme du tambour, boum, boum, boum, inspire, souffle, inspire, souffle, torrent de sang chaud pulsé dans les veines de son cou, inspire, souffle, inspire, souffle, chaleur moite qui monte des reins, grimpe le long du dos, caresse sa peau maintenant humide, enveloppe sa nuque, rosit son visage, doigts de sueur le long des joues, perles de vapeur germées au front, agrippées aux mèches de cheveux, les collant en pointes, en virgules, gouttes glissant sur le nez, stoppées en bulles sous ses narines, inspire, souffle, inspire, souffle, bouche aspirant l’air comme l’eau fraîche, petites goulées coulant dans la tuyère de ses poumons, cœur frappant en pompe régulière, intense, vivant dans sa poitrine, boum, boum, boum, bras en balancier entraînés eux aussi dans cette aventure, elle s’encourage, déjà la moitié, bientôt la forêt, et après on verra l’arrivée, avant ce mâle isolé la devant, en peine de jambes, gras comme un cochon, qu’il faut rattraper, et atteindre, et doubler, c’est le défi et ses jambes obéissent disciplinées, happant mètre par mètre le ruban de cette course infinie, deux membres puissants en service commandé qui l’amènent près de personnages familiers, rivés derrière une grille, l’un travesti en reporter, caméra à main droite, la gauche l’encourageant en tourniquets, sac à dos-kitchenette déployé en biberons, serviettes, gants et bonnets rangés autour de la petite dernière, sortie de ses rêves, l’autre haut de trois pommes, hissé sur la pointe des pieds, les yeux fixés d’étonnement sur sa mère muée en moteur diesel.
Ils la haranguent avec force, vocifèrent et hurlent d’enchantement et de ferveur. Le petit Léo s’agrippe à la grille qu’il veut arracher et s’époumone d’imiter les autres qui yodlent leur soutien comme les skieurs autrichiens d’une descente de ski nocturne un soir de Noël.
Ils ont traversé plusieurs fois de part en part ce territoire quadrillé pour la voir et l’encourager, la prendre en photo aux moments décisifs.
C’est presque la fin et il leur faut se positionner près de la ligne d’arrivée, l’aboutissement de cette épopée, là où l’Histoire se fabrique.
Ils la voient encore une fois juste derrière un brave concurrent qu’elle s’escrime à vouloir dépasser. Vingt mètres les séparent. Le pauvre bougre est en bout de course, vieux buffle éreinté et telle une tigresse, elle accourt sur son train pour le dévorer.
Une lutte sans merci s’engage à l’approche de l’arrivée.
IV
Vingt mètres. Seulement vingt mètres.
C’est ce gras de cochon qu’elle suit depuis une éternité. Parce qu’elle aime les cerises sur les gâteaux, à l’approche de l’arrivée, elle dépose cette friandise en forme d’ultime défi dans la grande bataille qu’elle livre depuis ce matin et se donne l’ordre de doubler ce concurrent maintenant, mais ses jambes se révoltent et menacent d’arrêter, son tambour de cœur veut changer d’instrument, son souffle, forge incandescente, chaudière de hauts fourneaux tournant à plein régime qui menace d’exploser. Tous ses organes mobilisés depuis des heures commencent à se ramollir à la vue de la bannière d’arrivée.
Elle doit alors frapper à la porte du cerveau et lui demander de prendre les choses en main, mobiliser la Brigade d’Intervention Spéciale, une force mentale saillante comme l’acier d’un sabre, forgée de toute pièce, tendue comme un arc pour supplanter les défaillances de son corps et réussir cette dernière échappée.
Un stress la parcourt des pieds aux cheveux. Elle devient ivre d’oxygène, multiplie ses foulées en suite de larges viaducs qui enjambent les derniers mètres de cette dernière ligne droite.
Son cerveau, complètement affairé à cette entreprise tire des manettes, appuie sur des boutons, tourne des vilebrequins, actionne des pompes, et lui commande d’accélérer.
Elle en rirait si elle en avait la force.
Encore quinze mètres. Quinze petits mètres.
L’athlète devant poursuivi, hors d’haleine, épuisé, s’est déjà retourné deux fois au risque de se tordre le cou et de tomber. Il ne veut pas se laisser croquer ainsi, lui un mâle, ancien champion. N’en pouvant plus, du plomb aux pieds, lui aussi accélère, pathétique quadrupède chtonien.
Mais, tigresse métamorphosée en gazelle, aérienne, joyeuse, dégorgeant de vie, sa foulée défie les règles de la gravité. Encore dix mètres, une poignée de secondes, un souffle au regard de l’infini.
Ses jambes la portent haut, loin. Elle vole, acharnée, libérée comme une flèche d’Amazone qui coupe l’air sans dévier, droit devant, tendue vers la victoire.
Elle jette toutes ses forces dans la bataille, aspire le malheureux, le pose à son coté, épaule contre épaule, entrevoit son visage de l’extrême coin de l’œil, et lentement, doucement, imperturbablement, le malheureux glisse hors de son champ de vision pour rester derrière, souffleux et hébété.
Elle a réussit l’incroyable, envahie de joie, elle savoure l’énergie de ses tripes en un orgasme de victoire.
La bannière d’arrivée est là devant à quelques mètres.
Elle y est presque, quand soudain, venu de l’inconnu, un concurrent de la catégorie poussin, pas plus haut que trois pommes, déboule comme une fusée et, stupeur ! Stupeur ! la double sur la ligne d’arrivée telle une plume dans le souffle du vent !
D’où vient-il ? Tout à sa stratégie, elle ne l’a pas vu venir ni partir.
Se peut-il que le monde de la course à pied soit aujourd’hui si performant qu’il puisse produire de si jeunes athlètes ?
L’arrivée.
Ravie d’avoir terminé son premier marathon et intriguée par cette tête blonde surgie devant ses pas, elle se dirige fourbue mais heureuse d’un pas relâché vers les arbitres, grands ordonnateurs des chronomètres et des performances attestées.
- Bonjour, j’ai fini, voici mon dossard, pouvez-vous me donner mon temps ?
- Ah ! Avec les dossards et l’informatique on n’y arrive pas
- Comment faites-vous alors ?
- Avec votre nom
- Vous voulez mon nom ?
- Oui, avec votre nom, on y arrive. C’est plus long mais on y arrive. L’ancienne méthode quoi
- Très bien, je vais vous donner mon nom
- Oui, çà devrait marcher
- Sandrine L.
- Bon je regarde dans le fichier
- Prenez votre temps
- Oui, oui, je cherche
- Allez y, j’ai tout mon temps maintenant
- Vous savez, vous êtes des milliers, on ne doit pas se tromper. Après il y a des réclamations, les gens ne sont pas contents. C’est une course importante vous savez ! Le Marathon de Paris, toute la planète nous regarde.
- C’est sûr
- C’est pour cela que je cherche calmement
- Je comprends
- J’arrive à la lettre L. Il y a beaucoup de personnes dont le nom commence par la lettre L, c’est fou ce qu’il y en a !
- …
- Ah ! Je le tiens
- Enfin, je vous écoute
- J’ai trouvé qu’un seul concurrent gagnant à la lettre L. Ce n’est pas vous mais un dénommé Léo, âgé de trois ans champion de la catégorie « poussin-encore-dans-l’œuf », une catégorie qu’on a bien été obligé d’inventer pour un cas pareil. Du jamais vu. Vous pouvez me croire, il ira loin ce petit. Un prodige. Tenez, de temps en temps ça me prend de faire de la poésie quand il se passe des choses aussi extraordinaires que celle là. Je dirais que ce Léo est le nouveau Mozart des courses de fond. Hein ? Pas mal comme idée. Le nouveau Mozart ! Si j’étais vous, j’irais vite le prendre comme professeur pour gagner l’année prochaine.

*
(à suivre)
13:17 Écrit par Theroigne dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
Entr'acte littéraire (suite)
Entr'acte littéraire (suite)
Édouard Le Cèdre

Troubadours de l’imaginaire
Le but d’un voyage importe moins que le voyage en soi.
Un voyageur authentique est celui qui voyage sans but.
Robert Louis Stevenson
Le train se fit entendre au loin et si on plissait les yeux on pouvait discerner le petit point noir de la locomotive posé sur l’horizon grossir au fur et à mesure que le convoi s’approchait lentement en glissant sur la ligne droite des rails dans le trembloté des effluves de l’air dont la chaleur de four brûlait jusqu’au moindre souffle de vent et signalait ainsi qu’on était bien au Nouveau Mexique et en plein mois de juillet. Wander était arrivé tôt pour attendre ce train, pour ne pas le manquer surtout. Elle lui avait confirmé la veille sa venue à leur rendez-vous secret, loin des regards et des courants de hasards inopportuns dans le mystère d’un coin perdu et improbable et l’attente sous le feu d’un soleil implacable avait réussi à lui procurer du plaisir.
L’intense chaleur de l’été écrasait tout et rendait presque palpable l’air par cette fin de matinée. Aucun souffle ne venait jouer avec les fétus de paille qui d’habitude tourbillonnaient en dessinant les arabesques les plus folles, spirales ascendantes en tours de Babel éphémères suivies d’amples figures dessinées en l’air tel un vaste alphabet écrit d’une main invisible.
L’odeur de la poussière et du sable chauffés à blanc essayait de se faire passer pour le seul air respirable, mais les effluves du goudron séché sur les ballasts et de la graisse des aiguillages, mélangées à celles du bois rôti au soleil empêchaient de se ruiner en vains fantasmes de traversée du Grand Erg tunisien et ramenaient sagement les pensées débridées à la réalité de ce coin perdu de l’Ouest américain.
L’ombre rare s’était rassemblée chétive sous l’auvent de la petite gare tout en bois qui ressemblait à la maquette d’un jeu ferroviaire qu’on aurait agrandie. A part la gare, il n’y avait pas d’autres baraques dans ce coin de désert. Même la route asphaltée, nervure principale de cette plaque de territoire qui reliait Santa Fe à El Paso avait tout juste réussi à faire pousser un diverticule en forme de piste cabossée qui sinuait curieusement autour d’obstacles imaginaires et Wander avait dû laisser sa Plymouth au bord de la nationale pour se rendre à pied à la station.
La gare n’était pas abandonnée mais faisait partie de ces reliques qu’on ne s’était pas résolu à démolir suite aux compressions de personnel et à la faillite des grands trusts. On avait décidé, après bien des décisions, de contre décisions et de retours au point de départ, comme on retourne une crêpe plusieurs fois avant de la manger, de garder l’édifice pour des arrêts techniques ou exceptionnels qui pouvaient arriver à tout instant, maintenant que la dérégulation avait fait place à l’improvisation la plus totale.
Un système de gestion automatique à distance conférait au lieu la totale inutilité de payer un esclave salarié pour tenir des registres désuets et pousser des manettes dans le vide. Le bureau du directeur et la salle de repos des équipes techniques étaient donc déserts bien que les installations qui leurs servaient de décor fussent laissées en l’état.
Les petits bruits de respiration habituels, comme le bzzz fugace d’une mouche ivre, l’infime cliquetis d’une chaîne rouillée secouée de ses derniers spasmes, l’enfouissement chuinté d’un lézard apeuré dans sa retraite cachée ou le craquellement timide d’une charpente couinant sa fatigue, multiples sons réguliers d’une chacone naturelle, avaient totalement disparu.
Aucun bruit.
Pas le moindre feulement ni souffle d’air.
Un silence absolu plombait la matinée et figeait Wander debout dans l’attente du convoi.
……
- Fait chaud hein ! Z’attendez le Direct de Phoenix ? grésilla soudainement une voix à l’arrière - Wander sursautant de surprise, effrayé par la chute brutale de ce bloc de réalité dans le jardin de ses rêveries.
- Qu’est-ce que…
Surréaliste, pensa Wander en considérant l’individu magiquement apparu qui se tenait devant lui en train de faire tourner sa chique autour de son unique dent comme un chewing-gum racorni.
Un brin fasciné par la dextérité de sa langue, sorte de motte de chair noirâtre de nicotine, Wander observait du coin de l’œil l’arrivée de trois autres compères qui manœuvraient lentement pour former un cercle autour de lui bien qu’un carré aurait été plus adéquat compte tenu de l’étroitesse de la plate forme qui servait de quai. Ils devaient être frères ou cousins et sûrement du coin car les vieilles nippes dépareillées qui leurs servaient de vêtements se ressemblaient étrangement.
Comment étaient-ils arrivés ? C’est ce que cherchait à comprendre Wander alors que les quatre diables commençaient à changer d’attitude devant le silence qu’il leur opposait et le regard d’aigle qui habillait maintenant ses yeux.
- Vous attendez peut être aussi le train ? – lança-t-il en forme d’amuse-gueule, sa main cherchant au fond de sa poche un quelconque objet rassurant et n’y trouvant qu’une boule de papier qui devait être son dernier relevé de banque rageusement chiffonné ce matin à la vue de son compte toujours aussi déprimant.
Alors que des gouttes de sueur s’amusaient à le chatouiller en sinuant lentement le long de sa colonne vertébrale, une voix aigrelette sortie d’un deuxième gosier lui demanda :
- Z’êtes pas du coin on dirait ! Comment vous vous appelez ?
- C’t’à vous la Plymouth là-bas sur le bord de la route. Pourquoi c’est-y que vous l’avez mise dans le fossé ?
- Hiiiii, dans le fossé, c’est nous qui l’av…
- Ta gueule Charlie, c’est pas à toi de causer !
- On attend tous quelque chose dirait-on. Je me présente. Je m’appelle Wander. Binj Wander et j’attends la femme de ma vie, dans le train qui sera là d’un moment à l’autre. Vous, on dirait bien que vous connaissez les lieux. Si ma voiture est dans le fossé, vous pouvez peut être m’aider à l’en sortir ?
Vraiment surréaliste, marmonna Wander détaillant un à un les quatre larrons. Ils se regardaient sans cesse en roulant des yeux comme s’ils fabriquaient chacun un morceau de la phrase que seul, celui qui apparaissait le plus malin, le plus petit, l’aîné sans doute, était en mesure de prononcer. S’il n’avait pas été un furieux matérialiste, Wander aurait pu penser qu’un esprit était venu animer les quatre épouvantails qu’il avait remarqués peu avant, plantés dans le champ de maïs fendu en son milieu par l’asphalte noir de la route qu’il suivait depuis des heures au volant de sa voiture.
Les Dalton, comme il commençait à les surnommer intérieurement s’étaient approchés encore un peu plus, ce qui lui permit de changer d’appui et de chasser les fourmis qui lui picotaient la plante des pieds depuis des minutes d’immobilité resté campé, il ne savait pas pourquoi, sur le même pied depuis le début, et de faire entrer dans son champ de vision la boule noire de la locomotive qui s’était approchée et dont on distinguait maintenant le chapelet de wagons qu’elle tirait bravement.
- Faut voir. En échange de quoi ? Nasilla le nabot d’un air qui avait du mal à le faire passer pour le lapin d’Alice au pays des merveilles.
- De ma mansuétude, vu que c’est vous qui l’avez mise dans le fossé ! asséna Wander d’un ton de dur à cuire à qui on ne la fait pas, croisant les bras pour montrer les boules de ses biceps.
- Hiiii ! C’est quoi ce truc de mansuétude ? Cà s’mange ou bien çà s’b…
-Ta gueule Charlie ! Je t’ai déjà dit que c’était pas à toi d’causer !
Des tics nerveux animaient maintenant leurs visages. Celui qui venait de se faire rabrouer contenait sa rage en fixant ses chaussures et en laissant ses mains gratter ses bras pleins de croutes que Wander diagnostiqua comme pouvant être des suçons amoureux qui avaient mal tourné.
Le troisième était très attaché au sourire qui barrait son visage depuis le début comme un morceau de viande séchée posé en cataplasme cramoisi sous une sorte d’ouvre boîte de nez crochu, qui néanmoins laissait voir les morceaux de craie de ses incisives curieusement blanches.
Le dernier, le plus grand, s’efforçait d’imiter une statue de l’île de Pâques qui aurait eu des salsifis en guise de membres. Il restait immobile, tout à l’observation des trois autres et croyait accroître son âge en gonflant régulièrement ses joues pour expulser l’air bruyamment, sans doute pour exprimer les limites de sa patience devant le déroulement de cette rencontre inopinée qui commençait à tourner en rond, à moins que ses exhalaisons ne soient l’effet d’une aérophagie prononcée ou d’une mauvaise digestion.

- Alors comme çà, vous pensez que c’est nous qui avons poussé votre bagnole dans le fossé ? continua le nain hirsute en obliquant le regard.
- Elle n’y était pas quand je l’ai quittée pour venir ici, et votre frère a dit….ou a semblé dire, c’est vrai, il ne l’a pas dit comme ça mais j’ai compris que vous y étiez pour quelque chose. Si ce n’est pas vous, alors mes excuses, mais cela n’explique pas pourquoi elle y est maintenant.
- D’abord c’est pas mon frère – dit-il d’un air mauvais.
- Hé ! Vous entendez çà vous autres ? Cà serait nous qui aurions balancé sa voiture dans le bas côté ! Z’êtes pas un peu gonflé comme gars !
Ils remuèrent comme des poupées à ressort synchronisées en s’esclaffant à qui mieux mieux ce qui amena Wander à se demander quels bons mots il venait de prononcer pour avoir déclenché pareille explosion d’hilarité.
La cascade de borborygmes et d’éclats de rire qui coulait à flots les rendait sourds aux dénégations que Wander leur criait.
- Trouvez pas çà drôle vous autres ? Charlie approche-toi ! Zeb ! Arrête de rire qu’est-ce que t’en dis ?
- Ha Ha ! La bagnole dans le fossé ! Ça nous retombe dessus ! Elle est bien bonne !
- Ha Ha Ha
- Je n’ai pas franchement dit que c’était vous ! – Ecoutez-moi !
- Ha Ha …Eh Wyg, Je te vois en train de pousser sa voiture avec tes bras de spaghettis que tu n’es même pas fichu de bouger la charrue sans glisser et te foutre la gueule par terre en t’cassant les dents ! Postillonna celui qui n’avait pas encore parlé
- Ha Ha Ha !
- Ecoutez-moi !
- Ha Ha Ha !
- Ecoutez-moi ! Nom de Dieu ! Ecoutez-moi ! N’approchez-plus sinon…
Wander arriva d’autant moins à se faire entendre que la locomotive noire et suante telle une baleine métallique sortie d’un volcan hurlait au même instant son cri de triomphe d’être arrivée à l’heure en faisant jaillir de toute sa carapace d’acier aux multiples rouages métalliques et de sa haute tuyère de cheminée en forme de trompette de puissants jets de vapeur qui fusaient plein gaz en sifflant à fond dans toutes les directions en même temps que les douze rondelles d’acier qui avaient tracté cette colossale machinerie en roulant sans arrêt depuis Phoenix, mordues à mort par les implacables mâchoires de freins, agonisaient en finissant de gémir en un cri strident de métal frotté qui parachevait le terrible final de cette symphonie ferroviaire.
- Le train ! Le train arrive ! Le train est arrivé ! Bon dieu ! Faut y aller ! Vite filons ! crièrent-ils en mode choral.
Comme frappés par un rayon jupitérien, les quatre pauvres ladres décampèrent aussitôt comme un seul homme et laissèrent Wander un peu saoul du vacarme ambiant et perplexe quant à ses facultés de déduction.
Trempé de sueur, il desserra sa ceinture pour extirper le bas de sa chemise qui lui badigeonnait le dos et ne put résister à génuflexer deux à trois fois pour détendre ses cuisses pourtant bien musclées tout en récapitulant, avec ce qui lui d’énergie, la scène qu’il venait de vivre.
Il regretterait de ne jamais connaître le prénom du quatrième luron, celui dont la posture immobile l’avait fait passer à ses yeux pour un grand sage hindou stoïque face au danger du crotale enroulé prés de ses pieds alors que c’est peut être simplement par myopie qu’il ne l’avait pas vu. Il imaginait sans peine les lascars pousser maladroitement sa voiture sur le côté, sans pour autant discerner les raisons véritables d’une telle manœuvre, si ce n’est de permettre au plus déluré des quatre d’en finir avec sa dernière dent en la cassant sur le capot, pendant qu’il glissait en essayant de pousser la décapotable.
Les yeux dans le vague fixés sur un point imaginaire, ses pensées s’interposaient dans son esprit scène après scène comme la succession de diapositives qu’un de ses amis avait traditionnellement la fâcheuse habitude de lui imposer à chaque retour de vacances, et l’empêchaient de voir l’immense et nouvelle photographie que représentait à présent la chenille d’acier du train arrivé en gare et qui formait maintenant le nouveau décor duquel se détachaient au premier plan les longues jambes de sa femme descendant à reculons les marches du wagon trop hautes pour éviter à sa jupe pourtant déjà courte de remonter au-delà de ce qu’elle s’autorisait en pareille occasion.
Elle était toujours ravissante mais s’était cette fois visiblement surpassée pour leur escapade amoureuse. Wander plein d’un désir ardent qui n’avait jamais faibli depuis qu’ils s’étaient définitivement arrimés pour la vie, savourait l’effet de surprise qui commençait à le picoter sérieusement en constatant que les larges bords en paille tressée du nouveau chapeau qu’elle portait pour cette occasion ne cachaient pas la remarquable chignonade de ses longs cheveux qu’elle avait réussi à torsader de façon négligée et dont la blondeur s’harmonisait parfaitement avec la lumière dorée et éclatante du zénith de cette journée singulière.
Car il était midi, l’heure du rendez-vous, et il la vit s’approcher très lentement en petits pas glissés, fleur de printemps toute de rose vêtue qui l’observait de là-bas en face, l’avait reconnu, lui faisait signe de la main, le fixe maintenant droit dans les yeux, lui sourit et jette son regard attentivement à droite et à gauche avant de traverser le boulevard du Montparnasse pour se joindre à lui, assis à la terrasse de La Rotonde, un de leurs restaurants favoris, où depuis une heure il l’avait attendue laissant refroidir l’expresso qu’il avait commandé, encore plein des rêveries que lui avaient infusées le livre qu’il lisait.
Kyn est maintenant debout devant moi, rayonnante comme jamais, masquant mal l’air fripon qui anime toujours son visage lorsqu’elle lit à cœur ouvert dans mon esprit et devine sans jamais faire d’erreur les impressions qui m’agitent.
- Alors ? Est-ce que Binj Wander arrive enfin à retrouver sa femme adorée ? chante-t-elle façon flûte traversière.
- Vois-tu Kyn, j’aurais beaucoup à dire sur ce roman. En tout cas question chaleur ce n’est pas comme ici. On va à l’intérieur ?
- « Garçon, nous avons terriblement faim » - « Et l’envie de nous réchauffer ! »
- Dans ce cas madame, je vous conseillerais de prendre notre dernière création culinaire, un haggis d’une rare richesse en graisse spécialement préparé par notre nouveau chef écossais, c’est très gras et lourd à souhait, effet garanti.
Et pour vous Monsieur, la maison a entièrement renouvelé sa carte des plats de volatiles protégés. Nous avons maintenant un large choix d’oiseaux en voie d’extinction strictement interdits à la chasse que nous préparons selon les goûts du client. Jugez plutôt, on peut vous proposer de l’albatros en cocotte avec sa purée de marron, du pélican de Madère, rôti ou sauté au vermouth, du cormoran à aigrettes – c’est très rare, ce qui explique le prix, vous comprenez -, du héron cendré – là, il faut se dépêcher car il n’y en aura bientôt plus-, du eider de Steller - par rapport au canard commun, je vous recommande plutôt les magrets -, je ne sais plus s’il nous reste de la cigogne mais dans ce cas vous ne perdrez pas au change en prenant du flamand rose – c’est très fin, un peu fade, c’est pour cela que nous le cuisinons avec des épices de Madagascar. Voilà, je pense n’avoir rien oublié…Ah si, exceptionnellement aujourd’hui, pour fêter son anniversaire, le directeur a tenu à mettre comme plat du jour sa célèbre recette, l’aigle royal fourré aux oisillons – çà change selon les arrivages. En ce moment il y a des bécasseaux, des merles, un ou deux colibris, des petites hirondelles sorties de l’œuf, et si possible des pinsons et des mésanges pour donner davantage de goût.
Mais rien ne vaut notre grand classique que je vous recommande personnellement, la traditionnelle brochette d’ortolans fraîchement abattus cette nuit. Vous verrez, c’est un régal. C’est du produit de contrebande, certes, mais de qualité.
- Très intéressant. Ce sera donc un haggis pour madame et pour moi, la brochette d’ortolans.
- Parfait, je vous amène çà dans cinq minutes.
- Mais pourquoi ce serveur nous dit-il tout cela, et sur ce ton là en plus ?
- Pour ne pas tromper sa clientèle. Il dit exactement la vérité.
- Tu plaisantes ?
- Pas du tout. Depuis la crise qui a balayé tous les pays de l’Arc Occidental, plus personne ne croit aux balivernes de l’ancien système. Tu te rappelles ces fameuses sciences - je mets de gros guillemets -, qu’on appelait « marketing », « communication », « respect du client », « compétitivité », «bonne gouvernance »
- Oui ça m’a toujours fait rire !
- He bien aujourd’hui plus personne ne croit ces mensonges. Ils sont tous obligés de dire la vérité, sinon ils passent pour des menteurs, des voleurs et des hypocrites, et font faillite. Avant, le serveur t’aurait vanté les vertus diététiques de son haggis et t’aurait menti. Maintenant, il dit que c’est un plat extrêmement gras, conformément à la réalité. On y a gagné en éthique !
- Oui, mais pour les oiseaux interdits ?
- Là, c’est suite aux dernières décisions de l’Europe qui essaie de se sauver du désastre.
- Comment cela ?
- J’ai lu quelque part que dorénavant les produits de contrebande étaient entièrement défiscalisés, façon de relancer l’économie.
- Je réfléchissais ce matin avant de venir te rejoindre à notre éternel concerto à deux voix au sujet de notre imaginaire – je veux dire celui des humains, de tous les humains et je voyais cet imaginaire comme une mer noire extrêmement calme, une vaste nappe d’huile sans limite et sans fond discernables…
- Pas comme une étoile étincelante et multicolore, fascinante et brillante ?
- Curieusement non. Et pour y pénétrer, non par des portes comme on le dit souvent – tu sais les fameuses « portes de l’inconscient » - mais plutôt une multitude de passerelles, toute différentes, très longues, infiniment longues, fragiles, les unes en corde, en bambou, les autres plus rassurantes en planchettes de bois bien solides, certaines dignes des joujoux que Gustave Eiffel a dû réaliser pendant son adolescence, d’autres au contraire en filets de fumée telles des fantômes sortis des limbes.
Je pensais aussi à ce que peuvent faire les histoires, les romans, la littérature en général pour nous sauver ou nous protéger de la folie du monde et aux mille et une façons de ressentir une réalité et d’essayer de la vivre comme fiction et inversement – tu comprends ?- Comment s’inspirer d’une fiction pour agir dans la vie. La littérature est un territoire tellement immense !
Tu vois, si je prends ce haggis, effectivement très lourd – tu veux goûter ? -, c’est avant tout parce que j’ai voulu que l’Ecosse s’étale dans mon assiette. Par exemple, ces divers petits granulés de hachis d’abats de mouton me font penser aux mottes de terre fleuries, pleines de genêts et de chardons épineux, de campanules et de primevères qui crissaient sous mes pieds lors de l’ascension du Ben Nevis, un été de vacances à Edimbourg il y a des années. Je vois dans cette croûte grillée de gruyère râpé le jaune profond des bouquets de boutons d’or qui nappaient par endroits réguliers la prairie que je gravissais gaillardement et que j’imaginais alors, la fatigue aidant, comme mouchetée de gouttes d’acrylique jaune tombées de la palette d’un peintre céleste. Je décide, en regardant cette écrasée de pommes de terre, que le monticule de purée qui mord le bord de l’assiette, par son aspect compact sera le granit de cette molaire géante que représentait pour moi cette orgueilleuse montagne écossaise.
Par mon imagination et mes fantaisies l’Ecosse est venue à moi, pas le contraire.
- Une panse de brebis proustienne en quelque sorte.
- Oui mais visuelle, pas gustative. Toi, tes ortolans sont tellement cuits que tu pourrais facilement te rappeler les cailloux de lave brune qu’on récoltait dans les crevasses des pentes de l’Etna, à moins que tu ne choisisses pour t’inspirer, la visite de Pompéi et ses objets carbonisés saisis en pleine vie par la lave du Vésuve.
Kyn se trompe juste de pays.
En mâchouillant depuis tout à l’heure ces pauvres oisillons calcinés, je ne suis ni un vulcanologue amateur ni un archéologue néophyte, mais plus modestement un brave mineur des houillères du Nord sorti droit de Germinal rentrant chez lui à la fin de sa journée la gueule noire de mâchefer.
Tout en continuant de l’écouter, je me rappelle certains de mes états de transe qui m’ont plus d’une fois envouté, plus d’une fois permis de comprendre le sens caché de certaines situations inextricables et souvent apporté la force dont je manquais pour les affronter et surtout les résoudre. J’ai mis du temps à comprendre la puissance de la littérature lui conférant le statut d’un véritable contre pouvoir, un peu comme on le dit du théâtre. Il m’arrive encore aujourd’hui, quoique plus rarement parce que je tourne vite la page, de tomber sur telle ou telle chronique ou interview d’un romancier plus ou moins célèbre qui tente d’expliquer la nature de la littérature. Evidemment il n’y arrive pas et débite des sottises éculées. Si on veut avancer dans cette recherche, il faut en appeler aux écrivains qui, à juste titre fuient comme la peste ce genre d’épanchement. « Lisez mes livres - ont-ils l’air de dire - et vous comprendrez par vous-même.
Je me souviens de mes premières conférences littéraires auxquelles j’assistais tous les jeudis avec mon ami Mahrko, où nous nous familiarisions avec la figure du triangle- Auteur-Lecteur-Personnage- qui, nous disait-on, était le prisme universel permettant de comprendre comment s’organise la magie et le pouvoir de la littérature sur la réalité, comment elle arrive à faire plier le réel : « le lecteur crée l’auteur, l’auteur n’existe que par le lecteur, le personnage fictionnel réclame son autonomie, s’impose à l’esprit du lecteur et échappe à son auteur » nous assénait le théoricien du haut de sa chaire comme un pasteur en transe.
« Un triangle magique ! » M’étais-je exclamé.
« Plutôt un triangle maçonnique ! » rétorqua Mahrko qui trouvait des symboles partout même sous les sabots d’un cheval.
Foin de triangle magique ou symbolique, j’avais défendu avec passion mon triangle à moi, le triangle politique et je me revois encore debout, fiches à la main, déployer ma péroraison sous le regard attentivement amusé du maître : « une littérature peut s’apprécier aussi par le prisme triangulaire formé par la puissance d’évocation du récit, ses qualités littéraires formelles intrinsèques et le statut de l’auteur selon que son pays d’origine fait partie de l’Empire ou est pillé par lui. Autrement dit un écrivain irakien qui écrit une pochade ne peut pas être sauvé de l’oubli au regard de sa nationalité. Par contre si sa description de la torture américaine en alexandrins arrache des larmes à ses lecteurs, il faudra sa battre pour lui ».
« Alors d’après vous les romanciers et les poètes américains sont tous nuls parce qu’ils sont des habitants de l’Empire comme vous dites ! » - me lança un jeune étudiant plein de colère.
« Et puis qu’est-ce que c’est que cette histoire d’Empire, pouvez pas parler comme tout le monde et dire les Etats-Unis ? » - m’asséna un autre en furie.
S’en était suivi une avalanche de protestations -une minorité m’avait soutenu -les cris d’orfraie avaient rivalisé avec les noms d’oiseaux qui fusèrent par-dessus les têtes, les bras et les jambes s’agrippant maladroitement à tout ce qui pouvait donner prise, les cheveux, les oreilles, les cols de chemises, manches de manteau, cravates, les sacoches et parapluies, les corbeilles à papier, les morceaux de craie, brosses à tableau, cahiers, livres, chaises qui bientôt furent utilisées comme projectiles tous azimuts…
J’écoute toujours Kyn toute à son dessert me décrivant maintenant le Pérou après avoir réussi à installer dans son assiette le Machu Pichu en forme de salade de fruits caramélisée, ce qui ramène à l’avant-scène dans mon esprit le souvenir du message de mon ami Mahrko reçu ce matin :
Tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. N'oubliez pas de vous réveiller car le plus important c'est nos anniversaires et les économies à faire d'ici là pour les cadeaux. Pour moi ce serait un bonnet à grelots et pour toi ce serait un tricot de peau en laine de chameau, comme cela quand tu te grattes cela me fait rire et ça fait bouger les grelots
Très curieux venant de Mahrko qui est trop sérieux pour écrire cela. Il n’est pas né en Irak ni dans un pays andin, mais je dois composer avec le burlesque du tableau de cirque qu’il me donne innocemment, où je me vois en train de me trémousser dans une insupportable veste en laine, chaude comme un four, qui me gratouille à en devenir fou, qui pue le bouc, face au visage lunaire d’un Mahrko secoué de rire qui dodeline gentiment la tête de droite à gauche à la manière des Indiens qui ne savent pas quoi répondre, et fait chanter les airains au son creux de son bonnet en pointe à pompon, et çà me gratte, et çà colle…
Que faire de ceci ? Pépite à raffiner ou vulgaire caillasse bonne à jeter ? Suis-je déjà sur une des passerelles de Kyn ?
Aujourd’hui en ces temps de décadence avancée, lorsque je suis fatigué ou que je n’ai pas le moral, j’ai le sentiment d’une mort de la littérature, comme on parle de la mort du cinéma depuis que Godard prétend l’avoir assassiné. C’est un sentiment contradictoire parce que je sais qu’elle est un noyau de résistance très vivace à la bêtise ordinaire et au cynisme ambiant qu’il faut savoir dénicher un peu comme de trouver une oasis en plein désert sans carte ni boussole mais seulement avec de l’intuition, de l’imagination et finalement de l’intelligence.
Et quand on le trouve, on comprend très bien en quoi la littérature est un contre pouvoir. Ce ne sont pas des cocktails Molotov que les déshérités des banlieues et d’ailleurs doivent fabriquer pour se révolter et changer le monde. Qu’ils investissent les bibliothèques publiques ! C’est là qu’ils trouveront les vraies bombes.
- Aux lèvres qui tirent ta joue pour rejoindre ton oreille droite, ton sourire est magnifique et me rend jalouse des pensées qui t’amusent !
- Pas de panique Kyn, je pensais à la prochaine révolution qu’on lancerait à coups de grelots.
- Hmmm ! Laisse-moi deviner. Façon moines tibétains ?
- Hé bien pas tout à fait. Je t’explique. Si tu considères…
- Hééééé ! Mais qui est-ce que je vois ici à cette heure-ci et en si belle compagnie ?
- Ouahh ! Mazette à bison ! Mais c’est Tilbur ! Toi ici ! Je te croyais en plein tour du monde ! Kyn, il faut que tu saches que Tilbur a entrepris – il y a deux ans je crois – c’est cela Tilb non ?, deux ans ou trois, peu importe, c’était juste avant le crash mondial et l’abolition des marchés -, de faire le tour du monde en sautant de capitale en capitale en suivant l’alphabet. Un abécédaire en forme de circuit géo-politico-poético-historique ! En bon démocrate il a commencé par Athènes, puis en guise de bras d’honneur courageux il a poursuivi par Bagdad et ainsi de suite.
Tu as donc choisi Paris pour la lettre P. Pyongyang ne te plaisait pas ?
- Pas vraiment, mais j’ai beaucoup hésité à me rendre à Prétoria pour tous les amis qui survivent là-bas.
- Et après qu’as-tu trouvé pour Q ?
- C’est justement la difficulté. Pas de capitales en Q ou pas de bons Q pour une capitale. Si je vais à Quebec, je me mets tous les anglo-américains à dos et déclencher une guerre de plus n’est pas dans ma stratégie. Je préfère passer pour un illettré et me rendre par exemple à Qiev, ou à Qolombo ou à Qaracas, quitte à faire mourir de rire les habitants en passant pour le dernier des crétins. Comme j’hésite, mon étape parisienne en sera d’autant plus longue… mais dîtes-moi, j’arrive en plein déjeuner. Je dérange ?
- Pas du tout, on parlait de révolution sur fond de purée d’Ecosse. Kyn, je te présente Tilbur Arif Jamal, un des derniers oulipiens vivant sur cette planète.
- Vous paraissez bien jeune pour un oulipien !
- Sans doute un effet d’optique !
- Dis-moi mon cher Tilb, tu ne devais pas écrire un nouveau roman d’aventure censé se dérouler en Polynésie ou aux Seychelles ?
- Bonne mémoire mais toujours aussi nul en géographie ! Acapulco n’a pas changé de place et c’est dans cette ville que je vais faire souffrir mon prochain héros. Du stupre, du fric, la drogue, les filles, la chaleur, les cocotiers, la canaille, la nuit, la décadence mexicaine, et par-dessus tout l’océan comme une vengeance terrible, inassouvie, comme un mystère cosmique, comme un futur probable, un dieu qui attend, un témoin immuable de nos atrocités…Tenez ! J’ai là quelques brouillons. Lisez çà, l’action se passe à Acapulco justement, c’est tout frais de cette nuit !
……
Je suis comme un gosse devant un arbre de Noël, ébahi, émerveillé, avec l’air idiot qui a dû faire rire les mecs et les filles qui m’ont vu débarquer. Ils m’ont pris pour le énième touriste qui découvre la lune. A leur place, si j’avais vu débouler un type aussi angélique dans cet endroit, je me serais marré comme eux.
Maintenant, allongé dans mon hamac, c’est l’image que j’ai de moi quand je me suis retrouvé ce matin devant ce fichu Océan Pacifique, sauf que c’était l’été et ce qui s’étalait devant mes yeux n’avait rien à voir avec un sapin décoré.
Pacifique ? Mon cul !
Quelle naïveté ! Comme si l’océan pouvait être pacifique !
Je me rappelle qu’à ce moment-là, quand j’ai vu les immenses vagues se fracasser sur la plage dans un bruit de tonnerre, j’ai eu un peu la frousse et j’aurais dû y prêter plus attention.
Avec les copains qui m’ont ensuite rejoint, çà n’a pas traîné. On a enfilé nos maillots et couru aussitôt vers les vagues. C’était vraiment grandiose ! Je n’avais encore jamais vu de vagues aussi hautes. Quelle puissance !
Bill a dit : « hé les gars, on joue au surfeur ! »
Et Jack a répondu : « d’accord, celui qui fait la plus longue bordée gagne la tournée de ce soir »
« D’accord Joe ? » m’a demandé Bill.
« OK » j’ai répondu.
Je me suis avancé prudemment vers le large, deux trois pas seulement. J’étais vraiment impressionné. J’avais de l’eau jusqu’en haut des cuisses. Les vagues étaient d’une force incroyable. Elles arrivaient à intervalles réguliers, se hérissaient d’un seul coup, hautes de plusieurs mètres et s’abattaient d’un bloc, déversant un torrent de flots déchaînés sur la plage, tellement énergiques qu’ils se reformaient après coup en une vague plus petite qui me surprit par sa vigueur car elle me bouscula, me fit tomber et me cracha violemment sur le grève comme une vulgaire épave.
« Ouah la vache ! » s’exclama Bill.
« Faites gaffe les gars, il y a des courants dangereux, même ici à cette profondeur » compléta Jack tout essoufflé.
« Pas grave, du moment qu’on a pied » j’ai dit crânement.
« Bon, on continue ? Le pari tient toujours ? » Voulut s’assurer Bill.
« OK !! » a-t-on crié en chœur.
Je vis arriver la prochaine vague au loin et allai lentement à sa rencontre pour mieux profiter de son puissant roulis. Pendant que je l’attendais, le ressac de la précédente refluait tellement fort que le sable fondait littéralement sous mes pieds enterrant mes chevilles et bientôt le début de mes mollets. L’immense paquet de mer me frappa si violemment que je n’eus pas le temps de m’allonger pour surfer. Je fus tourneboulé dans tous les sens et expulsé sur la plage comme la première fois.
C’était stimulant comme si l’océan me jetait un défi. J’y suis retourné en faisant plus attention et cette fois-ci je me suis bien ajusté au bon moment pour une glisse de plusieurs dizaines de mètres. Une belle trajectoire ! J’étais grisé, ivre de joie. Quelle sensation !
« Ouaouh ! Super ! » Ai-je crié tout excité – « Hé, Bill, Jack, vous avez vu ? »
Mais ils étaient à leur tour complètement chavirés et ne m’entendirent pas. Engaillardi par mon exploit, je les laissai et retournai à un nouvel affrontement.
J’avais fini par comprendre le rythme et la fréquence des vagues, le moment de leur chute, la puissance du roulis, la force traitresse du ressac arrière, le piège du sable qui fond sous les pieds. J’avais remarqué qu’une série de quatre énormes vagues successives était toujours suivie par une petite vaguelette insignifiante, comme si l’océan avait besoin de souffler lui aussi. Puis aussitôt après, c’était le carrousel de tonnes d’eau qui recommençait, s’abattait et déferlait dans un dégueulis d’écume. J’avais acquis une bonne technique. Je maîtrisais maintenant bien mes glissades.
Et j’ai voulu les allonger davantage pour que mes potes paient leur tournée le soir.
J’ai avancé encore un peu plus vers le large, face à quelque chose d’énorme qui se profilait, une vague terrible, plus grosse que toutes les précédentes.
Je me rappelle encore mon excitation, le trac du choc qui allait arriver.
Elle m’est tombée dessus comme une cataracte de pierres s’écroulant d’une masse, me happant, me retournant dans tous les sens, un roulis soudainement fou, interminable, dans lequel je ne maitrisai plus rien, tête en bas, membres disloqués, poumons tendus à bloc, en manque d’air, impossible de respirer, écrasé dans les bouillons qui ne se calmèrent qu’à la dernière seconde me permettant d’inspirer une goulée d’air et de reprendre mes esprits, juste le temps de constater avec effroi l’ampleur du danger où j’étais plongé, je n’avais plus pied, le courant m’avait entrainé au large, en bas de la nouvelle lame qui déjà accourait pleine d’une fureur menaçante, ouvrant son immense gueule de monstre qui s’abattit sur moi avec une violence inouïe, dans un grondement de tonnerre furieux, me croqua, m’avala entièrement, me déchiqueta comme un fauve affamé qui dépèce sa proie, me balançant de tous côtés dans sa rage infinie, me secouant et me retournant comme un sac dans tous les sens, souffle coupé, cœur en saccades, tordu de panique, englouti dans ce tourbillon infernal, je buvais des bassines entières, sonné, complètement affolé, j’eus à peine le temps de happer un bol d’air que la vague suivante, titanesque paquet de mer brute de furie s’effondra sur moi, m’absorba à son tour, me déchiqueta comme les deux autres, mâchant dans un délire insatiable mes membres en vrac, écrasant mon corps vaincu, pressuré, prisonnier à bout de force sous la puissante et implacable férule de cette immense montagne liquide, gisant au fond d’un cachot sous marin au milieu des flots en furie qui continuaient leur torture, sadiques sévices qui maintenant cassaient mon corps abattu en le tordant dans tous les sens, corps perclus de douleur en pointes de dagues vrillées à l’intérieur de mes cotes écartelées, disloquées, poumons écrasés, cœur prêt à exploser, transpercé de mille flèches, j’avalai air et eau en râlant des cris de phoques, je me relevai, sombrai de nouveau, gesticulai comme un pantin grotesque en appels au secours désespérés et incompréhensibles et jetai mes dernières forces en mouvements erratiques dans la spirale du maelstrom incessant qui m’engloutissait, je m’asphyxiai, je m’abandonnai moribond et me retournai pour me soumettre, victime expiatoire, au coup de grâce du quatrième raz de marée hissé à l’aplomb qui s’abattit en avalanche terrible, m’écrasa dans un fracas de fin du monde et tel un énorme bloc de plomb, m’assomma en m’entraînant au fond dans les flots victorieux de l’écume en délire.
Vaincu, c’est avec une profonde tristesse que j’acceptai incrédule ma fin tragique. Une noyade absurde. Je lâchai tout, j’abandonnai le reste.
Oh cruel destin ! La chair arrachée, l’esprit torturé n’avaient donc pas suffi. Que devais-je encore expier ? Que n’avais-je pas fait pour mourir ainsi, loin de tout et si abîmé. Finis mes avenirs radieux imaginés en belles perspectives pleines d’espoir, finies mes idées enchanteresses de futurs conquérants, mes images d’amour éperdu jalousement cachées, mes désirs inassouvis fébrilement prostrés dans l’attente du grand jour, tous ces rêves, toutes ces pensées, précieux livres écrits depuis l’enfance, accumulés au fil des années, posés avec douceur sur les étagères de la vaste bibliothèque de ma vie, tant souhaités, tant désirés, tout cela était perdu à jamais et disparaissait.
Je flottai amorphe, insensible au bruit, dans cet ultime instant avant que les poumons lâchant le dernier ballon d’air, n’accueillent la fatale brassée d’eau salée.
……
Sur la lande déserte où gisait mon âme, le voile sombre de la mort commença à se déployer en un vaste brouillard noir d’où surgirent les premiers délires, images burlesques d’un piano ondulant dont les touches blanches et noires devinrent bientôt le sourire diabolique d’une large bouche qui s’étira à l’infini et disparut, dévoilant un drôle de faisceau de pâles lucioles émaciées en forme de momies blanchâtres qui flottaient doucement dans les courants de ce pays à l’affreux soleil noir d’où rayonnait la nuit.
Tout était calme, froid, silencieux
Tout semblait mort
Rien ne bougeait
Rien
Seule l’attente de la chute finale
……
Au bout du sombre marais insondable de mon esprit, il y eut soudain un crépitement.
Un craquement presque inaudible.
Du fond des profondes tourbières de mon agonie, sortit un son étrange et neuf.
Puis, en écho, un autre lui répondit, fragile et incertain.
Puis un autre encore, hésitant et maladroit.
……
Le silence fit place peu à peu à un curieux chant d’éclats métalliques répétés venant de toutes parts qui essayaient dans une tension croissante et désordonnée de s’unir pour créer entre eux un arc électrique stable et continu et, telle la naissance difficile de la flamme d’une allumette humide, un réseau serré de filins de lumière argentée se tissa et s’étendit sur toute l’étendue de la morne plaine et réveilla par secousses répétées une pensée larvaire enterrée en somnolence, qui lentement s’anima pour donner naissance à une idée salvatrice qui se rappela d’un coup en un flash saisissant l’existence de la petite vaguelette qui suivait toujours le troupeau de monstres, oui, l’idée à ce moment-là se concentra en espoir tangible puis en une farouche certitude que, oui, seule cette petite vague amicale et seulement elle, seule cette caresse d’eau polie et bienveillante pouvait ouvrir sur le chemin de la liberté.
Et alors, vacillant, à peine éclos, un projet prit corps, une volonté s’organisa en forme de petite larve déterminée, lumineuse comme un ver à soie à tête phosphorescente, porteuse d’une torche en feu, brûlant d’un espoir infini, flamme de la délivrance, flamme de la liberté, rampant maladroitement vers son objectif, frayant avec opiniâtreté son long chemin vers le gigantesque phare dressé là-bas loin au fond de l’esprit endormi, qu’il fallait allumer comme une flamme olympique, seul brasier à cette hauteur pouvant lâcher une large averse de lumière sur ce pays de mort, seul feu capable du haut de sa tour d’éblouir et de ranimer par un soleil nouveau, l’ensemble des énergies moribondes terrassées, du corps et de l’âme, et de réchauffer le sang neuf nécessaire aux flux de volonté requis pour réussir cette dernière entreprise de survie.
Des chants d’espoir s’élevèrent alors, les ténèbres s’éclaircirent, des scintillements épars et inconnus foisonnèrent en fuseau autour de la larve qui avançait toujours acharnée, la portèrent au pied du sémaphore qu’il fallait gravir jusqu’en haut pour allumer le bûcher, des millions de doigts d’une incroyable énergie s’agitèrent et déposèrent cet espoir de flamme, cette volonté de vivre, au sommet de ce phare d’Alexandrie qui s’embrasa aussitôt en une boule de lumière incandescente. Les ténèbres refluèrent devant l’explosion de cette aurore cosmique, poudre d’or lancée en un vaste nuage scintillant sur le glacis sombre et gris de la plaine, la nappant aussitôt d’ambre et de miel, de chaleur et d’espoir. La vie reprit ses droits, tout se mit en branle pour saisir cette dernière chance.
Oh phare merveilleux qui donnait maintenant le cap à toutes les actions, qui éclairait maintenant le nouveau territoire de cette volonté de vivre !
Tout se réveillait, tout s’ordonnait, tout s’acharnait à vaincre.
Alexandrie flamboyait ainsi que toute l’Egypte jusqu’aux confins du désert, là-bas en Sicile les palais d’Ortygie reprenaient vie et paraient leur façades maritimes d’ocre et de cuivre, à l’Orient la Corne d’Or s’embrasait et Constantinople resplendissait de ces mille minarets découpés sur l’aurore naissante, Alger suivait à son tour de sa blancheur immaculée, les Cyclades de la Grèce Antique revirent se lever le Matin du Monde, guirlande de lumière enchenillée sur le pourtour de cette Méditerranée où tout n’était que feu, espoir et volonté.
Dans un sursaut insoupçonné, mon corps épuisé se tendit et réussit à manœuvrer pour accueillir le vaguelon qui, comme l’idée-lumière l’avait prévu, me poussa légèrement vers la plage, suffisamment pour que mes pieds effleurent le fond. Il fallait néanmoins encore nager pour m’arrimer au sable de la grève et n’être pas arraché par la nouvelle série de vagues géantes qui déjà se profilait. Je jetai alors mes dernières forces dans cette bataille décisive et nageai comme un forcené pour me rapprocher le plus possible de la terre, j’avalai l’air, j’avalai l’eau, la recrachai, je pleurai, criai, brassai en tous sens, avançai tant bien que mal dans une panique grandissante à en perdre la raison au fur et à mesure que je voyais derrière moi foncer le terrible bourrelet grandissant d’une houle pleine de fureur et de rage qui s’abattit comme les autres dans un fracas de tonnerre mais ne put me happer.
Trop tard !
J’avais assez progressé et réussi à agripper le sable que je tenais ferme de mes quatre pattes en crochets solidement ancrés pour résister aux pièges des courants du ressac qui refluait vers le large.
J’étais sauvé.
Je râpais le sable comme un crabe centenaire, abruti, épuisé, la gueule dans les graviers telle une tortue géante rampant à bout de souffle vers son nid de ponte. La douleur à son comble irradiait mon corps meurtri planté de lances de javelots et de flèches.
J’existai à peine et restai immobile et prostré.
Je ne pus me relever que bien plus tard, ne pouvant arrêter l’essoufflement qui m’empêchait de réfléchir, et me dirigeai chancelant vers mes amis qui, allongés au sec, sans doute depuis une éternité, me regardèrent d’un œil torve et m’accueillirent par des paroles chaleureuses de bienvenue.
« Tu en as mis un temps ! » éructa Jack
« Ma parole tu souffles comme un pouf marocain sur lequel on assoit un gros cul ! » lança Bill plein d’humour.
Quand je pus parler, je les regardai tous les deux et leur dis :
- Je suppose que tu vas nous dévoiler ce que Joe leur répond ?
- Eh bien figure-toi que je n’en sais rien du tout. Que leurs dirais-tu, toi à ces deux loustics si tu étais Joe ?
- Le fait est que je ne suis pas Joe et que la suite t’appartient à toi seul, tu le sais bien, Tilbur
- Et vous Kyn ? Vous avez l’air ébranlé
- Pauvre Joe ! Cela ne donne décidemment pas envie d’aller à Acapulco, et personnellement je préfère la montagne.
- La montagne ? Pourquoi pas. Vous savez ce qu’a dit Thomas Mann quand il a visité les massifs alpins : « la montagne, cette mer solide »
- Tilb, après ton périple autour du monde, qu’envisages-tu de faire ?
- Sans doute une longue traversée ferroviaire. La Sibérie ou le Canada. Mais plutôt l’Ouest américain, le Nouveau Mexique, l’Arizona, la frontière mexicaine… Bon, je dois vous quitter – une réception dans les milieux décadents, un truc gratiné si vous voyez ce que je veux dire…
- C’est donc pour cela que tu es habillé en prince ! On peut savoir ?
- Hélas non, top secret. Pour le déguisement, pardonnez-moi mais je vais encore citer Thomas Mann qui a dit : « Habille-toi en bourgeois…
- …mais pense en révolutionnaire » - Oui je connais !
- Hasta luego amigos !
- Dis-moi Kyn, après le haggis habillé en Ecosse et la salade de fruit de la Cordillères des Andes, le café ne t’as pas inspiré dirait-on ?
- Peut-être que si je regarde ma tasse du dessus, j’arriverai à entrevoir la pupille noire de l’œil de Neptune ?
- 14 h. On y va ?
- Tu sais, il m’arrive relativement souvent d’être parcourue d’un frisson de plaisir lorsque je lis un texte très bon, très évocateur. Pour peu que l’air ambiant soit bien disposé- je veux parler de sa densité et de son parfum…
- Même l’hiver ?
- Oui, même l’hiver. Quand il s’agit de littérature, j’ai remarqué que l’agencement des choses, les silhouettes, l’allure des passants, toute la situation du moment s’électrise et devient si particulière qu’un enchantement se forme comme par magie ou un événement singulier survient par hasard – tu connais ma conception du hasard ! –.
- Et la musique, tu entends la musique ?
- J’imagine souvent du piano, c’est vrai. Et dans cet état d’extase, je suis traversée de désirs impérieux, j’ai soudainement faim, j’ai envie d’embrasser la Terre entière. Tu sais quand je suis partie ce matin pour te rejoindre à La Rotonde où tu m’attendais à la terrasse, je savais ce que tu lisais et que tu étais parti dans un voyage.
Je t’ai envié et c’est pour cela qu’au lieu de venir en taxi, j’ai voulu prendre moi aussi ce train pour être moi aussi dans cette traversée de l’Ouest américain.
Le trajet fut long mais en valait la peine. C’était un vieux train du siècle dernier. J’étais assise près de la fenêtre, du coté du paysage qui défilait mais ne changeait pas vraiment, le désert est infini dans cette région. En face de moi, une femme très belle savourait un livre que tu as lu il y a peu et que tu as beaucoup aimé. J’examinais les expressions de son visage pour saisir si ses émotions ressemblaient aux tiennes et j’aurais voulu l’interrompre pour lui demander ce qu’elle ressentait. Un peu plus loin un homme d’âge mûr bricolait un jeu en bois à l’aspect compliqué que lui avait tendu une petite fille, peut être sa fille, qui l’observait avec admiration. Derrière moi, un groupe de jeunes ne pouvaient pas cacher leur joie de se retrouver ensemble pour des vacances sauvages dans une tribu indienne qu’ils décrivaient avec passion, impatients qu’ils étaient d’imiter les cowboys des films qui avaient remplis leur imaginaire depuis l’enfance. Tous les occupants du wagon voyageaient à leur façon.
Je m’imaginais que tout ce que je voyais m’appartenait. Et puisque je l’imaginais, cela devenait réel. Je n’oublierai jamais ma descente des marches à l’arrivée !
- Moi non plus !
- Viens, partons tout de suite ! Quelle destination, quel pays fabuleux, dans quel imaginaire veux-tu aller? Une île, un pays, une ville ou un livre chez nous ?
- Les deux mon capitaine !

*
LIVRES
J’ai dit que l’auteur de ces deux nouvelles était un boulimique de lecture. Quoi de plus naturel dès lors que de faire figurer ici quelques-uns de ses menus plaisirs.
Commençons par un de ses auteurs de chevet :
Max Milner
Né en Normandie, d’un père polonais et d’une mère espagnole, Max Milner avait épousé la fille (suisse) de Charles Panzera, ce qui ne dira rien aux fans de U2 mais fera tilt dans la mémoire des fous d’opéra. Écrivain et essayiste français (il faut bien dire quelque chose), dix-neuvièmiste de haute volée, Max Milner est mort en juillet 2008, deux ans après sa femme et à la veille de son quatre-vingt-cinquième anniversaire, laissant une oeuvre considérable tant par la qualité que par la quantité. Le jour où Radio France fera retour au monde civilisé, le jour où les pamphlétaires n’y seront plus à la merci des saltimbanques, peut-être pourra-t-on réentendre les cinq entretiens qu’avait accordés Milner à France Culture en janvier 1990, dans la série « À voix haute » lui consacrée.
Entretemps, il nous est loisible de découvrir ou de redécouvrir ses livres, dont les deux que voici, chers à Édouard Le Cèdre :
L’envers du visible. Essai sur l’ombre, Paris, Seuil, 2005.
454 pages
dont l’éditeur nous dit : « Rendre à l’image sa part d’ombre, scruter les voies qui conduisent de l’obscur à l’illimité et au transcendant, explorer les envers d’une réalité dont la face lumineuse ne contiernt pas tous les secrets, tel a été le but des penseurs et des artistes dont il est question dans ce livre. »
Le Diable dans la littérature française de Cazotte à Baudelaire, 960 pages. Paris, José Corti, 1960, rééd. revue 2007.
De Cazotte, précurseur de la littérature fantastique française, à Baudelaire, ils y sont tous, en effet. Ou presque. Manque Saint-Just. Est-ce, peut-être, que l'Archange n'a pas pris assez au sérieux son rival ? Mais l'étude et même une sorte de psychanalyse de ceux qui y ont cru est exhaustive et fouillée. Et puis, ne faut-il pas que dans les plus beaux Tabriz il y ait quelque chose qui manque car seul Allah est parfait?
Continuons par une de ses découvertes récentes :
Roberto Bolaňo
Poète avant tout, mais aussi romancier, né à Santiago du Chili en 1953, Roberto Bolaňo est mort à Barcelone en 2003.
Émigré au Mexique avec sa famille, il y devient un militant de gauche. En 1973, il fait retour dans sa patrie pour « aider à y construire le socialisme ». On sait ce qui est arrivé au Chili le 11 septembre de cette année-là. Aussitôt arrêté par les sbires de Pinochet, Bolaň o aura la chance d’être sauvé par deux anciens camarades de classe devenus gardiens de prison. Il ne sera pas torturé mais il entendra torturer les autres. Son oeuvre en portera les traces. Après cet épisode noir, Bolaňo deviendra un homme à bougeotte : vagabond, alcoolique, drogué – « beatnick parcimonieux » selon sa propre expression – il finira par atterrir (et se marier) en Espagne à la fin des années 70. Mais l’écrivain enfin rangé ne jouira pas longtemps de sa nouvelle vie : les années de désordre et d’errance réclament bientôt leur dû, et il meurt en 2003, à 50 ans tout juste, laissant à sa famille ce mastodonte inédit :
2666, Paris, Christian Bourgois, 2008, 1024 pages.
Le Cèdre nous en a très longuement et chaleureusement parlé. Je ne me ridiculiserai pas en essayant de le résumer à ceux qui ne l’ont – comme moi – pas (encore) lu. Avec ce roman qui en contient cinq, il faut s’embarquer résolument sur les pas du Chilien trop tôt disparu. Ils le disent tous : c’est son chef d’oeuvre.
Un autre des romanciers de prédilection de notre nouvelliste :
Thomas Pynchon
On ne présente plus cet auteur-culte américain (N.Y,1937), connu pour ses œuvres mélangeant l’absurde à l’érudition, que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de « plus grand écrivain vivant ». Laissons à d’aucuns la responsabilité de leurs hyperboles et ne mentionnons que pour mémoire quelques grands titres de cet auteur, du mythique V (de 1963) et de L’Arc en ciel de la gravité (de dix ans plus tard), au tout récent Vice caché (de 2010), sa route est longue et jalonnée d’oeuvres hors du commun, qui n’arrêtent pas de faire couler des flots d’encre. Celle qui a eu il n’y a guère les faveurs d’Édouard Le Cèdre, c’est :
Contre-Jour, 1216 pages, Paris, Seuil, Fiction & Cie, 2008.
Je me garderai bien, là aussi de m'exposer aux lazzi, puisque, comme vous peut-être, je ne l’ai pas lu. A peine sais-je ce qu’en ont dit, dans Chronic’Art, David Boratav et Olivier Lamm : «...livre-Béhémoth... » , «...livre touffu et difficile, tant par sa longueur que par ses digressions, le fourmillement de son sens, et la multiplicité de ses niveaux de lecture. (...) Mais c’est aussi, et avant tout, un formidable divertissement, une oeuvre à la fois grave, facétieuse et jubilatoire.» Et pour la totalité de l’article dithyrambique, c’est ici :
http://www.chronicart.com/livres/chronique.php?id=11098
Enfin, la dernière découverte en date d’Édouard Le Cèdre est celle d’un dessinateur qui s’est voulu historien et qui a réussi une oeuvre très personnelle, sans guère d’équivalent.
Joe Sacco
Né sur l’île de Malte en 1960, émigré enfant avec sa famille à Los Angeles, après un crochet par l’Australie, Sacco a fait d’abord des études de journalisme, puis une maîtrise en Art à l’Université d’Orégon en 1981.
Visiblement préoccupé par les guerres contemporaines, il porte très longtemps un travail sur celle du Vietnam qui ne trouvera jamais d’éditeur (tiens donc...). Dans How I loved the war, il analyse ses sentiments de téléspectateur devant la première Guerre du Golfe. En 1992, il visite la Palestine, et c’est un double livre : Palestine : Une nation occupée (1993) et Palestine : Dans la bande de Gaza, qui lui vaudra le prestigieux American Book Award en 1996.
Avant celui qui nous occupe ici, il a consacré plusieurs livres encore à la mise en pièces planifiée de la Yougoslavie, dont Gorazde : la guerre en Bosnie orientale, 1993-1995, et The fixer : une histoire de Sarajevo, ainsi que Derniers jours de guerre : Bosnie 1995-1996.
Cette somme étonnante, unique à ma connaissance, fait de lui l’inventeur du journalisme d’immersion en bandes dessinées. Même l’apparence ingrate de son dessin se révèle très efficace et sert admirablement son propos.
Gaza 1956 . En marge de l’Histoire, 424 pages, 20x27, Paris, Futuropolis, 2010. Histoire, en BD, d’un crime de guerre commis par l’armée israélienne à Gaza en 1956.
« C’est un reportage choc, mené par un journaliste-dessinateur, sur les causes, les circonstances, les suites, les conséqsuences de ces crimes de guerre perpétrés par une armée d’occupation lors de l’opération de Suez menée en collaboration avec les Français et les Anglais. Une BD de 400 pages d’une force incroyable, parfois insoutenable. » (Pierre Magnan, France 2.fr)
« Parfois insoutenable »... Je souscris. C’est, je crois, exactement l’intention de l’auteur.
*
Et puisque nous sommes dans les livres, restons-y.
Petite contribution personnelle de votre servante à cette bibliothèque de l’été qui vous arrive avec les carabiniers :
Oui, pendant que mes contemporains transhument, prennent l’avion, chargent la voiture ou s’entassent dans des autocars climatisés, j’explore, en musardant, les bibliothèques publiques. Elles finiront bien par acquérir, avec l’honnête retard qui sied à la province, quelques-unes des briques chères à Lecèdre. En attendant, on y trouve d’autres pépites. Je vous recommande, si vous ne les connaissez pas, deux modestes « formats poche » que je viens d’y découvrir.
Manuel Vazquez Montalban
L’homme de ma vie
Paris, Christian Bourgois, 2002.
Paris, Seuil, 2003, Coll. Points, au format de poche.
On ne présente plus Vazquez Montalban ! Qui ne sait pas que c’est en son honneur qu’Andrea Camilleri a nommé Montalbano sa propre version de Pepe Carvalho, fin gourmet et quintessence de toutes les Siciles ?
Vazquez Montalban est mort en 2003. En 2000, il avait fait paraître cet El hombre de mi vida, visiblement écrit à l’approche du « nouveau millénaire ».
À l’heure où le dépècement de l’Europe bat son plein et où les minorités, dûment instrumentalisées, ont servi comme prévu à le faire advenir, ce n’est pas sans un plaisir quelque peu masochiste que l’on découvre ce que le grand Espagnol en disait si lucidement avec une dizaine d’années d’avance, sous couleur de nous vendre un polar ibérique.
Il faut quelque agilité d’esprit pour lire Montalban. Mais l’effort n’est rien en regard de la récompense.

Daniel Chavarria
Le rouge sur la plume du perroquet
Paris, Payot & Rivages, 2003
Paris, Payot & Rivages, 2005 pour l’édition de poche.
Daniel Chavarria est un Uruguayen – on peut même dire un révolutionnaire uruguayen – réfugié à Cuba, où il enseigne la littérature grecque classique à l’Université de La Havane. Il fait des traductions aussi, de plusieurs langues mais surtout du latin et du grec. Et il écrit des livres.
Tout est bon dans Chavarria, tout est extraordinaire. À commencer par sa galerie de jeunes prostituées aussi belles qu’intelligentes, ou alors – quand l’intelligence n’est pas leur qualité première – d’une originalité qui fait d’elles de grands, d’inoubliables caractères, comme c’est le cas pour cette irrésistible Sabine, dite Bini, dans El rojo en la pluma del loro, ma trouvaille de cette semaine.
C’est un lieu commun de dire que l’histoire des XXe et XXIe siècles s’écrit dans le polar. Ce livre, une fois de plus, le prouve. Car, outre la vie, haute en couleurs, chez les ginetas de La Havane, Chavarria, à l’instar de Montalban, nous raconte bien d’autres choses.
« Est-ce ainsi que les hommes vivent ? »... Hélas, oui, des deux côtés de l’Atlantique, et c’est bien laid. Donner des cours de torture - supervisés par le grand frère Yankee - en pratiquant la vivisection sur des SDF et autres mendiants raflés tout exprès parce qu’on est sûrs qu’ils ne seront réclamés par personne et qu’aucune mère ne viendra défiler sur aucune place en brandissant leurs portraits, cela se fait ? Oui, couramment. Voyez Montalban. Voyez Chavarria. Tiens, ces deux romans prétendûment policiers ont été écrits la même année... Ils nous parlent de nous. De notre présent, que nous ne voulons pas voir tel qu’il est.
Déclin de l’Occident ? Pas dans les lettres hispaniques en tout cas.
Grands petits livres ! Auteurs chers à mon coeur !
Catherine L.
12:23 Écrit par Theroigne dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |